Un son conçu avant tout pour la danse, basé sur la vitesse extrême et structuré par des effets de carambolage perpétuel : c’est plus ou moins comme ça que j’expliquerais la musique singeli au jeune Theodor Adorno si lui et son école de Francfort avaient déménagé en Tanzanie en 2019 plutôt qu’aux États-Unis dans les années 30.
Né à Dar-Es-Salaam il y a environ dix ans, le singeli s’est fait connaître en Europe en 2017 à la sortie de la compilation Sounds of Sisso , du nom d’un des principaux labels du genre, Sisso, qui se trouve être aussi le nom de son fondateur. L’an dernier le disque de Bamba Panaa a achevé de mettre tout le monde d’accord : ce son est bel et bien nouveau et réel (il va tellement vite que ça peut limite faire paniquer mais tant mieux) et c’est un phénomène très populaire parmi la jeunesse tanzanienne si on en croit les images de fêtes de rue qu’on a on pu voir ici et là. Le mois dernier est sorti Tatiso Peza, le premier album d’un autre membre de cette scène, Jay Mitta, et la semaine prochaine va suivre le disque de Duke, autre producteur au son plus lo-fi, voire « punk » par l’esprit– même si Jay Mitta n’est pas non plus un disciple de Nicolas Jaar, soyons clairs, ça reste de la fabrication très brute et ça n’a pas l’air d’aller chercher bien loin en termes de budgets de prod.
Ce qui frappe le plus au départ à l’écoute des productions singeli, c’est donc la frénésie des BPM et plus généralement la frénésie de l’animation rythmique. On pense d’abord à une version accélérée du coupé-décalé ivoirien, et donc assez vite on se souvient avec émotion du logobi, aussi, cette éphémère et fantastique musique conçue par et pour quelques jeunes danseurs pubères des cités françaises, en général d’origine ouest-africaine. La vitesse n’est pas juste un gimmick, même si les producteurs singeli expliquent que c’est très clairement pour eux une façon de se démarquer, à la fois des sonorités traditionnelles tanzaniennes et des autres styles africains contemporains. C’est tout ce que cette vitesse transporte avec elle, c’est ce qu’elle déclenche chez les autres éléments, qui donne à l’ensemble sa fraîcheur et son étrangeté : ces breaks et drops qui sonnent comme des faux départs glitchés, ces séquences ultra répétitives genre « c’est rayé mais en fait non », ces changements de direction coquins qui arrivent comme ça sans prévenir, cette façon de se lâcher complètement sur les presets, tous sortis du logiciel Virtual DJ plébiscité par les artistes. Parfois la vitesse est elle-même modérée par quelques retraits dans le demi-temps, et de toute façon j’ai l’impression, en regardant les vidéos de fêtes à Dar-Es-Salaam ou ailleurs, que les gens eux-mêmes dansent souvent un temps sur deux ; dans d’autres cas, le kick tabasse tellement fort qu’il en réduit toute possibilité de propulsion, ça en devient presque antisocial.
En tout cas, c’est un plaisir de voir la grande fratrie de la dance music à BPM déraisonnables – déjà composée, entre autres, du speedcore, du gabber, de la ghettotech (de la ghettotech tardive, devrais-je peut-être préciser), de la juke, peut-être même de la bassline, et j’en oublie sûrement – accueillir un nouveau membre, cette fois-ci venu d’Afrique. Certes, on peut considérer que le kuduro angolais et ses ramifications faisait déjà un peu partie de cette société secrète, mais pour moi il n’a pas la vélocité quasi psychédélique du singeli, ce côté imprévisible et déferlant : on se dit qu’on est jamais à l’abri d’un crash quand on est pris dans un track de Jay Mitta ou de Bamba Panaa, on n’est jamais sûr que ça ne finisse pas par exploser ou par imploser, un truc reste menaçant, et on songe à l’idée de « danger rythmique » formulée par Simon Reynolds à l’époque de la jungle.
Le disque sort sur Nyege Nyege Tapes, un label monté par un Belge, Derek Debru, et un Gréco-Arménien, Arlen Dilsizian, installés non pas en Tanzanie, mais à Kampala, dans l’Ouganda voisin, où ils ont ouvert un studio qui accueille les musiciens locaux. Ils organisent aussi chaque été un gros festival qui réunit un peu toute « l’avant-garde électronique » africaine – pour information, le génie allemand Errorsmith, présent lors de la dernière édition, documentait à peu près chaque concert sur son Instagram, sans doute grisé de voir son obsession pour la vitesse techno-mécanique partagée par des habitants d’Afrique de l’Est. Si vous ne pouvez pas tout de suite danser sur les sons de Jay Mitta et de ses collègues (on espère les voir jouer en France, et on sait que Bamba Panaa s’est par exemple produit à Bruxelles en 2018, et il y a quelques semaines le Kenyan Slikback, affilié à Nyege Nyege Tapes, se produisait même à la Concrete), allez donc écouter les sorties du label, tout est bien, ça a le rare mérite d’être à la fois très varié et toujours déstabilisant.
On aura sûrement l’occasion de reparler de cette dance music d’Afrique dans Musique Journal, qu’elle se fasse au Ghana, en Afrique du Sud, en Angola (et au Portugal), au Nigéria, ou au Kenya, et bien-sûr chez les francophones des deux Congo ou de Côte d’Ivoire. Mais il faut quand même avouer, pour passer en mode « accès de conscience », que par moments je doute de ma légitimité à aborder ces musiques en tant que blanc issu des classes supérieures occidentales, et que je peux même me demander si je ne les apprécie pas pour de mauvaises raisons, ou disons pour des raisons trop construites, trop « médiées ». Disons que le simple argument du plaisir, « je kiffe le son, c’est l’essentiel, faut pas se prendre la tête sur le reste » ne suffit pas vraiment. Ce n’est pas juste le fait de ne pas vivre ces scènes sur le terrain et ne pas connaître la vie des gens qui la font ou le type de société où ils évoluent, même si c’est déjà une partie du problème. C’est aussi le risque de lire ces musiques uniquement au prisme de mes références, de voir des étrangetés là où il n’y en a peut-être pas, de vouloir apercevoir une esthétique du collage ou de la collision en lieu et place d’un choix contraint ou au contraire pas spécialement articulé. De dissimuler, en gros, mon propre égocentrisme d’auditeur qui valide telle ou telle production étrangère à ses repères derrière une pseudo-ouverture d’esprit et une attirance pour une bizarrerie de surface. C’est tout le problème du fan blanc de musique noire (africaine, mais aussi bien sûr américaine, caribéenne, anglaise, française) : entre la réappropriation critique ( “écoutez-moi ça chers confrères, voici du gabber africain, ah ils m’étonneront toujours, ces jeunes du Tiers-Monde au pouvoir d’achat 600 fois inférieur au mien !”) et la culpabilité culturelle (“mon goût prétendu pour cette musique ne sera jamais que superficiel et post-moderne, aussi ne devrais-je même pas essayer de l’écouter, car elle appartient aux Tanzaniens”), il peine à se trouver une place viable et confortable. Mais peut-être, justement, qu’il ne doit pas chercher le confort, et que c’est déjà un début pour lui d’accepter cet inconfort ? Pour le moment, j’ai tendance à me dire que cette dernière option est la moins intenable, surtout dans le cas du singeli, un son tout sauf cosy et gentrifiable, dont on distingue, au-delà de la fonction festive, la fureur sociale et politique qui habite ses auteurs et leur public. En tout cas, écoutez donc Jay Mitta pour voir de quoi il en retourne et vous faire un avis, et tentez aussi le coup la semaine prochaine avec son camarade Duke, un producteur accompagné d’un certain MCZO, dont le flow bien dégénéré devrait séduire les nombreux fans de chaos punk qui nous lisent. Je viens d’ailleurs de remarquer qu’à une lettre près Manu Chao aurait s’appeler Manu Chaos, et que sa carrière aurait certainement été tout autre.




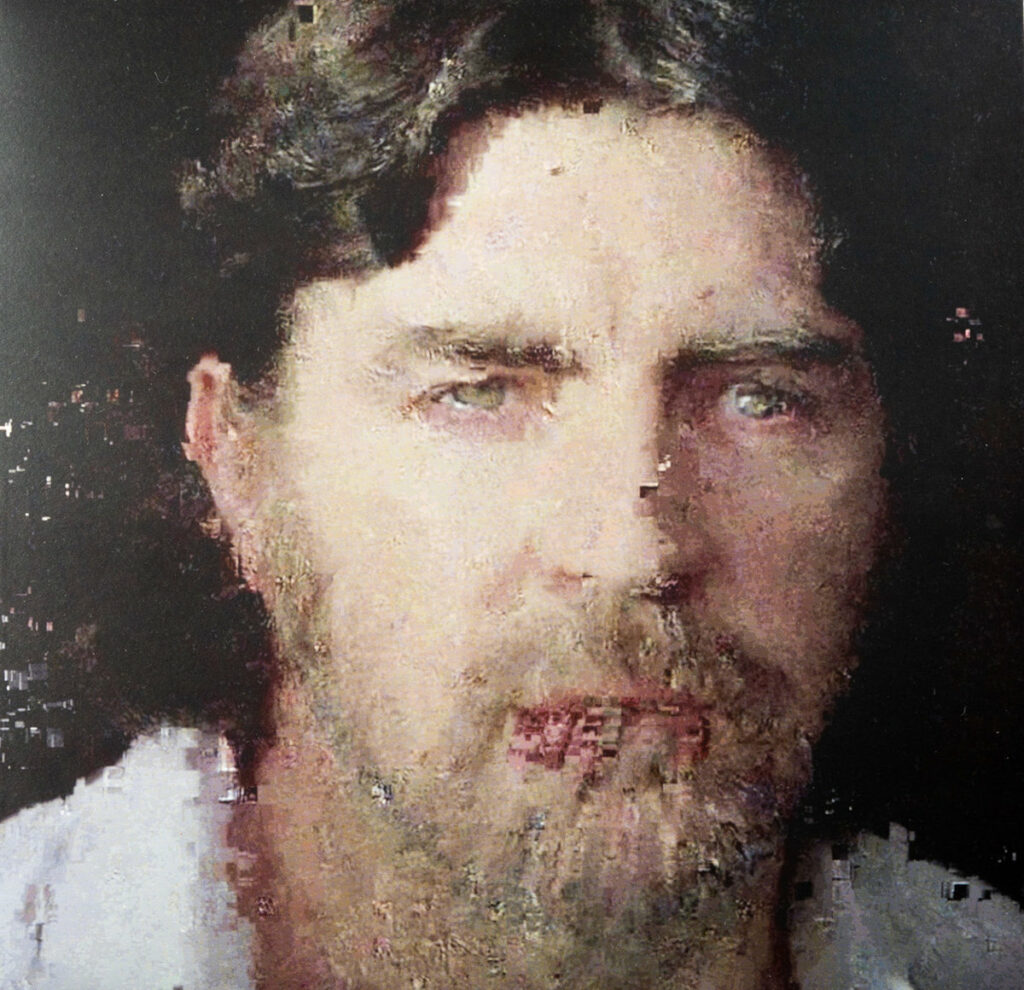
Un commentaire
Du moment que ça donne à ton corps envie de danser, aucune culpabilité à avoir 😉