Un après-midi du mois dernier, j’ai appelé Jean Nipon pour avoir de ses nouvelles, puisqu’il s’était plaint quelques jours plus tôt de douleurs au dos sur sa page Facebook. Bonne nouvelle, il allait déjà mieux, et même beaucoup mieux puisqu’il répondit à mon coup de fil alors même qu’il faisait de l’exercice aux Buttes-Chaumont. Quel guerrier, quel athlète que ce jeune artiste pluridisciplinaire bordelais ! Cette rage de vaincre devrait nous servir de modèle à tous. Mais ce n’est pourtant pas ce qui nous intéresse ici. Passé les questions musculaires et osseuses, nous avons embrayé sur une discussion plus esthétique, portant sur certains groupes de rock que nous aimions jadis. J’évoquais rapidement les Drop Nineteens, puis Seam, ce à quoi Nipon répliqua que dans Seam jouait Sooyoung Park, ancien membre de Bitch Magnet, dont faisait aussi partie David Grubbs, de Gastr del Sol. J’en profitai pour rebondir sur le fait que perso j’avais adoré Brise-Glace (dont je pensais à tort que Grubbs comptait parmi le personnel) et sinon à propos de Magnet est-ce qu’il aimait bien Monster Magnet ? Et sinon Polvo ça a bien vieilli ? À ce moment Nipon m’a coupé net, ou disons plutôt qu’il a ni plus ni moins annulé la conversation que nous avions en me demandant simplement, de son ton peu aisé à retranscrire sur le papier : « Là, ce qu’on se dit, Etienne, tu sais, c’est… À quoi ça sert de savoir tout ça ? À rien, nan ? Ça intéresse qui ? P-p-p-personne ? Nan ? » Et je crois qu’il n’avait pas tout à fait tort : est-ce que ces « connaissances » ont un véritable sens, au fond ? Est-ce si utile de connaître le nom des types (je dis des types parce que ceux des rares meufs, là en revanche on peut trouver utiles de les mémoriser, il y en a tellement peu que c’est toujours bien de garder en tête les patronymes de ces quelques héroïnes anonymes de l’indie-rock) qui certes ont pu faire des super disques mais qui aujourd’hui doivent tout de même s’en foutre un peu ou du moins trouver curieux que des quadras parisiens devisent de leur parcours par un samedi d’août grisâtre ?
Je ne vous raconte pas ça juste pour lancer un débat plus ou moins polémique sur l’importance de l’archivage, ou son absurdité, dans le domaine de ces arts populaires et informels. J’aborde cette question parce qu’il y a un groupe dont pour le coup je me souvenais bien, ou plutôt au sujet duquel j’étais en possession d’une connaissance utile et mémorable. Ce sont des Irlandais qui s’appelaient Rollerskate Skinny et dont l’un des membres, Jim Shields, n’était autre, vous l’avez deviné, que le petit frère de Kevin Shields de My Bloody Valentine. C’était mon vieil ami Christian B. Cedervall, homme de goût parmi les hommes de goût, qui m’avait fait écouter le vinyle et je l’avais en effet beaucoup aimé, sans aller jusqu’à me le procurer. Je l’ai réécouté assez intensément au début des années 2000 avec l’arrivée de l’ADSL et de Soulseek et blablabli, et ce que je peux dire, c’est ce que c’est une œuvre qui m’est apparue de façons pour le moins variées au fil du temps. Je l’ai d’abord reçue comme une collection de chansons pleines de fougue et de spontanéité, au son lo-fi et au cœur écorché ; puis j’y ai entendu une création beaucoup plus baroque, chaotique et contre-intuitive, presque étouffante d’idées et de textures. Aujourd’hui, je la redécouvre sous un jour finalement assez sage, ou du moins distancié, un peu cérébral, comme un vrai disque de connaisseurs et d’érudits, moins parce qu’elle est obscure – d’ailleurs elle ne l’est pas tant que ça, la presse musicale irlandaise l’a sélectionnée à deux reprises dans ses classements nationaux et le groupe avait beaucoup tourné à l’époque, notamment sur le Lollapalooza en 1994 – que parce qu’elle se situe entre plusieurs statuts, plusieurs régimes. Shoulder Voices n’est pas un chef d’œuvre « certifié », mais il ne fait pas non plus partie de ces disques mineurs qu’on aime bien, voire parfois qu’on adore plus passionnément que les chefs-d’œuvre ; c’est un ensemble qui paraît très pensé, souvent ambitieux, mais où le bruit semble vaporisé plutôt que déferlant, et où les voix sont claires et mixées en avant, et où les constructions ouvertes relèvent d’un psychédélisme qu’on peut trouver conscient de lui-même. C’est un album en fait très mature, moins juvénile que la moyenne des premiers long-formats du genre noisy-pop. Mais il ne s’écoute pas pour autant comme un effort imposant, à absorber patiemment afin qu’il s’épanouisse en vous, à ruminer tel un quadruple LP « à tiroirs » : il a beau avoir été conçu avec soin, il autorise sans problème une écoute distraite, il baguenaude pas mal et ne mobilise pas trop l’attention alors même qu’il est incrusté de minutiae.
Le morceau d’ouverture « Miss Leader » peut légèrement tromper sur la marchandise : pour le coup cette chanson est un vrai chef-d’œuvre, un classique instantané, avec le démarrage de sa batterie, si beau sous la voix, et puis sa basse et son piano quasi-dub comme on aimait les faire sonner en 1993. C’est un titre qui va droit au but, même si je ne saurais pas bien décrire à quoi ressemble le but en question, en tout cas c’est le genre de plage qu’on se repasse trente fois, seul ou avec des copains. Là où il annonce en revanche la couleur, c’est que malgré son apparente simplicité il déploie quand même un sacré savoir-faire en termes de mixage et de mélange de couches, de nuances d’éclairage et de valeurs de plans. C’est cette dimension lointainement prog, très picturale, pas exactement paysagère mais presque, qui va dominer selon moi la facture du reste de Shoulder Voices, et surtout cette approche va être accentuée par le jeu de la voix ou des voix, qui par leur position donnent de leur côté un caractère plus ou moins théâtral ou cinématographique à l’ensemble. C’est du chant qui tend parfois vers une sorte de voice-over fredonné et mesuré, pas du tout comme du spoken-word, mais comme un élément placé à côté ou au dessus – jamais au dessous, en revanche, ni dedans, et c’est en ça que le disque se démarque du reste du corpus noisy, les paroles sont toujours audibles, l’interprétation et le ton des vocalistes restent précis. Ce qui est superbe, c’est que cette délicatesse est au service, la plupart du temps, d’un examen fouillé des émotions brutes qui nourrissent « l’éthique » du genre telle qu’elle a été établie par MBV : confusion versus extase, gloire contre désespoir, sensualité ou décharnement, et surtout ce souffle d’espoir abstrait qui nous soulève vers des cieux indistincts mais désirables, cet instinct romantique à portée de main et si facile à faire renaître en soi.
Alors j’admets que je ne suis pas le plus expert dans ce corpus-là, et encore moins de tout ce qui a pu être fait dans l’indie-rock plus ou moins savant de cette époque-là et des années Pitchfork-rock qui ont suivi, mais j’y vois en tout cas un objet fort singulier par les échos qu’il fait résonner. Le chant parfois surjoué, voire histrion, les ruptures intempestives mais calculées, la production méticuleuse, la patine intello/arty : tout ça relève d’une approche – pas d’un répertoire, je souligne – plus comparable à celle qu’ont par moments adoptée les Pixies ou même les Talking Heads, qu’à celle de MBV, de Pavement ou des Drop Nineteens. La comparaison la plus évidente est à faire avec les Américains Mercury Rev, dont j’avais adoré le premier album avant de (sans raison précise) ne plus jamais les écouter. C’est la même approche du psychédélisme, mi-effondrée, mi-méthodique, avec du côté des Irlandais un souci de ne pas s’enfoncer trop dans le marasme lysergique pour préférer tourner les pages du livre sacré de la musique hallucinatoire – en cela, Rollerskate Skinny fait d’ailleurs partie de la grande famille du record collector’s rock dont parlait la presse anglaise dès les années 80, notamment, si je ne me trompe, au sujet de Primal Scream, Jesus & Mary Chain ou Spacemen 3.
Voilà, je ne sais pas très bien où je voulais en venir en vous parlant de ces garçons. Est-ce qu’ils peuvent être pris comme des voisins de ce que certains ont appelé la « Lost Generation », Seefeel, Pram, Earwing/Insides, Moonshake, Disco Inferno ? En partie, mais en partie seulement, puisqu’ils n’ont d’une part pas cultivé le goût du son lo-fi ou du moins du home-studio, et qu’en dépit des libertés prises avec le format rock Shoulder Voices reste à peu près guidé par le chant et la construction couplet-refrain, avec un usage de l’électronique surtout ornemental, quoique brillant. Ce n’est donc pas non plus, malgré la présence du groupe à l’affiche du Lollapalooza aux côtés des Smashing Pumpkins, des Breeders, de Guided By Voices, ou de Girls Against Boys, une réponse irlandaise à l’alternative rock américain, en général moins oblique et disons, moins sophistiqué que leur musique. Le groupe sortira un second album en 1996 avant de se séparer, ses membres allant continuer à jouer pour d’autres formations dont je n’ai jamais entendu parler avant de regarder sur Discogs : Kid Silver, August Wells, Empire (devenu The Radio, ça valait le coup de changer de nom) et The Wounded Knee avec une ex-membre de Mercury Rev (ah bah voilà on y arrive). Pour le coup je laisse la place aux jeunes pour me dire lequel de ces projets mérite d’être aujourd’hui redécouvert. Et je vous quitte en me disant que c’est une curieuse expérience de re-rencontrer un album à quarante ans alors qu’on pensait l’avoir bien connu, voire bien compris, vingt-cinq ans plus tôt. Bisous à tous, et surtout à Christian.




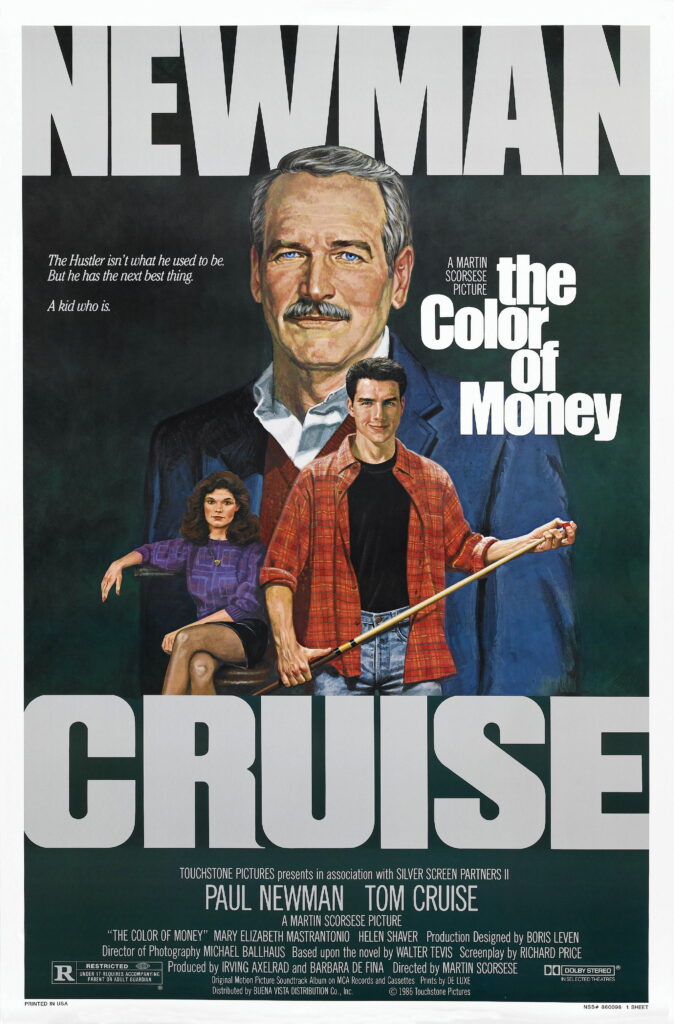
2 commentaires
« je l’avais en effet beaucoup aimé, sans aller jusqu’à me le procurer »
Voilà, c’est le moment présent qui se résume ici à tout jamais. J’en pleure.
mais non c’est parce que j’avais pas d’argent pour me l’acheter ! je devais m’acheter maximum trois disques par mois à l’époque, j’étais au lycée.