Beaucoup de gens sont fans de Stevie Wonder, ça on le sait, mais j’ai remarqué qu’il y avait aussi beaucoup de gens qui n’aimaient pas du tout sa musique, voire qui la méprisaient. Je l’ai remarqué car j’ai fait partie de cette engeance dans ma jeunesse, jusqu’à ce qu’à travers l’une de ses chansons je découvre et comprenne le génie de Stevie – ou plutôt jusqu’à ce que ce génie accepte de se révéler à moi, puisque c’est le mot, littéralement une “révélation”, ce n’est pas une métaphore, c’est ainsi que ça s’est passé, j’ai été soudain habité par sa vision, qui n’est d’ailleurs pas la sienne au sens subjectif mais plutôt une connexion cosmique miraculeuse dont il est à la fois le sujet et le relais, le routeur.
La particularité de cette révélation, c’est qu’elle ne m’a pas fait embrasser l’ensemble de l’œuvre de Wonder, puisque je continue toujours d’être saoulé par la majeure partie de sa discographie. Je ne supporte à peu près aucun de ses tubes et même quand je les zappe pour ne me concentrer que sur les non-singles, j’ai du mal à ne pas m’ennuyer, voire à me sentir irrité en écoutant Talking Book, Innervisions ou Songs of the Key Of Life. C’est un ensemble de choses, il y a d’abord l’omniprésence du clavinet et de l’harmonica, deux instruments dont les sonorités nasales et métalliques peuvent se montrer fort crispantes pour moi, et puis bien souvent il y a cette écriture qui, disons, ne “transcende” pas son abord doucereux, presque gnangnan, et qui reste attachée à sa mission fédératrice, universelle – et ça c’est un pouvoir dont Stevie a tout de suite compris l’importance, il a visiblement toujours adressé sa musique à tout le monde, il est très Top 40 et s’en fiche des esthètes. Je respecte voire j’admire cette démarche démocratique mais elle a produit des résultats – “Superstition”, “Living For The City”, “I Wish”, “I Just Want To Say I Love You”, “As”, “Isn’t She Lovely”, “Happy Birthday”, etc – qui hélas ne me parlent pas du tout. Je suis sûr que des neuromusicologues pourraient expliquer pourquoi tel type de mélodies et tel genre de sons peuvent émouvoir ou déplaire à tel ou tel cerveau, et je ne suis donc pas en train de prendre position “objectivement” sur la qualité de ces chansons qui encore aujourd’hui passent tous les jours à la radio et ont été récompensées d’innombrables fois – trois Grammy d’affilée dans la catégorie meilleur album en 1972, 1973, 1974, si bien que lorsqu’en 1975 Paul Simon a été honoré à son tour il a dit en recevant son trophée qu’il remerciait Stevie Wonder de ne pas avoir sorti d’album cette année-là. Je dis juste que la partie émergée de l’iceberg ne laisse pas forcément soupçonner que les “deep cuts” soient aussi magiques.
Je me fais d’ailleurs une remarque au passage, c’est que contrairement à la plupart des autres “monstres” comme Dylan, Marvin Gaye, Bowie, Michael ou Prince, Stevie a eu la particularité de ne pas donner trop d’importance à son image, à son personnage. Son storytelling est resté plutôt basique : un enfant prodige aveugle, d’abord interprète de génie puis émancipé en auteur-compositeur-producteur, qui étend son registre au-delà des chansons d’amour pour parler de la société américaine, de la souffrance des Noirs, de Dieu et de spiritualité. Parce qu’il n’a jamais trop voulu être autre chose qu’un messager-musicien, Wonder a pu mettre en avant tout ce que son génie musical et spirituel lui dictait.
J’ai donc sélectionné, sans forcément y passer trois mois, mais en triant quand même pas mal, une quinzaine de ces deep cuts, dont certains sont en fait relativement connus, bien sûr, par rapport à la plupart des choses dont parle Musique Journal, mais que ceux et celles qui comme moi ont longtemps snobé Stevie devraient découvrir. J’espère que vous vivrez la même extase que moi, et qu’ils vous feront saisir que le chanteur et multi-instrumentiste du Michigan est peut-être le plus grand, ou du moins le plus fréquemment touché par la grâce de tous les artistes de l’ère pop.
La chanson dont je parlais plus haut, qui m’a révélé à la musique de Stevie, et où il se présente plus ou moins en théologue de la libération, s’appelle “Heaven is 10 Zillion Light Years Away”. Elle m’avait bouleversé parce qu’elle aborde la distance qui nous sépare des cieux ainsi que la solitude de nous autres, déchets vivants des caprices démiurgiques (je me comprends), mais qu’à ses amis qui se lamentent de tout ça Wonder, lui, répond que le divin n’est pas si loin, au contraire pour lui Dieu est là, à l’intérieur de lui, il peut le sentir dans son cœur, sentir vibrer son esprit, et justement à ce moment-là la musique elle-même prouve ses dires, puisque la mélodie change de tonalité et qu’arrivent des claps et des chœurs tellement INCROYABLES qu’on ne peut que le croire, et croire en l’existence d’une puissance céleste descendue sur Terre, sous forme musicale. J’ai compris aussi à ce moment-là ce que les gens entendaient que je n’entendais pas dans sa musique, cette façon de faire résonner le divin dans sa voix et son écriture, une manière simple et presque didactique, mais qui produit des constructions plus complexes que la chanson pop moyenne, proches du gospel ou du songwriting orchestral de l’entre-deux-guerres à la Gershwin, une musique religieuse et populaire, destinée au départ aux Afro-Américains mais que d’autres personnes peuvent, je pense, tout aussi bien recevoir.
À partir de là, j’ai régulièrement eu des coups de foudre pour d’autres chansons, et ce qui est bien avec lui c’est que c’est varié puisque sa carrière s’étend sur un demi-siècle. Vous aurez néanmoins compris que le Stevie que j’aime est celui des compos sophistiquées, des lignes de chant qui prennent une couleur différente à chaque putain de nouvelle note, des voix doublées voire soumises par des arrangements avant-gardistes souvent synthétiques, des mélodies à la fois évidentes et retorses qui, lorsqu’on réussit à les fredonner avec lui, donnent l’impression d’avoir plié la Nouvelle Star et The Voice le même soir – y a Zazie qui pleure, Manoukian est à genoux, Pagny claque sa plus belle moue virile, et puis Sinclair est reparti chez lui en trottinette.
Je vous laisse les découvrir et les aimer à votre façon, mais je précise quand même deux ou trois choses plus ou moins importantes. En choisissant les titres de cette sélection, je me suis dit que je ne pouvais pas mettre “I Don’t Know Why I Love You” parce qu’elle était trop connue, mais en fait je me suis rendu compte que c’était surtout que mon ami et collègue François Chaperon avait dû la passer environ 400 fois depuis que nous travaillons dans le même open-space. Donc je ne sais plus trop si c’est un vrai standard de Stevie ou non, mais en tout cas c’est pour moi un classique personnel, repris par les Jackson 5 un an plus tard en 1970 – Michael est mignon dessus, mais bon la version de Stevie est mille fois plus forte, bien sûr. “Tuesday Heartbreak” me fait énormément penser à deux de mes chansons préférées de Prince, “Ballad of Dorothy Parker” et “Raspberry Beret”, dans la mélodie mais aussi dans le son très clean. Les arrangements font ce truc que j’adore, c’est qu’ils ne font pas qu’accompagner la voix, ils la bousculent et l’embrassent en même temps, c’est trop beau. “Visions” a été samplé par Timbaland sur le premier album de Ginuwine, et contrairement à pas mal de tentatives catastrophiques de samples de Stevie, le résultat qui s’appelle « I’ll Do Anything » est selon moi une des meilleures prods de Timbo, triste et lascive à la fois. “Village Ghetto Land” est une satire de la vie des classes populaires noires-américaines, où Stevie s’accompagne d’un synthé à trois claviers, le Yamaha GX-1, qu’il appelait la “Dream Machine” – je parle de ça pour rappeler qu’en dépit de ses allures un peu tradi mainstream, Wonder était un gros technophile. “All I Do” a été très mal samplée deux fois, la même année (1996), par deux artistes house de Chicago que je ne citerai pas mais qui devraient avoir honte, enfin bref, que cela ne vous fasse pas oublier la performance d’un autre monde de Stevie au micro, qui fait vraiment son Stevie à base de vibrato (où est-ce du tremolo ?) dans tous les sens mais qui malgré ça signe une de ses mélodies les plus inoubliables, pleine de nuances coquines et de voluptueuses fluctuations, c’est vraiment la Terre et le Ciel qui se réunissent à chaque fin de phrase. J’ai aussi choisi “Used To Be”, une balade aux textes grinçants en duo avec Charlene, qui montre comment Wonder infiltrait les formats les plus mainstream et familiaux de la pop américaine pour dire des trucs pas du tout feel-good. Pour finir, j’ai forcément mis “Queen In The Black”, extrait de la B.O. de Jungle Fever de Spike Lee (1992), qui pour moi fait beaucoup mieux que tardivement suivre la mode new jack puisque j’y entend ni plus ni moins une préfiguration du 2-step anglais – ou en tout cas un clin d’œil au garage du New Jersey.
Voilà, je vous invite donc à explorer ce corpus alternatif qui n’apprendra rien aux connaisseurs de Stevie Wonder, mais qui permettra aux profanes et aux haters paresseux de revenir dans le droit chemin – et qui accessoirement les empêchera d’écouter quoi que ce soit d’autre pendant facilement un mois, puisque ces chansons célestes accapareront sans violence tout le champ de leur désir musical.



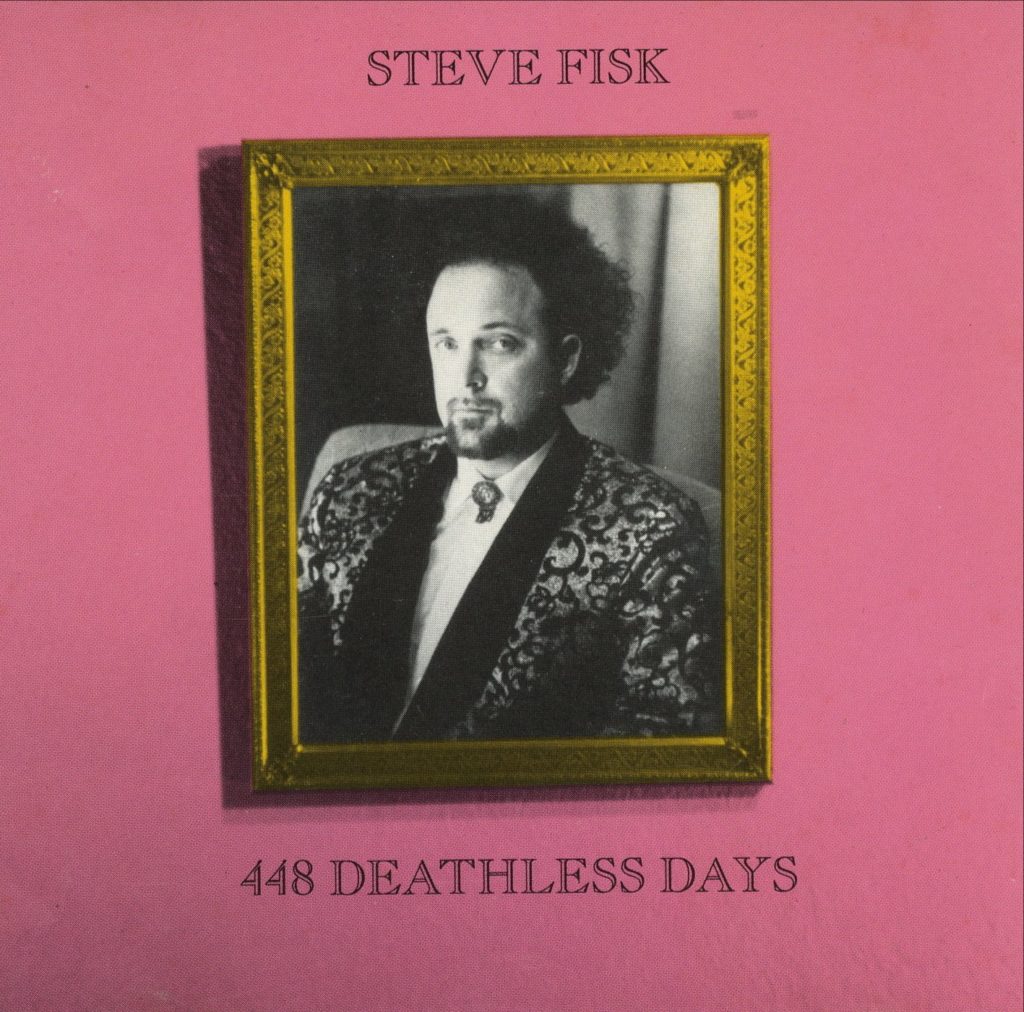

2 commentaires
Bonjour Etienne, très bonne playlist qui fait en effet découvrir un aspect nettement moins connu de Wonder, que ses habituels tubes ressassés par les Gold. Bravo ! Hervé
Merci Hervé !