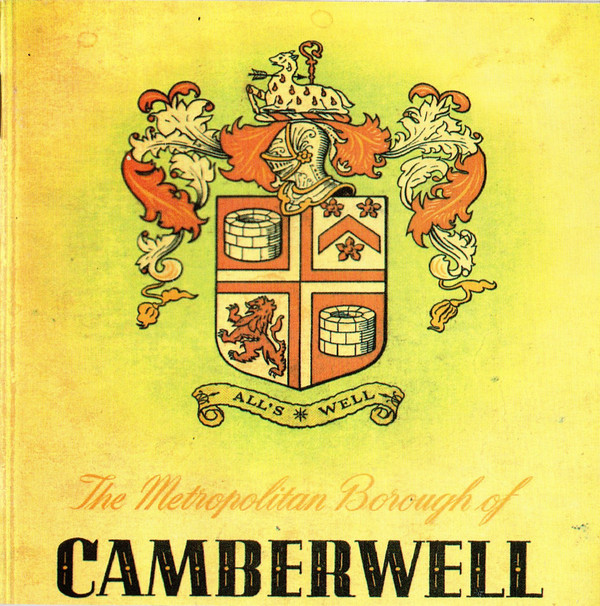Lors du retour en grâce du postpunk, il y a environ quinze ans, This Heat n’a pas été exactement le groupe le plus plagié par le jeune génération, comme ont pu l’être, par exemple, Gang Of Four, PiL, ou les Talking Heads. Sans doute parce que le trio formé de Gareth Williams, Charles Bullen et Charles Hayward ne s’intéressait que partiellement au songwriting et qu’il envisageait surtout son travail comme une sorte de dispositif de combat mental, aussi esthétique que politique. Aussi parce qu’il concevait peut-être la scène comme aussi importante, sinon plus importante que l’enregistrement : on sait que leurs performances ultra agressives avaient parlé au public des squats où il jouaient, alors qu’ils ne venaient pas directement du punk. Hayward était déjà un batteur aguerri à la fin des années 70 puisqu’il avait brièvement été dans Gong et dans un groupe prog, Quiet Sun, avec Phil Manzanera (futur Roxy Music). On sent dès le premier disque éponyme de This Heat, pourtant moins articulé par rapport au second, Deceit, le geste d’un « vrai musicien » malgré le chaos. C’est un geste qui se joue d’ailleurs moins dans la technique pure que dans le jeu avec les bandes et les façons de fabriquer les morceaux – il y a du bruit, des espaces pas prévus, un rapport très spécial et souvent désorientant aux dimensions du son. Et quand Hayward se met à chanter voire à suivre certaines lignes mélodiques, on entend alors beaucoup plus les échos de Soft Machine et de Canterbury que ceux de John Lydon.
Alors ce n’est qu’à moitié surprenant de voir qu’après la séparation du trio, chacun de ses membres ont poursuivi vers des voies un peu moins radicales, ou disons plus proches du format court et de l’idée de composition – bien que nuancées d’un tas de réserves. D’abord il y a Gareth Williams, qui a signé avec Mary Currie en 1985 ce disque fou, depuis réédité par Blackest Ever Black : Flaming Tunes, dont Hervé a déjà parlé brièvement. Et puis il y a aussi eu Lifetones, le projet du premier Charles, Bullen, un multi-instrumentiste passionné de dub et de reggae, qui s’était associé à un Jamaïcain du nom de Julius Samuels alias Dub Judah. Ils n’ont fait qu’un album, mais mes amis, quel album ! La première fois que je l’ai entendu – chez mon ami Christian, lorsqu’il vivait encore en France –, j’avais été à la fois enchanté comme on peut l’être en découvrant un classique instantané et, en même temps, fasciné par toutes les choses pas du tout censées s’harmoniser qu’il réussissait à concilier. Comment dire ? Même quand les morceaux avancent a priori comme du reggae (sur un titre sur deux, en gros), on finit vite par ne plus vraiment entendre le skank tellement il est déplacé loin de son habitat naturel. Il sert autre chose : ça peut être des arpèges de guitares qui sonnent limite comme du Felt, des synthés oscillants, vaporisés çà et là, et puis cette façon très postpunk, pour le coup, d’être plus dubiste que le dub dans la production. Et il y a surtout ce choix hyper audacieux, de la part de Bullen, de chanter sur tous les morceaux avec sa voix d’Anglais qu’on devine un peu ronchon, mais sensible. Ça contraste fort avec le souffle du disque, son odeur de plein-air, sa promesse de paysages subjuguants pour nous, êtres humains, mais qui nous appellent à les parcourir. On entend aussi des influences asiatiques ou moyen-orientales, en fait c’est, on peut le dire, un disque « Fourth World », mais avec un toucher nerveux, pas vraiment sympa, même s’il saura sans aucun doute vous parler de sa langue bien à lui. Ce sont des chansons faites avec une palette dont on n’a pas l’habitude, mais ce sont quand même de vraies chansons, et bien souvent inoubliables : je pense en particulier à « Good Side », le « tube », et « Decide », qui ressemble vraiment un rêve humide de lecteur de The Wire, en combinant mélodies à la YMO, basses à la Can et vertiges dub à coups de mélodica dans des bathyscaphes, le tout avec ce génie anglais pour faire sonner les choses comme une petite miniature fabriquée dans un atelier au fond du jardin, un incroyable mobile qui apparaît sous nos yeux et qu’on regarde pendant des heures (dix ans plus tard, Pram seront les meilleurs pour réussir ça). Bref, même si ce For A Reason est une sorte de disque adoré des connoisseurs, je me permets de vous le recommander si vous n’avez pas encore eu le chance de l’entendre – et franchement, je vous le garantis, c’est dur de le trouver juste « pas mal ».
L’autre disque dont je veux parler est sans doute moins chatoyant, pour ne pas dire moins feelgood que celui de Lifetones, mais il me plaît tout autant par sa façon de mêler les styles et les climats. On y entend aussi, quoique plus lointainement et plus froidement, une ambiance aquatique, ou plutôt maritime, avec l’usage là aussi du mélodica mais un mélodica qui sonne ici bien peu jamaïcain : c’est plus une corne de brume sur un littoral britannique. Il y a également beaucoup d’effets d’espace, et la claustrophobie, l’étouffement qui marquait l’œuvre de This Heat se dissipe au profit de quelque chose de pas tout à fait apaisé, mais disons de moins urgent. The Camberwell Now a été pour Charles Hayward le premier projet d’une longue discographie post-This Heat, une formation plus « pop » même si on est encore très loin des charts. Le batteur avait recruté un excellent bassiste, Trevor Goronwy (qui avait déjà brièvement joué avec lui dans This Heat), et un technicien radio, Steve Rickard, qui avait mis au point une sorte de proto-sampler. Cette machine artisanale donne aux morceaux de Camberwell Now une dimension altérée, mais pas high-tech : c’est une intervention censée avant tout troubler et complexifier la matière plus que la faire sonner plus « futur ». Et j’apprécie beaucoup cette façon d’essayer des choses, finalement très « novatrice », cette approche expérimentale qui se déroule en direct, dans nos oreilles, un mélange d’énergie punk ou postpunk et de pensée méta qui se la raconte pas, de collage contre-intuitif et d’envolées mélodiques d’une grâce qui ne dit pas son nom, de décharge psychique obtuse et de grooves très physiques, presque athlétiques (qui rappellent tout un son typique du prog un peu sportif des années 80/90, mais sans l’emphase). Ça sonne parfois comme d’héroïques jam sessions pour gauchistes en descente, parfois comme des balades traditionnelles anglaises produites par le club MAO de la mairie. Comme Bullen chez Lifetones, Hayward n’hésite pas à poser sa voix d’Anglais, elle un peu plus sourde que celle de son ancien acolyte, au milieu des tumultes météorologiques qui traversent ses compositions. D’ailleurs, c’est curieux comme on le sent vraiment bien là, bien présent, plein de colère et de désespoir, et qu’en même temps on devine qu’il n’a peut-être pas non plus envie d’être trop au centre, au contraire d’un banal protest-singer narcissique qui gagne de l’admiration (voire du fric) en l’échange de ses plaintes. Il laisse de longues plages instrumentales, aménage des dialogues entre les différentes parties des morceaux, donne aux sons le temps de ne pas être que décoratifs ou « significatifs ». Ce n’est pas un disque parfait, d’ailleurs Hayward précise lui-même dans cet entretien qu’il réunit des titres faits à différentes périodes, avec différentes idées en tête. Mais on y trouve énormément de moments qui offrent un ressenti qu’on ne trouve nulle part ailleurs, une couleur entre le vert bouteille et le taupe, le bleu-gris et l’orangé, je ne sais pas trop comment dire : c’est une façon de ne pas laisser l’humilité virer au misérabilisme et ne pas faire basculer le lyrisme vers la grandiloquence. Une manière, finalement, d’éviter d’être pesant mais de ne jamais quitter le cœur tragique de son propos et de ses émotions.