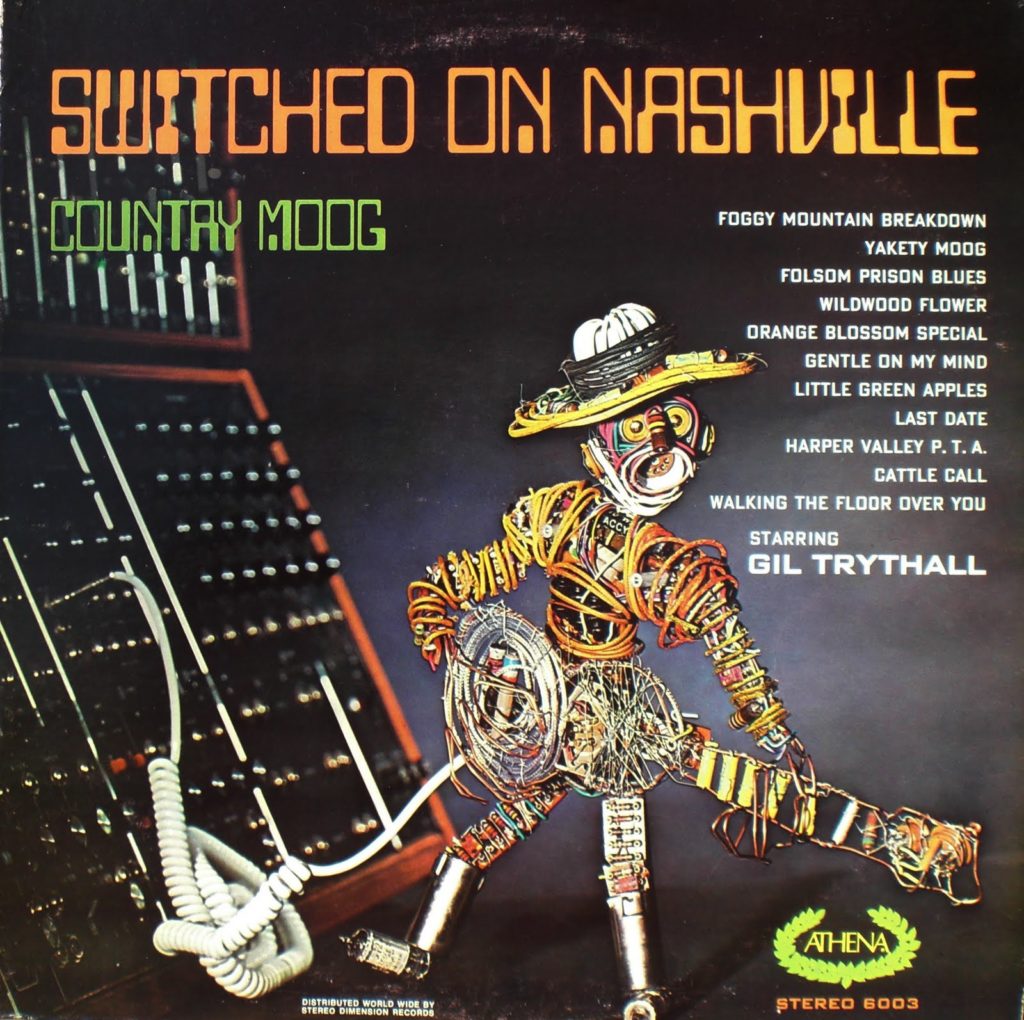On se rappelle au début des années 2010 l’espèce de “retour” de la house, notamment dans la scène anglaise dite post-dubstep, ainsi que dans le sillage de la UK funky, également branché sur les sons footwork, mais aussi un peu venu de la nu-disco, de la minimale ou de la tech-house. Disclosure, Julio Bashmore, Blawan, Jamie Jones, Art Department, j’en oublie beaucoup mais il y avait un rush sur le 4/4 souple et fluide de la house, ce que je trouvais super, personnellement, après des années un peu pauvres en termes d’évidence du groove. Mais à la même époque, on sait moins, voire on ne sait carrément pas du tout que s’est développée une autre scène house à Londres (et un peu dans les Midlands aussi), et c’est ce que racontent deux très longs textes publiés ces derniers mois. Le premier m’a été envoyé par Valeria et c’est une lettre du producteur Rosh adressée à Resident Advisor. Le second m’a été transmis par Krampf et c’est un récit analytique du journaliste et producteur Jake Colvin. La scène que décrivent Rosh et Colvin est véritablement underground, et elle l’est manifestement restée jusqu’à disparaître : elle était connue sous le nom de “deep tech” ou de « hood house » (un terme que les artistes n’ont pas tous validé, y voyant une tonalité possiblement raciste ou classiste) , et marquée par la pratique intensive de cette danse géniale qu’on appelle le shuffle. Une scène juvénile et dynamique que les médias britanniques n’ont quasiment pas abordée, pour des raisons qui sont détaillées dans ces deux textes et qui montrent en tout cas qu’on a beau dire qu’aujourd’hui, « avec Internet », tout le monde à accès à tout, eh bien en fait, il y a encore et toujours des choses hyper importantes qui se passent, sans que les gens censés être au courant soient au courant.
Je parlais l’autre jour de la réécriture par Matt Anniss de la préhistoire de la house et de la techno britannique dans les années 80. Le cas de la scène deep tech, plus récente, est à la fois similaire et différent. Similaire parce qu’il s’agit là aussi d’une population majoritairement noire et working class, mais différente parce que cette population vient de Londres (comme sa « concurrente » alors plus couverte par les médias), et non du Yorkshire ou d’un autre coin du Nord de la Grande-Bretagne. Différente aussi parce que le son hood house n’est pas aussi avant-gardiste que celui du bleep, mais qu’en revanche il fait partie de ces musiques avant tout faites pour les danseurs, comme le logobi ou le footwork. D’où son aspect assez réglementé : les structures se ressemblent pas mal, les couleurs sont plutôt uniformes d’un track sur l’autre, on sent qu’il y a des codes et des presets parfois très “tech-house de Beatport” qui s’articulent à la base plus hardcore continuum (pas mal de producteurs venaient de la UK funky ou de la bassline) qui définit l’ensemble, avec des beats qui restent droits mais une grosse présence de la basse – des basses qui comme le dit Jake Colvin assument des fonctions à la fois rythmiques et mélodiques. En résumé, ce n’est pas de la house orientée “auteur”, comme pouvait l’être la house à la Bashmore ou Disclosure de la même époque, même si on y entend tout de même pas mal d’inventions soniques distinctes, notamment dans le couplage des samples de voix découpées et des sections rythmiques.
Mais du coup, est-ce que cette house on ne peut plus harnachée à la danse et à l’environnement du club n’est au fond pas plus radicale que la house d’auteur ? Et surtout, est-ce que ce qui compte vraiment, plus que la musique seule, ne serait pas cette danse qu’est le shuffle ? Une danse qui a l’air d’être un moyen d’expression totalement vital pour celles et ceux qui la pratiquent et qu’on voit bouger et parler dans ce documentaire vachement émouvant de 2014. Quand on y pense, on peut se dire qu’on s’en fout que cette musique sonne plate quand on la compare aux “pépites pour connaisseurs”, connaisseurs qui comme moi écoutent les tracks au casque, assis devant leur ordi avec un petit air méfiant voire inquisiteur. Ce qui compte, c’est que cette musique fasse son boulot, qu’elle “fonctionne” au sens corporel, et que les danseurs.ses la trouvent digne de leurs figures, leurs shapes, ces gestes des bras et des jambes exécutés sur les kicks, les basses et les charleys. Et ça pose cette question taboue aux intellos de la dance music dont je fais partie : est-ce qu’un bijou de la house ou de la techno, au sens d’un morceau qu’on écoute et réécoute et dont on kiffe intensément et intérieurement les nuances et les audaces, est pour autant un bon morceau à danser, pour les gens qui dansent vraiment, comme les shufflers, les logobi, ou même les “house dancers”, ou les gens de la tecktonic. Et est-ce qu’en fait la vraie bonne dance music n’est pas tout simplement celle qui épouse le mieux les désirs de ses danseurs ? Je sais que les enjeux ne sont pas aussi manichéens, vrai/faux, bon/mauvais, mais si je force le trait c’est parce que je crois que ce sont des problèmes qu’on ne soulève jamais dans les conversations sur tout ça, alors qu’on a par ailleurs des discussions très riches et très diverses sur la dance music en France aujourd’hui.
Ce que raconte aussi l’article, et ce qui est à la fois triste et flippant, c’est que les shufflers ont peu à peu été ostracisés de la plupart des clubs où ils allaient danser. Parce qu’ils occupaient davantage d’espace (puisque c’est compliqué de claquer des shapes avec des gens à moins d’un mètre de vous, et que forcément ça modifie la densité de population en soirées), et qu’ils réduisaient donc le nombre de clients potentiels, mais aussi parce qu’ils étaient pas tout à fait assez chic au goût des tenanciers. Sympa l’ambiance ! Je me demande au delà de ça si la relative ignorance du mouvement par la presse anglaise spécialisée ne vient pas aussi d’un rejet esthétique qui aurait consisté à mépriser les références trop tech-house/Beatport de la langue hood house. C’est vrai qu’un esthète du 4/4 fabriqué sur-mesure ne va trouver pas son compte à chaque mesure d’un track de Mark Radford ou de Lee « B3 » Edwards : comme je le disais, ça peut sonner trop commun à ses oreilles d’élite. Mais en même temps, c’est normal qu’il ne capte pas, puisque ça ne s’adresse pas à lui : il ne danse pas, ou du moins il ne shuffle pas.
L’article de Jake Colvin, qui se fonde sur une longue interview avec Sean Von Piff, DJ et activiste de la scène deep tech, observe que celle-ci s’est peu à peu dissoute dans l’écosystème de la « vraie » tech-house commerciale, vers 2016. En qu’en gros, les producteurs et les DJ se sont résignés à adhérer à ce son plus mainstream/Ibiza-compatible parce qu’ils en avaient marre de développer leur son à eux sans que personne n’en parle et, donc, sans pouvoir en vivre à long terme (même s’ils avaient quand même des résidences régulières dans quelques clubs dédiés, comme le Club65 à Vauxhall, des endroits ouverts en continu le weekend comme a pu l’être la Concrete). Mais je vous laisse donc aller découvrir cette musique, cette danse, ce documentaire fantastique et ces articles hyper passionnés et hyper documentés, qui me font une fois encore réfléchir à la façon dont on raconte l’histoire de ces scènes, et à la manière dont je me positionne moi-même en tant qu’observateur et amateur. Et je me dis qu’en France il faudra bien qu’un jour on raconte sérieusement ce qui s’est passé avec la tecktonic et le logobi !