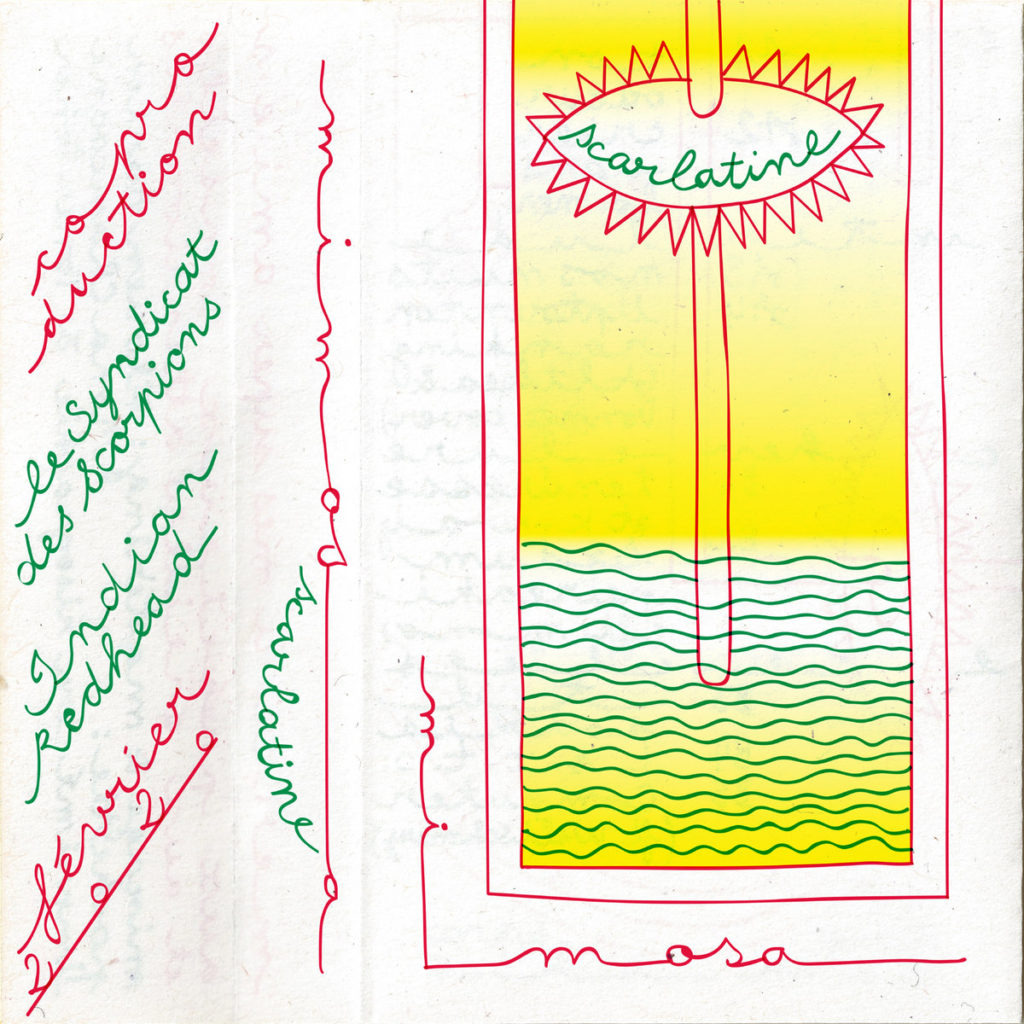En août dernier, l’édito de Wire évoquait Jana Rush, une productrice issue de la scène house/footwork de Chicago, interviewée dans le numéro à l’occasion de son nouvel album sorti sur Planet Mu, qui est hyper bien. Le rédacteur en chef du magazine britannique, Derek Walmsley, relevait entre autres que la musicienne avait suivi il y a quelques années un cours d’introduction aux rythmiques jazz, que cet apprentissage l’avait inspirée et fait prendre conscience des traits communs entre cette musique et la sienne, et qu’elle avait donc samplé du jazz dans quelques-uns de ses morceaux. Ce qui m’a bien plu, c’est que Walmsley poursuivait en citant des exemples de morceaux de jazz dont le drumming particulièrement intense et spectaculaire aurait pu annoncer les patterns intriqués du footwork. Je suis donc allé écouter les titres en question et je dois dire que même si j’ai trouvé son rapprochement un petit peu excessif (mais je ne lui jetterai pas la pierre, étant moi-même amateur de comparaisons abusives juste pour la beauté de l’image), ça m’a permis avant tout, eh bien, d’écouter du vrai jazz et d’aimer vraiment ça, en dissipant comme par miracle la plupart des clichés pénibles que j’ai depuis longtemps associés à cette musique, à son histoire et à la sociologie de son public en France.
La sélection de Derek puise essentiellement dans le répertoire hard-bop, qui si vous ne le savez pas est un style consécutif du be-bop, né au cours des années 1950 et qui, sans être officiellement en opposition avec le jazz cool et/ou West Coast de la même époque, s’en distinguait néanmoins presque en tous points. En gros c’est de la musique très agitée, qui virevolte et qui bouscule, où le sentiment d’urgence est littéralement palpable, palpable presque matériellement, surtout dans ses phrases de batterie et son flux rythmique effréné. Les grands batteurs de cette époque s’appelaient Art Blakey, Max Roach (les deux « auteurs » comme le dit Walmsley), et puis aussi les deux Jones, Elvin et Philly Joe (qui ne sont pas frères mais qui en revanche feront un album ensemble), et enfin plusieurs profils de gens plus sidemen comme Jimmy Cobb, Art Taylor ou Billy Higgins, tous complètement fantastiques, du genre « Mind : blown », neurones fracassés, surcharge sensorielle.
Vous les entendrez sur cette playlist dans l’ordre suivant :
- Philly Joe Jones
2. Louis Hayes
3. Elvin Jones
4. Billy Higgins
5. Louis Hayes
6. Philly Joe Jones
7. Jimmy Cobb
8. Billy Higgins
9. Art Taylor
10. Louis Hayes
11. Art Taylor
12. Art Blakey
13. Max Roach
Je crois que la chose que j’ai pour la première fois saisie en bonne et due forme au sujet du « vrai » jazz, en écoutant ces plages conseillées par Walmsley (ainsi que d’autres que j’ai découvertes au passage), c’est l’enchevêtrement des voix et, dans les cas que j’ai sélectionnés, la façon que la batterie a bien souvent d’embarquer les autres instruments, d’abord pour les dompter, puis pour les exciter, puis pour les redompter (c’est à peu près la méthode que l’on m’a conseillé d’employer avec mon chien Stanley qui a six mois depuis la semaine dernière). Avant même qu’il y ait des vrais solos de batterie, j’entends déjà les cymbales et les charleys fabriquer de la matière et du volume au sens géologique du terme, on dirait que les motifs qui s’enchaînent produisent du relief, ça chante et ça frémit en même temps, il y a des petits monticules de son, des stalactites ou des stalagmites, des dunes sous la tempête, c’est vraiment quelque chose, au propre comme au figuré. Ça ressemble autant à du son sculpté qu’à un simple marquage rythmique : les cuivres et les pianos essaient de faire avec, ils se rebiffent ou font genre ils obéissent, bref on sait qu’il y a dans la critique jazz de daron français habitant Malakoff et fréquentant vraiment trop les cavistes (aka : moi dans vingt ans) toute une tradition de métaphores plus ou moins rincées pour parler de ce dialogue entre zicos qui fait la base de ce jazz mouvementé, mais je ne vais pas m’y attarder pour le moment. Je veux juste dire que ce qui m’a frappé dans tous ces enregistrements de hard-bop c’est la part de bruit et de fracas concret, on sent qu’il n’y a pas trop la place pour tout le monde, et pourtant tout ça tient ensemble le temps du morceau. Et je n’avais jamais trop perçu la dimension « objet » de cette musique, la réalité si audible de ses instruments et de son jeu. On ne peut clairement pas dire que les gars cherchent à sublimer leurs toms ou leurs anches, ils sont surtout occupés à s’écouter les uns les autres sans convulser et à arriver au bout de leur session.
L’atonalité de certains plans de piano et de cuivres intensifie cet atmosphère pleine d’objets et de frictions, tout en laissant de l’espace aux batteurs pour tester des patterns et des fantaisies, qui souvent peuvent annoncer des sons qui émergeront trente ou quarante ans plus tard. C’est Slikk Tim aka Gary Gritness aka Morris Mobley qui m’a rappelé l’an dernier tout ce que devaient à ce jazz les grands noms de la jungle circa 1995, soit à son époque la plus sophistiquée en termes de polyrythmie, avec J. Majik, Photek, Source Direct, Lemon D, Dillinja, Dom & Roland, Danny Breaks, etc, tous ces producteurs hyper techniques qui trituraient des patterns sur Cubase en fumant de la skunk ultra obsédante. Et en effet, cette jungle de 1995 est sans doute la seule vraie « disciple » de ce speed jazz, plus que le rap ou la house qui certes se réclament eux aussi du jazz, mais de manière peut-être plus symbolique, voire touristique si j’ose dire.
Au hasard, essayez de suivre le propos d’Art Taylor sur l’avant-dernier titre de la playlist, où il « accompagne » Lou Donaldson et Donald Byrd, ou celui de Louis Hayes derrière Horace Silver, ou encore celui d’Elvin Jones en transe avec le trompettiste et cornettiste Thad Jones (qui pour le coup est vraiment son frère) : on envoie très vite par dessus bord l’idée cliché qu’on se fait de la base ternaire de la batterie jazz (« tssi-tssi-tssi », « tiditiditidi », c’est dur à retranscrire), les segments deviennent tout de suite plus serrés, il y a des intrigues internes, qui s’arrêtent subitement puis reprennent plus tard sans raison, il y a des glissades, des coups de fouet, des portes qu’on ferme de force, des articulations tellement folles et des angles tellement aigus qu’ils frôlent la mort, et parfois on ne sait plus si c’est vraiment quelqu’un d’humain avec des capacités humaines normales qui joue, ou si la batterie n’est pas en train de jouer toute seule. En ça, on peut d’ailleurs avancer que contrairement à ce que dit le cliché horrible, ces musiciens n’ont pas du tout « le rythme dans la peau » : il y a du rythme, ça ok, mais c’est impossible de dire où ce rythme se trouve, si ce n’est partout, sauf à l’intérieur d’eux et de leur peau. Le rythme est dehors, dans l’espace de la musique, immiscé dans les phrases jouées par les autres instrumentistes et aussi dans les silences, évidemment, qui ici sont brefs mais cruciaux pour établir cette narration sans histoire définie, cette improvisation de sculpture sonore sur des matières et des formes qui n’ont a priori pas tellement d’autre vocation que d’être activées au sein de ces longues phases de précipitation et de cavalcade. Et je dois avouer qu’en réécoutant tout ça, je comprends aussi un truc qui m’avait échappé jusqu’ici, c’est la violente modernité de cette musique pour l’époque (et avant elle, celle du be-bop), son côté anti-détente et anti-confortable, le degré non pas d’exigence mais disons de stimulation pour l’auditeur de jazz radiogénique, qui est emmené beaucoup plus loin que son expérience habituelle d’écoute pépère façon thème/solo, et qui se retrouve parachuté dans une frénésie certes parfaitement exécutée mais qui devait néanmoins bouleverser les repères du quidam qu’il était en général, comme le faisaient à la même époque certains peintres et poètes modernistes.
Voilà, je crois que je n’ai pas trop honte d’admettre que j’écoute ces morceaux en bougeant la tête comme l’ont fait avant moi des milliers d’hommes blancs « mordus de jazz » : ça devait bien arriver un jour. Mais ce par chance qui dissipe cette gêne, c’est qu’au-delà du plaisir rythmique, je parviens en me plongeant dans ces incroyables enregistrements à écouter enfin le reste, les trompettes et les basses et les pianos, les saxos de différentes tailles et même parfois le trombone de Julian Priester qui, longtemps après, bossera avec Herbie Hancock et fera deux disques solo de jazz-funk très spatial chez ECM. On découvre les gens autour d’eux parce qu’en réalité, ces batteurs de génie jouent toujours pour le collectif, ils ne se paluchent jamais sur leur propre virtuosité, et (à part quand des artistes plus jeunes se mettent, plusieurs décennies après, à les sampler pour en faire des loops) je pense qu’ils envisageaient rarement leur pratique selon un horizon « solo », même si, oui, ils n’hésitaient pas à « prendre leur solo » une fois que ces frimeurs de pianistes ou de saxophonistes avaient paradé.
Je termine en vous invitant d’une part à m’excuser si vous êtes vous-mêmes connaisseur de jazz et que vous trouvez que mes propos et mes choix enfoncent des portes ouvertes, et d’autre part à me suggérer d’autres occurrences de ce speed jazz proto-bruitiste qui, s’il influencera donc pas mal de musiciens des générations suivantes, reste quand même aujourd’hui, plus de soixante ans plus tard, un forme unique, un idiome complètement libre et complètement à part, qui se voulait essentiellement l’image sonore du monde autour de lui, monde qu’il essayait à la fois de montrer et d’inventer, à une époque où, je le rappelle, les Afro-Américains du sud du pays subissaient encore la ségrégation et où les communautés noires aux États-Unis n’avaient à peu près aucune représentation politique en dehors des églises. Une grande et belle musique, donc, mais qui ne se réclame d’aucun « escapisme » ou de résignation par l’art, et qui, il me semble, tire sa valeur primordiale de l’intensité de l’expérience de vie de ses interprètes.