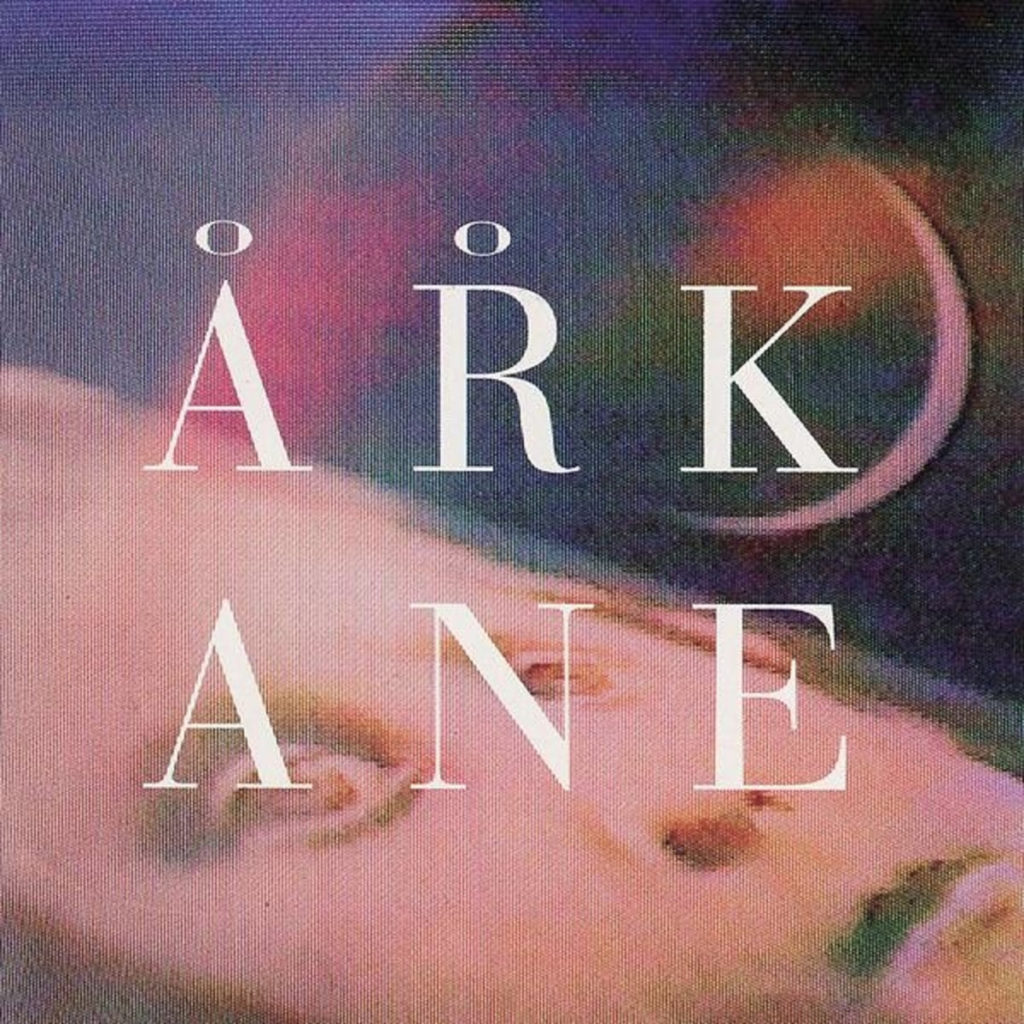Le troisième et dernier album d’A.R. Kane, New Clear Child, a été à sa sortie en 1994 considéré comme un échec. Peut-être qu’on attendait trop de ce groupe, qui doit faire partie des plus fameux groupes oubliés de l’histoire de la pop. Peut-être aussi qu’en 1994 la musique se densifiait tellement en Angleterre, entre le trip-hop, la jungle, la britpop, et j’en passe, que ce disque avait dû passer pour chétif, voire inachevé – ce qui est en partie vrai. Mais surtout, comparé à l’océan des possibles exploré sur les deux précédents LP du duo britannique, 69 (1988) et i (1989), New Clear Child pouvait donner l’impression de se contenter de beaucoup moins : ses matières s’épanchaient très peu, la magie s’y dissipait sans contestation. Mais pourtant aujourd’hui, des trois disques d’A.R. Kane, c’est celui que je réécoute le plus.
C’est en tout cas à peu près impossible de parler de New Clear Child, et à plus forte raison d’expliquer pourquoi il a été mal reçu, sans parler de ses deux prédécesseurs. Je crois que c’est même inconcevable de l’aimer lui, sans les aimer eux. Mais si vous n’avez jamais entendu la musique d’A.R. Kane, vous pourriez essayer de commencer par cet ultime disque : découvrir à rebours l’œuvre de Rudy Tambala et Alex Ayuli ne les scandaliserait peut-être pas, eux qui avaient, à leurs débuts, aussi pris les choses à l’envers. On apprend en effet, dans cette longue et passionnante interview menée par Pascal Bertin chez Vice en 2018, que leur collaboration s’était mise en place après que Rudy eût, un soir de 1986, raconté à quelqu’un qu’Alex et lui faisaient un groupe ensemble, “entre Miles, le Velvet, les Cocteau Twins et Joni Mitchell” – ce qui était donc faux, ou du moins pas encore vrai. Au-delà de ce mytho fondateur, il y a presque tout de suite eu dans les morceaux d’A.R. Kane une ambition démesurée, une volonté d’essayer toutes sortes de formes et de suivre tous les chemins, de parcourir la musique dans ce qu’elle a de plus infini. Une manière très outsider (l’un comme l’autre venaient du quartier populaire de Stratford dans l’est de Londres, et ils étaient noirs, chose à l’époque encore plus rare qu’aujourd’hui dans la scène indie) d’ignorer l’humilité pénible du débutant qui respecte trop ses idoles. Sauf que chez eux, cette attitude ne revenait par pour autant à se prendre pour des artistes qui savent mieux que les autres, ni à se laisser bouffer par la mégalomanie des grands créateurs relous. Leur désir d’embrasser tout ce qu’ils pouvaient allait de pair avec une espèce d’ingénuité, d’ignorance relative de ce qu’ils faisaient, de conscience et d’amour de leurs imperfections, de leurs failles et des failles de leur musique (on va y revenir plus bas).
On a souvent dit à raison qu’A.R. Kane avaient compté parmi les pionniers de la noisy-pop, partiellement inventé le shoegaze et annoncé le post-rock. “Slow” de My Bloody Valentine sonne en effet comme un large pompage de “Baby Milk Snatcher”, même s’il n’est sorti que quatre mois après et qu’on peut laisser le bénéfice du doute à Kevin Shields (mais c’est en tout cas ce que Tambala revendique). Plus généralement, l’esthétique du flottement cultivée par le duo et sa capacité à dessiner des espaces (j’allais dire “sa capacité à créer des espaces”, faut vraiment que j’arrête de mater L’Équipe du Soir) en mouvement, peu soucieux de se figer, fait de leur musique et encore plus de l’écoute de leur musique une expérience immersive et souvent exigeante. On peut évidemment aussi parler du dub qui hante amicalement leurs compositions, de l’influence du Miles Davis seventies (dans l’idée plus que dans le résultat) et du psychédélisme canal non-historique de Can et de Kate Bush (tous deux cités dans cet autre superbe entretien mené par Neil Kulkarni de Wire et Quietus, et dont on a traduit dans Audimat un article sur le reggae voici quelques années). Il y aussi le mélange de silences, d’arrangements synthétiques et de mélodies aux échos enfantins qui faisait toute la beauté de Japan et qui leur a servi de référence. Mais 69 et i sont pourtant le contraire d’une collection de citations pour connaisseurs : ce sont avant tout des albums conçus comme des utopies, des lieux avec des brèches et des zones irrégulières, des courants d’air et des surfaces bancales, des mondes nourris par le rêve, le rêve en tant qu’activité d’invention aléatoire, plus qu’en tant que simple mood – je veux dire que les chansons ne sont pas forcément “rêveuses”. Cette mécanique onirique détermine pour moi l’ensemble de ce qu’ils donnent à entendre dans leurs morceaux, les changements de registre, la fuite de tel ou tel élément, les petites distorsions, les variations de profondeur de champ, le mixage des voix. Le fait que ce ne soit jamais vraiment de la pop parfaite, polie comme une suprême marchandise d’art, et que les chansons déraillent toujours plus ou moins, ou menacent de dérailler, comme dans « Crack Up », un des premiers morceaux de i, pourtant construit sur une ritournelle qui a l’air improvisée, pas faite pour être enregistrée. Quant aux titres moins accrocheurs, ces plages faites de fragments et de flashes par moments obscènes de justesse, ils permettent à l’ensemble de tenir ou plutôt de ne pas tenir, de percer des trouées, de faire naître le vertige au sein des limites imposées par le format album – format d’ailleurs poussé à bout sur i, double CD de 26 morceaux.
On sait que le terme de dream-pop a été proposé par A.R. Kane lors d’une interview, ce qui veut dire que lorsque je parle de “musique onirique” je ne m’appuie pas sur des suppositions infondées mais sur des propos vérifiés. Tambala explique à quel point la dynamique télépathique qui avait vu le jour entre Ayuli et lui tenait du rapport amoureux, d’un lien intime probablement trop intense pour durer. Après le succès de i, Alex est parti aux États-Unis et Rudy a continué à faire de la musique dans son coin, ici et là. En 1992, David Byrne des Talking Heads a sorti sur son label Luaka Bop une anthologie de leurs travaux (jusqu’ici peu dispos aux États-Unis) avant de leur proposer d’enregistrer un nouvel album. Et là, le processus créatif a moins bien marché que cinq ans plus tôt : plutôt que de composer et chanter ensemble, les deux copains ont préféré travailler chacun de leur côté et se soumettre mutuellement leurs idées, avec les désaccords et les frustrations que ça peut provoquer. Le songe s’est ainsi dissipé et ce qu’on entend sur New Clear Child peut donc parfois ressembler à un récit de rêve sans intérêt, à une photo de l’inconscient prise par un Neuralink. Ou à de la musique qui s’est imposée d’évoluer dans un espace prédéfini, avec des portes, des parois : presque de la musique sous verre, sous cloche, qui montre gentiment un échantillon souvenir de ce qu’était sa liberté et ce qui faisait sa beauté si unique. En somme, sous pas mal d’aspects, l’esprit du disque est une contradiction de l’esprit qui avait guidé A.R. Kane à la fin des années 80.
Mais on peut aussi trouver, en écoutant New Clear Child presque trente ans après sa sortie, que cette image figée de l’inspiration océanique (l’imaginaire de l’eau, au sens amniotique comme aquatique, traverse pas mal les textes) du groupe a finalement pris une patine elle-même très particulière. Comme un message laissé au futur, une déclaration inachevée mais nimbée de mystère, et là aussi consciente de ses défauts malgré sa production sans aspérités et la suavité de ses arrangements – qui virent parfois vers la sophistipop, et ce, “pour notre plus grand plaisir”. Ces chansons sont certes plus paisibles et plus tenues, elles disent adieu à l’utopie, explorent moins ce fascinant univers des fissures et de la « pré-création » que Tambala évoque en des termes incroyables auprès de Kulkarni, en proposant à nouveau un néologisme : « We were aware of the necessity of ‘flaws’ in music. These flaws are discontinuities that act as tiny fissures, allowing the dim and distant, diffused gem light of pre-creation to slip thru – it is this that the music existed for – a signpost, a reminder, a note. BTW, that’s a theory. We called it ‘Kaning’ the music. So-called perfect music, whatever genre – aims to remove these flaws, to have a true and complete, finished thing. The flaws leave a space, where the listener can still add something of her own, where she can sit and be.”
Rudy évoque l’expérience d’écoute comme un moment profondément actif et il est incontestable que l’auditeur de la musique d’A.R. Kane, celle des débuts ou celle de la fin, ne peut jamais rester un simple auditeur-observateur passif, il n’a pas d’autre choix que de faire avec le Kaning, avec les béances et les frottements, de chercher à voire briller la défunte « lueur de la gemme ». Les genres se dissolvent et les règles de satisfaction pop sont trop souvent mises en échec pour lui permettre de standardiser et fétichiser son écoute. Et même lorsqu’ils font ce disque « de compromis » qu’est New Clear Child, avec des plages ratées ou insignifiantes, les deux hommes réussissent quand même à injecter dans ces morceaux une surdose de tendresse et de mélancolie, un truc qui fait craquer par dessous le vernis du disque. Mes deux morceaux préférés sont peut-être les deux avec les arrangements les plus clichés : “Honey Be (For Stella)”, son piano jazzijazzou, mais surtout son chant maladroitement rappé/toasté par Ayuli (qui, il faut le préciser, ne rend ici pas du tout hommage à la culture de ses parents puisqu’il n’est pas d’origine jamaïcaine mais nigériane), puis le breakbeat midtempo ultra grillé de “Cool As Moons”, où Alex pourrait être en train de parler de sa complicité perdue avec Rudy lorsqu’il chante “I can almost remember the way things used to be”. Quelle tristesse mais quel élan, malgré tout. C’est un disque de rupture quasi amoureuse donc, en tout cas de rupture artistique, ça c’est sûr, mais qui réussit néanmoins à exprimer de l’espoir, de la lumière, à faire apparaître un horizon malgré l’échec et la perte. La voix d’Alex a ce truc tellement affectueux que ça peut en devenir agaçant, et je crois que chez A.R. Kane ce sentiment d’agacement a toujours un peu existé. Un goût très doux, très sucré (le mot sweet est vraiment mieux mais on essaie tant bien que mal de parler français ici) qui arrivait à s’équilibrer avec les multiples autres saveurs et émotions à l’œuvre dans 69 et i, mais qui dans NCC s’entend davantage à cause de toutes ces portes fermées. Mais on ne lui en veut pas, car cette tendresse résiduelle légèrement écœurante fait quand même du bien. Elle est comme le sourire d’adieu de quelqu’un qu’on a aimé de tout son cœur, mais qui de toute évidence doit quitter notre vie et en vivre une autre. C’est la musique des moments où l’on comprend qu’il faut passer à autre chose, même si passer à autre chose implique de dire au revoir au paradis qu’on a aperçu le temps d’un instant.
Le parcours d’A.R. Kane, je m’en rends compte en terminant ce texte, mériterait sans doute de faire l’objet d’un livre ou du moins d’un long article. L’esthétique sonore et la personnalité des deux artistes, leurs propos théoriques et leurs positions sociales, la brièveté de leur carrière, leur alchimie créative si rare, et le fait qu’ils n’aient presque rien sorti depuis ce dernier disque : ça donnerait quelque chose, non ? En attendant, je vous exhorte à aller écouter ou réécouter leurs disques, le dernier ou les premiers, et de vous plonger dans cette utopie pop qui ne demande qu’à être activée par ses auditeurs, et non juste admirée comme une œuvre finie, totale et déprimante.