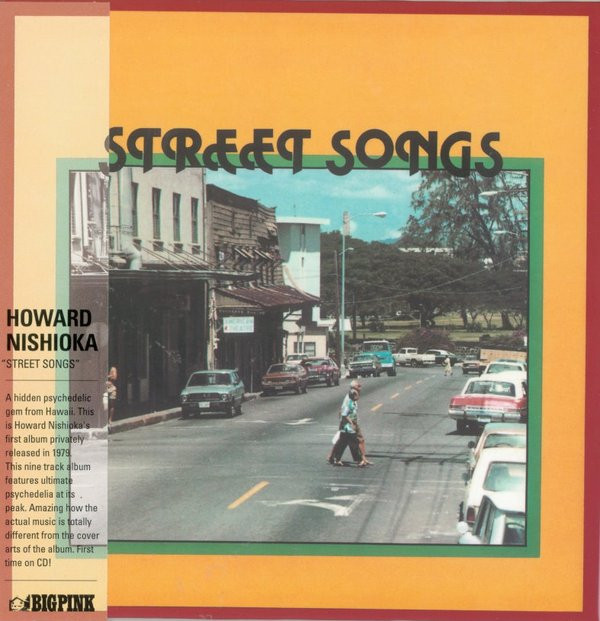À l’époque où je préparais l’option musique au bac, j’ai eu la chance de suivre un cours très dense d’histoire de la musique, dispensé par une jeune musicologue issue du conservatoire régional, parachutée dans la petite école de musique municipale que je fréquentais alors. Ce séminaire de quelques mois avait la particularité d’être ouvert à tout le monde, même si l’auditoire était essentiellement composé d’élèves de terminale un peu désabusés. Quand je dis que ce cours était dense, c’est qu’il avait pour ambition totalement délirante de couvrir en moins de trois mois presque toute l’histoire de la musique européenne : Guillaume de Machaut, Josquin Des Prés, Couperin, Rameau… et tout cela devait nous mener jusqu’aux sœurs Boulanger, en gros. Le programme a dû être écourté et notre prof s’est immanquablement retrouvée à zapper de longues périodes, notamment le XVIIIe et le XIXe, préférant se concentrer sur des âges un peu moins connus et étudiés par des jeunes gens, à savoir le Moyen-Âge et la Renaissance.
Cette prof aimait avant tout solliciter notre avis en diffusant des extraits musicaux, et en nous demandant ce que l’on en pensait avant d’en dire quoi que ce soit. Après avoir fini une de ses leçons consacrée au chant grégorien – que j’ai souvent entendu présenté comme la forme d’art la plus élevée qui soit, ou quelque chose du genre – je me souviens qu’elle a pris un CD, sorti de sa grosse mallette (à CD), et a lancé une piste qui nous a un peu sorti de notre léthargie.
C’était un chant religieux, mais aux antipodes de ce que l’on avait pu étudier et entendre jusque-là. Ce chant était lumineux, clair, fluide avec plein de mélismes et des intervalles très étonnants. Toute fière de son effet, elle nous a demandé de tenter de replacer ce que nous venions d’entendre dans le temps, mais surtout dans l’espace. Les réponses fusèrent, toutes incertaines. Moyen-Orient ? Asie Mineure ? Et elle, de nous avouer : « Pas besoin de chercher aussi loin, ça vient de Milan. »
Ce chant, qualifié d’ambrosien, ou de chant milanais, est liturgique et s’inscrit à part entière dans l’activité du culte chrétien. C’est à partir de là que j’ai un peu mieux compris quelle différence fondamentale réside entre la musique liturgique et ce que l’on nomme communément « musique religieuse ». Cette dernière catégorie, qui comprend par exemple la musique spirituelle, destinée à l’élévation de l’âme en dehors du cadre de l’église, mais aussi la musique sacrée (par exemple les oratorios de Bach et d’Haendel) est plutôt inspirée par les différents rites ; c’est une musique d’accompagnement, qui peut servir d’ornement, voire d’extension à l’exercice de la foi chrétienne. Aussi, cela m’a grandement émue que le chant ambrosien, cette musique lumineuse, chatoyante et à l’allure aussi libre, ait comme fonction première de « simplement » servir au juste exercice des différentes prières et processions – de la musique liturgique, donc.
Le terme ambrosien découle de Saint Ambroise, évêque de Milan entre 374 et 397. Il est dit qu’il a été le premier à codifier les chants de l’église à partir d’un certain nombre de principes. J’ai lu qu’avant cette période – mais on ne peut en être entièrement sûr – les chants chrétiens pouvaient être en partie construits à partir de mélodies helléniques ou même asiatiques. Et à ces mélodies toujours variées on appliquait les paroles communes de la liturgie latine. Avec Saint Ambroise c’est donc le début de l’uniformisation des mélodies qui composent les hymnes et les prières de la liturgie malgré un certain nombre d’influences musicales de pères de l’Église d’Orient dans une défense de l’orthodoxie, nous dit le livret de l’anthologie dont j’ai choisi de parler ici. Dans celui-ci est mis en avant l’importance que revêt la ville de Milan à cette époque-ci comme centre névralgique, à la fois commercial et administratif, de l’empire Romain où se sont croisés et mêlés diverses cultures : romaine évidemment, mais aussi grecque ou « barbare ».
À cette même époque plusieurs types de chants liturgiques coexistent, comme le chant mozarabe (des chrétiens vivant sur le territoire d’Al Andalus, avec une grosse composante improvisationnelle) ou le chant gallican (liturgie gauloise elle aussi inspirée par la tradition hellénique). Et c’est seulement lors de la gouvernance de Saint Grégoire, à partir de 591, que les chants d’église se trouvent réformés en profondeur – jusqu’à la centralisation du rite romain et l’uniformisation de toute la notation musicale, entérinée par Charlemagne vers 800 à l’échelle de toutes les églises de l’empire. À partir de là, on parlera de chant grégorien pour évoquer l’ensemble de la production musicale liturgique, qu’importe son origine. Toutes les églises de l’empire l’adoptent, à l’exception – on y revient – de celle de Milan, qui rend hommage à son ancien évêque en choisissant l’appellation de chant ambrosien. Aussi, même si dans le temps, les textes de la liturgie ambrosienne se sont rapprochés du rite romain, le chant a, quant à lui, échappé à cette standardisation et pu se perpétuer de manière indépendante. En fait, toujours selon le livret de l’anthologie, il continue d’être pratiqué à Milan et dans ses environs, jusqu’en Suisse, malgré le fait qu’il a cohabité avec la liturgie romaine et que de nombreux éléments textuels se soient fondus l’un dans l’autre.
La particularité du chant ambrosien, et c’est ce qui m’avait tant marquée dès ma première écoute, ce sont ces inflexions chromatiques souples et colorées, particulièrement élégantes. Pour ce faire, Saint Ambroise a emprunté les modes principaux du système musical grec (par ailleurs encore central pour la musique occidental) : le dorien, le phrygien et le lydien. En parcourant des passages du tome III de la Politique d’Aristote, il est expliqué comment chacun des modes sus-cités correspond à un certain type de mélodies, propagent des humeurs différentes, « éthiques » ou « pathologiques », affectent les auditeur·ice·s chacun à leur manière. Selon les Grecs, une mélodie mixolydienne évoque la mélancolie, là où le mode phrygien « déchaîne l’enthousiasme » ; le mode dorien évoque le calme et l’équilibre. Ce sont donc ces grandes émotions, logées dans les mélodies et nos inconscients, qui serrent le cœur, évoquent l’exaltation ou poussent à l’action, que l’on retrouvera dans nos chants liturgiques ambrosiens.
Le chant grégorien, quant à lui, s’articule autour d’un plus grand nombre de modes. Ce qui frappe en comparaison, c’est l’abandon assez radical des chromatismes, des mélismes et tout ce qui se rapproche des techniques vocales d’improvisation pour un diatonisme vertical où l’on passe radicalement d’une note à une autre. Toutes les nuances qui lient un do à un ré par exemple sont évacuées, en résulte une musique grave et rigide, voire sévère. Là où le chant ambrosien progresse plutôt par paliers labiles, le chant grégorien pourrait s’apparenter à une scansion mécanique. Cet aspect mécanique se lit jusque dans la méthode utilisée pour chanter les psaumes que l’on nomme « responsoriale », qui consiste en un couplet chanté par un soliste auquel le chœur répond. Dans la méthode antiphonaire, introduite par Saint Ambroise, les couplets sont chantés tour à tour par le soliste et le chœur. Encore une marque de la grande souplesse de ce chant.
Il n’existe néanmoins pas de notation musicale du chant ambrosien jusqu’au XIIIe siècle, et peut-être est-ce pour cela qu’il reste quelque peu méconnu aujourd’hui. J’ai cependant réussi à trouver des références d’enregistrements en passant par Discogs, et après en avoir écouté quelques-uns, je constate que celui de Marcel Pérès enregistré en 1987 par Harmonia Mundi est celui qui me touche le plus (je pense aussi que c’est celui-ci que notre prof avait dû nous passer). Sur ce dernier, de nombreux moment sont d’une grâce simple et radieuse : à la douzième minute du disque (Angelorum Laus : « Gloria in Excelsis Deo »), le passe-passe entre deux solistes m’émeut profondément ; à la dix-neuvième minute (Psalmellus : « Tecum Principium In Die Virtutis »), le mélisme d’une soliste soutenue par un chœur délicat de femmes, qui s’étend de longues minutes durant – elle chante d’abord une phrase « tecum principium in die virtutis tue » mais s’arrête si longuement sur chaque mot, sur chaque syllabe qu’on en oublie presque qu’il s’agit d’un texte chanté –, me bouleverse. Comme dira Saint Augustin, qui a séjourné auprès de Saint Ambroise et a écrit sur cette forme de chant liturgique, ici cité à la fin du fascicule : « Qui jubilat non verba dicit, sed sonus quidam est laetitiae sine verbis » (« Celui qui exulte ne prononce pas de mots ; c’est un chant de joie sans les mots »).
« Les chants de l’Église Milanaise » n’est pas une œuvre intégrale mais une anthologie, et en l’écoutant ce sont bien des fragments – le timbre d’une voix, un intervalle ou une mélodie – qui me restent en tête, sans que je parvienne exactement à les décrire ou les restituer. C’est un exercice complexe, d’autant plus si l’on peine à être précis d’un point de vue technique et/ou théorique : difficile, en effet, de ne pas s’arrêter à la pure description (ce chant est construit autour d’un nombre défini de principes, les voici) ou à la comparaison (le chant ambrosien c’est cela, alors que le chant grégorien c’est ceci), de s’extraire de la simple tautologie (ça me touche parce que ça me touche). Je crois qu’un des éléments qui rend l’écriture sur les musiques anciennes si complexe, c’est la distance illimitée qu’il existe entre nous et l’œuvre. Ce qui a animé Marcel Pérès avec cet album, c’est la tentative d’un rapprochement au plus près de ce qu’a dû être cette musique ; aussi, les chanteurs ont été dirigés selon « les habitudes de chant et les modes des églises d’Athènes et d’Antioche ». Ces enregistrements, réalisés il y a plus de trente ans, ne pourront cependant jamais en proposer qu’une lecture particulière, et ce malgré un colossal travail de recherche.
Peut-être est-ce pour cela que lorsqu’on lit de la critique spécialisée à propos de disques de « musique savante », ce n’est pas la musique qui est jugée, mais l’exécution de celle-ci, qui s’inscrit dans une histoire plurielle, publique mais aussi résolument privée. Il ne faudrait pas oublier que tous les jours, des enfants et des adultes – ces fameux « amateurs » – tentent tant bien que mal, eux aussi, de se démener avec une partition. Jamais ne cessera le trajet de ces œuvres, actualisées sans trêve. Et c’est peut-être aussi cela qui rend assez étrange l’écoute de ces musiques, agrégats de siècles mouvementés malgré leur rigidité. Une globalité monstrueusement sublime. Et plus l’on tente d’en parler, plus elle se dérobe – ou comme conclut Jean-François Labie dans le livret de l’album : « le résultat se passe de commentaires justificatifs ; la beauté emporte la conviction ».