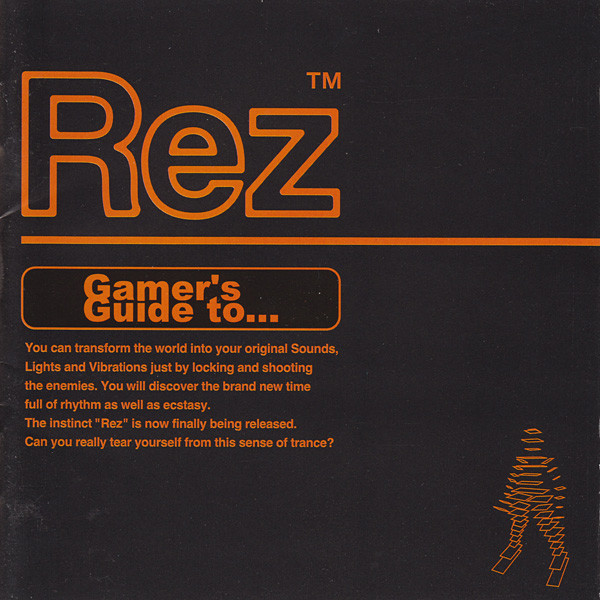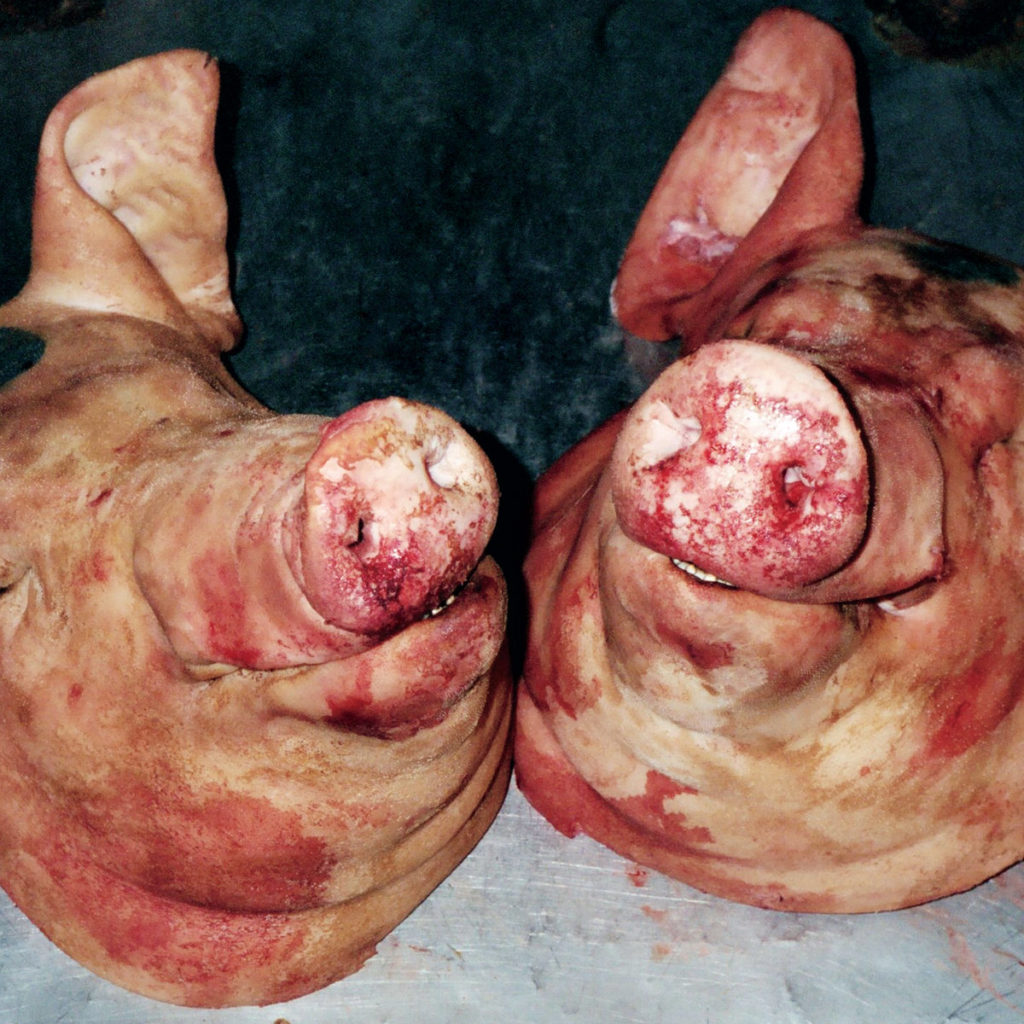Il y a presque deux ans, j’ai hérité d’une PS2 et de quelques jeux choisis avec soin. Faute de branchement adéquat (j’ai une télé sans port péritel, et les adaptateurs péritel-HDMI sont chers et pénibles à trouver), je ne m’en étais jamais servi. Jusqu’à peu. Une fois la relique branchée, j’ai inséré le CD dont la jaquette m’inspirait le plus. Au centre, l’armature d’un cube dont s’échappe une multitude de faisceaux lumineux multicolores. En haut à gauche, le nom du jeu : Rez. Il est difficile de tirer du sens d’un jeu vidéo sans l’avoir essayé, d’autant plus lorsqu’il est question d’un sortie vieille de vingt ans, qui se joue sur une console quasiment obsolète. Je vais quand même essayer de m’atteler à cette tâche ingrate en vue de restituer quelque chose des sensations fantastiques que j’ai pu éprouver en y jouant.
Lorsque le jeu se charge, plusieurs modes sont disponibles et la section « Comment jouer » donne des indications sur la façon de tirer sur les ennemis. Rez est un shoot ’em up : le but est simplement d’éviter des missiles et de détruire une série de menaces qui prennent des formes variées, machiniques ou humanoïdes. Dès la première des cinq zones à traverser, mes doigts comprennent assez rapidement les gestes à effectuer. Le pouce gauche se déplace à l’aide des flèches et vise ; le pouce droit, en pressant continuellement la croix, tire. Tous les graphismes du jeu sont vectoriels et filaires, composés de lignes et de points colorés sur fond noir. On y interprète un personnage vaguement humanoïde en trois dimensions, qui flotte, avance, détruit ses ennemis, mais qui surtout doit tirer à de multiples reprises sur un cube de lumière (celui de la jaquette), ce qui lui permet de libérer une nouvelle couche – plus complexe, plus riche en détails – de son environnement. Seulement, ce dernier défile à une allure folle et on a à peine le temps de l’observer du coin de d’œil tandis que notre héros avance inexorablement vers le fond de l’écran. Chaque zone possède dix couches, ou strates, et se conclut par une confrontation avec un boss de fin. Ces manœuvres finales demandent précision (viser la menace fuyante qui se recompose en permanence) et abnégation (shooter en continu jusqu’à complètement abaisser son niveau de vie). Une fois terminé le premier niveau de Rez, je sentais mon cœur battre dans mes tempes, dans mes poignets, et à peu près partout dans mon corps.
Si j’ai posé succinctement le principe du jeu, j’ai omis jusque-là un élément central qui fait que Rez dépasse le simple statut de shoot ’em up. C’est avant tout un jeu rythmique complètement grisant, saturé de musique, ce qui n’a rien d’extravagant en soi, si ce n’est qu’ici les morceaux ne font pas que qu’accompagner notre activité et qu’il ne s’agit pas proprement de se laisser emporter par le tempo de ceux-ci, mais plutôt de l’inverse : le corps du/de la joueur·euse, la pression qu’iel exerce sur la manette avec ses doigts engendre la musique, la génère. Entremêlements audiovisuels complexes, les niveaux n’existent pas en tant que tels et n’atteignent leur forme la plus complète qu’à condition d’être pleinement éprouvés par la personne aux commandes (littéralement) ; au canevas de base se superpose une mélodie de la partie, se composant des bruitages de celle-ci – notamment lorsque des ennemis sont touchés.
Lorsque l’on joue, la manette vibre en fonction d’un tempo initial : cette vibration est par ailleurs équivalente au mouvement du personnage, qui semble pulser à la manière d’un rythme cardiaque. La zone, comme la musique, sont très élémentaires en début de partie. Aussi, chaque ennemi tué va permettre aux courbes et lignes qui composent l’environnement de se transformer en un théâtre (temples chinois, pyramides…) dont les textures vont elles aussi se densifier. À mesure que l’on détruit (ou non) nos ennemis et que l’on accède à une strate supérieure de la zone de jeu, une transition s’opère, comme lors d’un DJ set : le BPM grimpe subrepticement, et la manette vibre plus fort. Dès lors, le devenir de la musique entendue se retrouve conditionné à l’action du/de la joueur·euse. L’écoute des pistes seules ne s’approche pas un instant de l’expérience de jeu, où des couches de détails s’agrègent progressivement, insufflant une sensation de vitalité euphorique, ou comme le dit très bien Virginie Nebbia, qui a consacré à Rez un livre dans lequel j’ai appris énormément de choses sur son contexte de création :
« Le laser symbolise en réalité l’instrument qui attend que les notes (les virus) viennent à lui. Alors seulement, leur rencontre peut engendrer un son spécifique. Les cubes de lumière font office de DJ, chargés de sublimer l’harmonie de l’ensemble. Le joueur devient maître absolu du morceau. De la destruction (des ennemis) naît quelque chose de nouveau (du son). »
Il est peut-être temps d’évoquer le créateur et la genèse de Rez. En 1997, Tetsuya Mizuguchi, qui s’était jusque-là illustré dans les jeux automobiles, se rend en Europe pour y mener des recherches sur un prochain jeu. Il est alors amené à Zurich par un membre de son équipe pour assister à la Street parade (la version suisse de la Techno parade). C’est pour lui une véritable révélation sensorielle, de l’ordre de la synesthésie (il a étudié Kandinsky à l’université) et il décide de se lancer dans la création d’un jeu musical, d’abord nommé project-K (oui, oui, K comme Kandinsky). C’est pour reproduire les sensations d’une foule faisant corps et s’acheminant dans une même direction – à la croisée du sensible et du mouvementé, de la lumière et du son – qu’il se lance dans la création de Rez.
Pour parfaire le jeu, et dans un souci d’exactitude méthodique et phénoménologique, les membres de l’équipe prennent l’habitude de se rendre régulièrement en club en vue d’étudier les réactions du public lors des sets des DJ. Analyser la manière dont ces derniers guident les corps, sans scrupules, les balancent à travers toutes sortes de zones qui, épisodiquement, les accompagnent en intensifiant progressivement la pression ou les piègent par des ruptures agressives. Plaisir pervers que de faire monter une tension qui ne se relâche qu’en vue d’atteindre un point d’intensité maximale : exaltation et supplice que Mizuguchi et son équipe s’attellent à transcrire, traduire et programmer.
D’abord commandés à une série de producteurs (Fatboy Slim et Aphex Twin sont approchés, mais déclinent faute de temps), les morceaux sont ensuite « épluchés » piste par piste, selon le mot de Virginie Nebbia, ces dernières étant quantifiées afin de pouvoir être restituées en strates. Quelle que soit la fréquence et la cadence des tirs – qui produisent donc un son –, aucun de ceux-ci ne sonnera faux ; le tout conserve un équilibre, une harmonie générale. Pas de mavericks britanniques donc, mais des producteurs japonais de différentes envergures (Ken Ishii, Joujouka ou Keiichi Sugiyama), un mystérieux groupe de minimal synth suisse, Mist – j’aime beaucoup leur « Protocol Rain » avec cette basse industrielle assez épaisse qui se confronte à un petit piano virevoltant, avec autour beaucoup de vide, pré-requis nécessaire à un possible enrichissement de la piste, on le comprend –, quelques inconnus mais aussi tout de même Coldcut ou le pape de l’ambient glitché, Markus Popp/Oval, qui déroule ici deux pistes assez écrasantes, moins good vibes que les précédentes, sans surprise, et dont je n’ai même pas vraiment de souvenir.
En attendant, il est un peu cruel de ma part de recommander l’écoute de cet album, alors que chaque piste qui le compose aura été potentiellement éprouvée différemment pour chaque joueur·euse. Je ne saurais dire si elles ont un intérêt en tant que telles, ce qui est une sorte de comble pour un article censé recommander un album. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’une simple écoute de l’OST ne saura exactement traduire ces sensations musicales transfigurées en véritable saisissement vibratoire. C’est comme recommander la bande originale d’un film que l’on ne verrait jamais (quoique). Donc, si jamais vous tombez par hasard sur le jeu et une PS2 (ou une Dreamcast, ce qui semble encore moins probable) d’occasion à Cash Express, n’hésitez pas une seconde ! Après, il est toujours possible de choper une réédition (Rez Infinite, un cran de plus dans l’ouverture de chakras assistée) sur Steam ou sur n’importe quelle autre console moderne, ce qui est certes moins romantique mais qui fait quand même l’affaire.
Pour écrire ce texte, j’ai néanmoins écouté l’album avec les pistes qui accompagnent chacune des zones. Force est de constater que de cette écoute surgissait déjà le souvenir d’une rencontre passée, quelque chose qui déjà avait eu le temps de devenir familier sans que l’on y prenne garde et que l’on puisse vraiment remonter la chaîne des événements. Du reste, les morceaux sont assez simples et répétitifs (essentiellement de la techno et du big beat) pour se faire le réceptacle d’une forme de dilatation. J’ai donc trouvé du plaisir à les écouter en m’engageant dans cette tâche d’écriture, la réitération à la fois comme point d’ancrage dans le sol et comme déracinement de l’esprit.
Parmi les autres trucs qui m’ont marquée à la lecture du livre de Nebbia, c’est que pour approfondir encore plus la sensation d’immersion, Mizuguchi est allé jusqu’à concevoir un accessoire, un pad vibrant pensé pour la PS2, le bien nommé trance vibrator, que l’opinion générale a pris sans surprise pour un sex-toy. Après l’avoir branché à la console, il suffisait de s’en saisir et de le mettre où l’on voulait, sous ses pieds, dans sa poche, pour amplifier encore plus les sensations de jeu. Et en vue d’en faire une expérience totale, Mizuguchi (qui, décidément, a dédié sa vie à Rez) a conçu en 2015 une combinaison synesthésique, composée d’une couche interne munie de vingt-six vibrateurs. Il n’en existe qu’un modèle, qu’il a essayé lors d’une convention Playstation pour présenter la version augmentée du jeu. Il aurait pleuré en la testant. Je trouve ça trop émouvant !
Une dernière chose qui m’a frappée et qui rend vraiment l’expérience de jeu encore plus inimitable, c’est cette impression unique d’éprouver la musique de l’intérieur, dans sa tête, sans avoir à l’écouter activement. Ça rend donc l’expérience aussi très solitaire et la réécoute, comme j’ai pu le faire, quasi inappropriée. Si la description de Rez inscrite sur le livret le compare à quelque chose proche de la prise d’ecstasy, y jouer m’évoque vraiment une pure émotion de tout début de défonce ou d’ivresse, avant que celle-ci ne vienne se mâtiner d’autres sensations de désinhibition. C’est cette extase non extatique, lorsque le corps réussit encore à se porter par on ne sait quel miracle (le bonhomme de Rez aspiré inlassablement par le fond de l’écran) et qui, dans mon cas, me donne toujours l’impression d’être un PNJ. C’est à la fois agréable et désagréable, ou peut-être ni l’un ni l’autre, juste un truc qui permet de sortir de soi pour un instant sans qu’on en soit encore totalement conscient et en mesure de jouer avec. Si je devais comparer ça à une image, ce serait celle de la représentation du futur dans Donnie Darko (sorti en 2001, soit la même année que Rez !) : Donnie perçoit chez les autres, mais aussi chez lui, le mouvement futur des choses, et ce mouvement prend la forme d’une tentacule translucide qui sort de la poitrine et vient guider le corps dans la tâche qu’il a à accomplir. Là c’est un peu pareil, comme une espèce de tapis roulant qui ne laisse pas imaginer quoi que ce soit d’autre qu’un mouvement perpétuel.