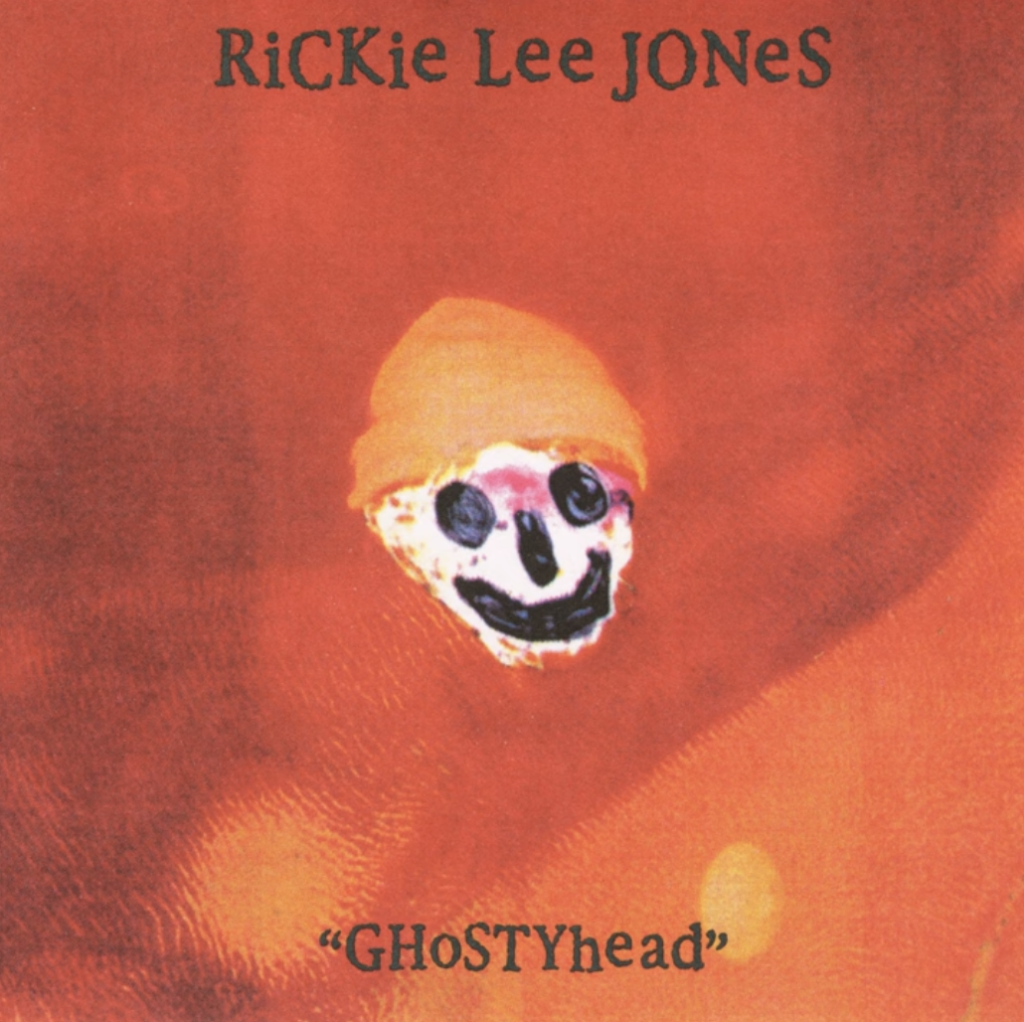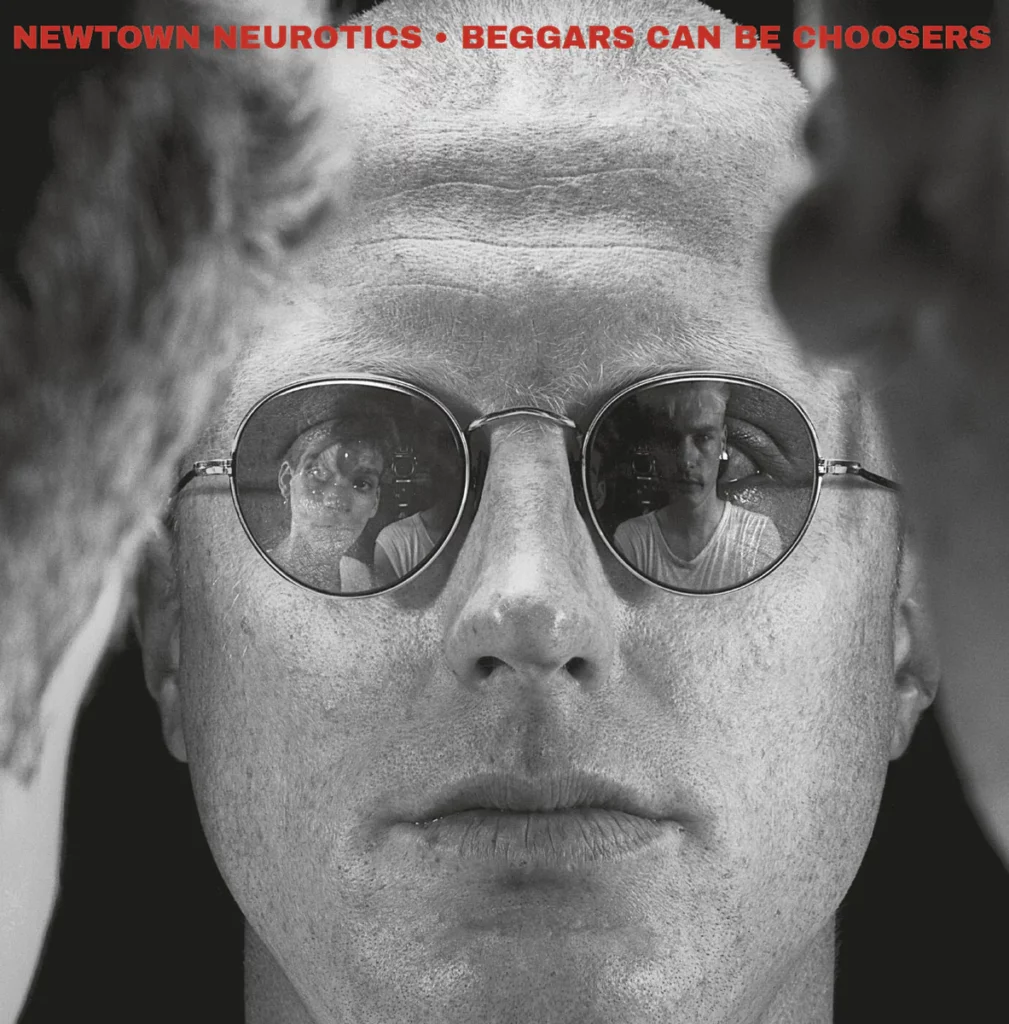Oh Rickie ! Tu as bercé mon enfance – ton premier album, un des disques préférés de mon père, avec tes clopes, ton béret et les amours dévoilés de Chuck E –, mes errances de nuit aussi, ta voix, grinçante et parfois lyrique (samplée par The Orb dans l’emblème trance vaporeuse « Little Fluffy Clouds »). Un jour ou l’autre, je le savais, j’allais te rendre hommage.
Rickie Lee Jones est une artiste emblématique des années 80, qui a incarné une forme de pop chicos, entre soft rock dodelinant et clin d’œil jazzy. La « duchesse de Coolsville » a été l’une des dernières incarnations d’une musique new-yorkaise gentiment alternative, mais néanmoins grand public. Pour Musique Journal, j’aurais pu choisir, crâneur, un des disques de sa période faste le moins connus comme The Magazine (produit en 1984 et faisant suite à l’immense Pirates) sur lequel, aidée par le compositeur de musique de film James Newton Howard, la native de Chicago offre une sorte de version des années 80 où tous les sourires sont forcés, saturée d’ambiances ECM. Un disque qui se termine par la suite dite des « Rorschachs », pour moi un très bel exemple de pop expérimentale raffinée et intimiste, trois segments qui donnent très envie de ne plus jamais sortir de chez soi et de se morfondre dans des méandres de thé fumé et de lectures oisives. En somme, un disque que l’on pourrait croire sorti pour les 20 ans de la création de la chaine de magasin d’ameublement Habitat (en 1964) : semi-bourge, chiant, irrésistible.
À la fin des années 80, Rickie Lee Jones signe un contrat avec Geffen Records, et se retrouve avec plein de ronds et Walter Becker de Steely Dan pour produire le très acclamé Flying Cowboys (complété, dans certaines versions, par une longue interview de Rickie Lee Jones, c’est de là que vient le sample de « Little Fluffy Clouds »). Si c’est un disque que je n’apprécie que moyennement, son succès public relance néanmoins sa carrière. Malheureusement, la suite chez Geffen est moins glorieuse avec deux disques pourtant vraiment pas mal (Pop Pop en 1991 et Traffic From Paradise en 1993), mais qui passent relativement inaperçus. La suite, c’est le passage chez Reprise, sous-label de la Warner, avec un timide et presque conservateur disque de reprises de ses succès et de standards de jazz en acoustique, Naked Songs, en 1995. Au milieu des années 90 on est en plein dans le creux de carrière pour Rickie, qui va faire sa crise de la quarantaine avec le disque dont je vais vous parler aujourd’hui, Ghostyhead, sorti en 1997 toujours sur Reprise.
Ghostyhead ne ressemble en effet à aucun des autres disques de Rickie. Sur le papier, c’est une vraie idée de merde : une chanteuse pleine de doutes qui tente de faire un disque expérimental et électronique accompagné d’un producteur et musicien pour des groupes de rock alternatif un peu naze (la bise à Rick Boston, qui a donc sévi dans des horreurs du genre Low Pop Suicide ou Hand of Fate). Son compagnon de la fin des années 70, Tom Waits, nous a par exemple exempté de ce genre de tentative, et préservé nos oreilles d’un feat sur un morceau de Portishead ou je ne sais quoi. Non merci la vibe de clodo cosmique qui vient pourrir l’ambiance dans la chillout room. Sur Ghostyhead, les morceaux les plus marqués par leur époque et une patine vaguement trip-hop rythmé échouent (sur « Road Kill » ou « Matters » par exemple), et c’est probablement parce que la manière si singulière de chanter de Rickie s’accommode mal des banalités.
En revanche, les morceaux plus étranges, faits de boucles lancinantes et de bribes de paroles, semblent un écrin parfait et insoupçonné pour son timbre fragile. La deuxième partie de l’album, de l’éponyme « Ghostyhead » à « Vessel of Light » est bouleversante, d’une grande liberté, pour celle qui incarnait jusqu’alors une forme de chanson jazz blanche et consensuelle. Certes, l’aspect novateur et contemporain du disque ne fait plus mouche, mais globalement, ça fonctionne, chaque morceau ouvre un nouveau champ d’expérimentation pop pour Rickie Lee Jones, qui grâce à son talent de chanteuse de variété, transforme ces vignettes éthérées en véritables morceaux qui accrochent et interpellent. Celle qui a jadis inspiré Suzanne Vega se retrouve à produire le même genre de folk électronique weird et attachante que sur le 99.9 F de l’interprète de « Tom’s Dinner ». Sur « Scary Chinese Movie », guitares aux flangers exagérés et voix traînante offrent une ballade parfaitement nineties, dans une posture presque trop bizarre-cool à laquelle je ne résiste pourtant pas, quand sur « Vessel of Light », le dernier titre du disque, Rickie se la joue carrément Cocteau Twins. Un morceau comme « Sunny Afternoon », avec le mixage très cru de sa voix et son instrumentation éparse, me touche particulièrement : le vertige, toujours étrange, d’entrevoir les secrets d’une célébrité.
À l’époque, le disque a été chaleureusement accueilli par la critique, sans toutefois, selon l’expression consacrée, rencontrer son public. J’ai un espoir bizarrement très modéré dans le fait que la tendance s’inverse, mais soyons réaliste, je crains que ce disque mineur et marginal dans la discographie de Miss Jones ne dépassera probablement jamais le statut de curiosité. Un album peu dramatique et très personnel qui saura peut-être captiver les allergiques au clinquant jazzy et au romantisme exubérant des débuts de la Chicagoane, ou à ceux qui ne porteront jamais de bonnet rouges en 2024 .