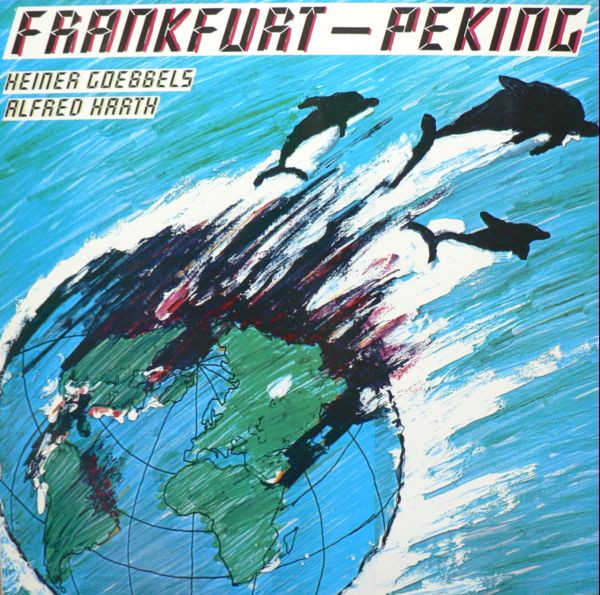Pour Curtis Mayfield comme pour Beat-Club, l’an 1972 est un carrefour. Le natif de Chicago sort son premier album solo et signe aussi la B.O. de Superfly, tandis que la légendaire émission musicale allemande vit sa dernière saison. Convergence inopinée ou non, les deux entités entreront en contact cette même année pour une session magnifique, au cours de laquelle le musicien lâchera ce qui reste selon moi la version définitive de son morceau le plus connu, « Move On Up », et dont je voudrais vous parler aujourd’hui.
De Curtis, premier album de l’artiste, mes souvenirs sont précoces mais surtout visuels : la pochette avec la prise de vue groovy par en-dessous, toutes les photographies avec sa famille tellement simples et belles, imbibées d’une aura solaire. Et si j’ai rapidement été exposé à Mayfield via la sono du père, c’est bien plus tard que je m’y suis penché volontairement – il y a une dizaine d’années. Et à l’écoute de sa musique, ça m’a frappé : nul autre que lui ne m’a plus influencé, dans l’essence de ce que doit être une chanson, dans la manière dont les éléments doivent s’agencer, dont la voix doit se placer.
« Move On Up » n’est pas forcément ma chanson préférée de Curtis, sûrement parce qu’elle a trop été reprise, avec plus ou moins de succès, ou remixée avec tiédeur pour intégrer des playlists d’afterwork. Mais la performance que réalisent le chanteur-guitariste-compositeur-producteur-homme d’affaires et son groupe lors de leur passage dans le programme télévisé ouest-allemand – tourné dans les locaux de Radio Brême et où se sont produites les formations préférées de nos bien-aimé·es boomers – m’a pourtant permis de saisir son ampleur presque cosmique, d’ausculter plus clairement son ossature et l’indéniable force motrice et collective la travaillant.
Fait primordial : les emblématiques cuivres, véritables marqueurs sonores du morceau dans sa version originale, sont absents de cette captation. L’architecture mesurée et convenable devient alors un aplat chatoyant, indomptable et rayonnant, que la guitare nimbée d’effet de phase de Curtis vient vernir. Les sons se mêlent, les corps sont tendus, alertes mais non crispés. Un autre élément d’importance, visuel et scénographique cette fois, c’est que cette session a pour seul décor un fond bleu électrique, mais nous y reviendrons. On se rend compte alors de la folle mécanique de la chose : plusieurs forces se chevauchent sans se gloutonner, les musiciens travaillent de concert et filent à une allure insensée, avec une fluidité articulaire de tous les instants. C’est une anomalie, une projection vers ce qui advient, pourrait advenir, l’esquisse d’une musique de danse africaine-américaine à réaliser.
Rien n’échappe à ce schème tissé sans tyrannie (on est loin de James Brown), où les objets voguent ensemble dans un même flux, non contraints ; où ce qui se meut ne peut être en dehors et que vient sceller la voix au timbre si fin de Curtis Mayfield, mixée jusque ce qu’il faut en avant pour venir se poser devant sans surplomber, glisser peut-être plus avec que dessus. C’est une osmose complète, à la fois véloce et délicate, exquise, implacable, forcenée. Une communion très sérieuse véhiculant un psychédélisme non pas éthéré mais bien ancré dans la vie de tous les jours. Le reste de la session (qui dure une heure et ne blague absolument pas) vous convaincra sans peine. Cette communauté est en place, assurée. Elle ne joue pas à faire semblant car il y a urgence : chanter l’amour est ici une question de survie, un acte brûlant d’espoir.
Sur la fin de son existence, Beat-Club s’est engouffré de plus en plus dans le psychédélisme, notamment avec l’entrée dans la décennie 1970. Il y a eu de l’audace visuelle, certain·es ont lâché les freins musicalement, et cela pour mon plus grand bonheur. Pourtant, ce sont toujours ces moments fond bleu des sessions qui me captivent. Cet unicité colorimétrique, avec cette teinte dont l’œil peine à se détacher, donne l’effet d’une nudité dérangeante, d’une anomalie : quelque chose se déroule ou va advenir, déconne peut-être ; en tout cas tout peut arriver. Pour sublimer cela, il faut donc que tout arrive et en 1972 toujours, c’est le plan quand Don Van Vliet aka Captain Beefheart et sa team de charlatans du Magic Band débarquent à Brême dans les studios de l’émission et délivrent une session d’une demi-heure d’un blues insensé et dangereux, fortement acidulé si vous me passez l’expression.
J’ai toujours autant de plaisir à mater cet épisode de Tex Avery complètement cramé peuplé de freaks complets : le batteur est monté sur monorail avec un slip sur la tête et un monocle, les trois guitaristes sont alignés comme une éclipse totale mais semblent aussi évoluer dans des dimensions différentes ; le bassiste est doté d’un groove MONSTRUEUX ; les pantalons brillent, les motifs sont légions et les corps en élasthanne ; Don harangue et charme comme personne, éructe ses sermons trans-octaves sur double microphone. Il y a des soli de sax soprano et d’harmonica, des mises en place à faire basculer un trip et des riffs ultra lourds… Le boogie conclusif et salace « I’m Gonna Booglarize You, Baby » est une spirale ascendante dont le pouvoir se trouve décuplée si on l’allie à l’image – le fond bleu se transforme pour l’occasion en multiplexe complètement zinzin !
C’est un autre genre de communion qui se dessine, où décence et bon goût brûlent ensemble dans un grand feu hargneux qu’alimentent ces mauvais génies malaisants. Les miroirs tendus aux téléspectateur·ices par le groupe de Curtis et par celui de Don ne sont pas exactement les mêmes, ils diffèrent parce que les vécus de ces hommes sont différents. Une vérité analogue y sinue : ce monde est impossible, ce monde est faux, s’en libérer ne suffit pas et il faut le transformer, c’est urgent. Et pour cela, la musique est un excellent moyen.