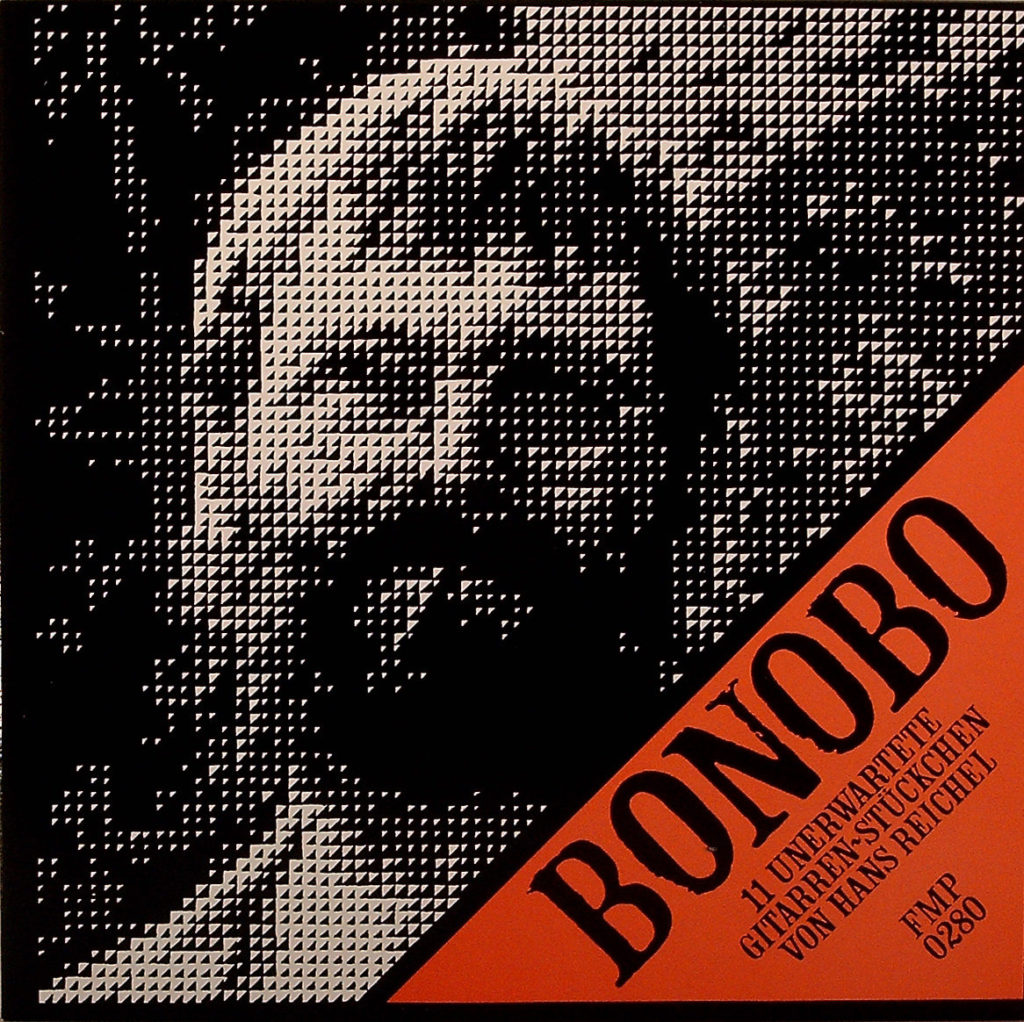« Je ne suis pas rentré·e dedans ». Voilà une des conclusions à laquelle mon entourage semble souvent se résigner lorsqu’il est question de cinéma, qu’importe qu’iel se présente comme « sachant·e » ou non, et qui m’a toujours un peu chagrinée. Il incombe donc (même si personne ne m’en a chargée) de s’y pencher pour l’interroger. Cette remarque, cette petite phrase qui sans arrêt vient clore quelque chose, qu’il y ait débat ou non, est souvent lancée de façon anodine, légère, même si elle porte la marque ombrageuse du regret, mais surtout semble à elle seule régir l’appréciation, donc plus loin, la valeur d’un film et ce, même si l’on s’invente toute sortes d’excuses dans le but de tempérer une déception. Elle réside dans l’aptitude du film en question à produire chez celle ou celui qui le regarde une qualité d’immersion, laquelle pourra être décrite par l’intéressé·e comme lui ayant permis de « rentrer » dans celui-ci, voire de s’oublier à son contact.
« Je ne suis pas rentré·e dedans ». Cette phrase m’amuse et me donne plutôt envie de me réjouir. Mettons que tu sois rentré dedans, comment aurais-tu fait pour en sortir ? Et contrairement à ce que hurlait Kanye en 2013 in-a-very-phallic-way, je crois qu’être dedans relève du fantasme. L’immersion, c’est l’illusion de la continuité basée en cinéma sur la succession d’images en mouvement à hauteur de 24 par seconde. Alors pour contrer ce que je vis a minima comme une intrusion, une violence, voire un ravissement de mes sens, j’aime plutôt revendiquer l’ennui et le désintérêt passager ; la possibilité, très précieuse, celle de penser complètement à autre chose en regardant un film. Physiquement, cela passe par un rituel lorsque je suis seule. Aller m’asseoir, dans une salle de cinéma, tout devant et tout à gauche pour observer l’écran de biais, de côté, pour éprouver le fait d’être toujours ici et ailleurs. Mais surtout ici, un peu coincée en moi, plutôt qu’ailleurs – et de négocier avec cette réalité.
En musique, l’illusion de continuité à l’origine de la suspension de l’incrédulité est exemplairement maintenue dans l’exercice du DJ set, lequel vise à unir une matière absolument hétérogène quand bien même les tracks parleraient la « même langue » (même fonction ou style…). Donc une ligne tenue d’un bout à l’autre où la basse d’un premier morceau se substitue à celle d’un autre comme si de rien n’était ; où la collure, la coupe doit être invisible – et la transition parfaite – en vue d’embrasser l’idée du flux comme modèle esthétique et moteur sonique avec le risque de nous maintenir la tête sous l’eau sans possibilité d’échappée. Je ne remets pas en question l’existence du DJ set (il y en a autant qu’il y a de personnes), mais je crois que je chéris l’art dans sa capacité à nous maintenir dans une zone d’entre-deux qui invite plutôt à évoluer dans l’incertitude, la vigilance, voire l’inquiétude (et peut-être le déplaisir) que de s’abandonner à la permanence et au flux. Aussi, parce que l’art ne vient rien recouvrir, et ne se substitue en aucun cas à la vie, mais est une lunette, ou une lutte, ou tout ce qui permet de mieux éprouver des forces à l’œuvre dans le réel, donc, pour ce faire, doit nous maintenir dans un état d’extériorité relatif lequel permet à la réflexion, voire à la réflexivité de se manifester – ce qui, dans ma langue, est synonyme de liberté. Et je crois que la plus belle expression de liberté à laquelle j’ai récemment été mise au contact a pris la forme – un peu inattendue – d’un DJ set du producteur originaire de Bristol, Joker. Pour le référencement, il s’agit du Keep Hush Live: Coyote Records Takeover 2018-11-20.
Devant les images et à l’écoute de ce set, il est proprement impossible de s’oublier, donc de se raconter que l’on est « dedans », là où on est plutôt au contact d’une matière qui serait celle du bouillonnement humoral du DJ – ce qui n’est pas contradictoire avec le fait d’apparaître d’un calme à toute épreuve – et qui ne s’embarrasse même pas d’essayer de superposer ou fondre l’une dans l’autre les deux pistes qu’il fait discuter, mais semble les tester pour la première fois avec la rudesse et le savoir intuitif de la cuisinière ou de l’ébéniste qui fait ses mesures à l’œil et taille grossièrement dans le lard avant de chercher à affiner. Alors, elles débordent et frottent approximativement l’une sur l’autre, plus qu’elles ne disparaissent pour créer ce troisième échantillon, cette troisième voie qui invisible les parties desquelles elle est la somme. De la belle ouvrage malgré tout, qui ne cherche certainement pas à faire joli, ou propre, ou quoi que ce soit d’autre, et rompt sans sourciller cette règle tacite qui consiste, pour le bien commun et l’équilibre du langage, à ne pas s’interrompre ou couper quelqu’un au milieu d’une phrase, et qui, en musique, pourrait se traduire par ce qui va de soi, à savoir : on ne coupe pas une phrase musicale quelque part entre la mesure 4 ou 8, au risque de faire tomber le château de cartes sonique ou l’élan communicatif du groupe. Ici, les transitions s’imposent toujours par surprise, toujours à côté, trop tôt ou trop tard mais la bataille est ailleurs et le château parvient miraculeusement à tenir debout.
Comment ? Parce que c’est une nouvelle langue, une parole incontinente qui s’élabore à partir d’une grammaire du heurt et de l’extrême et construit un équilibre précaire qui rivalise avec le chaos. En voici un exemple frappant : plutôt que de tester sans fin sa superposition au casque afin de la rendre présentable, Joker la mesure, l’éprouve en direct. Alors qu’il a atteint un point de saturation d’espace sonore maximal avec le drop de « Mad Night », il mute le track pour faire entrer le début de « S Wave ». L’énergie est complètement différente, la rupture, trop brusque. À passer d’un trop-plein à un presque-rien, on n’entend finalement plus que la coupe. Mais il s’accroche à son idée, répète obstinément son geste, deux fois, trois fois, jusqu’à l’oreille finisse par s’habituer, que la danse puisse être de nouveau envisageable, et que ça sonne presque bien. Mais c’est déjà trop tard, il a déjà lâché le premier track pour ne plus laisser vivre que le second. C’est encore plus frappant lorsqu’il y a des voix – celle de Ginuwine, celle de Teddy Bruckshot – et qu’il leur coupe l’herbe sous le pied sans aucune espèce de gêne. Je n’y vois pas là la marque d’un irrespect fondamental, qu’un désir de travailler le morceau à l’endroit du sonore plutôt qu’à l’endroit de l’intelligible. Cette nouvelle langue, hors des usages conventionnels du djing, serait-elle la marque d’un nouveau temps ? Pour supputer plutôt que de répondre factuellement à cette question, j’emprunte le titre, beau et présomptueux, de cette pièce de 1967, nommée Messe pour le temps présent, élaborée par le concrétiste Pierre Henry et qui tentait peut-être de mettre en forme, donc de penser ce que serait le présent, donc toujours un peu le futur de la musique qui oscille entre horizon désirable et matérialité de ce avec quoi on se débat.
Le temps présent de ce set, c’est le mois de novembre 2018, et c’était il y a déjà une éternité. Coller aux sensations véhiculées par le temps présent ce n’est pas juste réinventer ce que serait la couleur, la texture ou la vitesse du son, mais se poser également la question de la manipulation de ces couleurs, textures et vitesses. Le set de Joker se faufile habilement entre les époques, les BPM et les modes de production, donc son présent à lui, n’est pas simplement un présent d’énonciation. On est en 2018, mais aussi en 2009 (le dubstep ne fait déjà plus dans la raréfaction, la pesanteur et la vibration sous-marine mais parle désormais une langue insensée et enfantine que l’on appelle wobble, et dont « Filth » de Skream constitue peut-être un point de bascule définitif ; langue enfantine qui répond au son, développé par Joker à la même époque et inspiré par le 16-bit et la G-funk : le purple sound) et même en 2015 (bribes de Sir Spyro et Jme – explosion et normalisation du grime à l’international, notamment par la starification des MCs).
Toutes ces sonorités qui ont pour point commun de venir de la même aire géographique (ou presque) et d’être sorties ces dix dernières années (à l’époque du set) semblent touchées par la même grâce au contact des mains du DJ. C’est comment l’épuisement, la divagation, l’égarement et l’affolement pénètrent l’espace du club, font trace d’une époque (celle de notre capitalisme tardif, of course), menacent de disparition chaque piste, font tomber l’illusion d’une continuité bienveillante et conviviale, rendent manifeste le désir arbitraire et passager du DJ comme ayant de la valeur en soi et étant source d’une grande beauté (= virer un track au bout de 30 secondes parce qu’il est simplement possible de le faire) et concrétisent notre impossibilité à se fixer et éprouver pleinement une sensation, à s’en satisfaire, pour plutôt en goûter une infinité mais sur un mode mineur (l’idée du plaisir, remplace la gêne, qui laisse place à l’euphorie, avant de se muer en honte, tel est le chemin de croix quotidien de tout un chacun). Sa messe, à Joker, c’est comment le corps et les mains travaillent, c’est comment l’apathie cohabite avec la plus grande des joies, et c’est ce que documente – sans même s’en rendre compte je crois – cette heure filmée. Ces mains qui s’écharpent à fond sur le crossfader d’une table de mixage, et qui répondent aux autres paires de mains du public, dont celles, virtuoses, d’un jeune homme portant une marinière et qui reporte toute l’énergie qui lui reste de sa semaine dans la danse et trace avec ses immenses paluches des formes troubles et secrètes sur lesquelles tout le monde glose dans les commentaires de la vidéo.