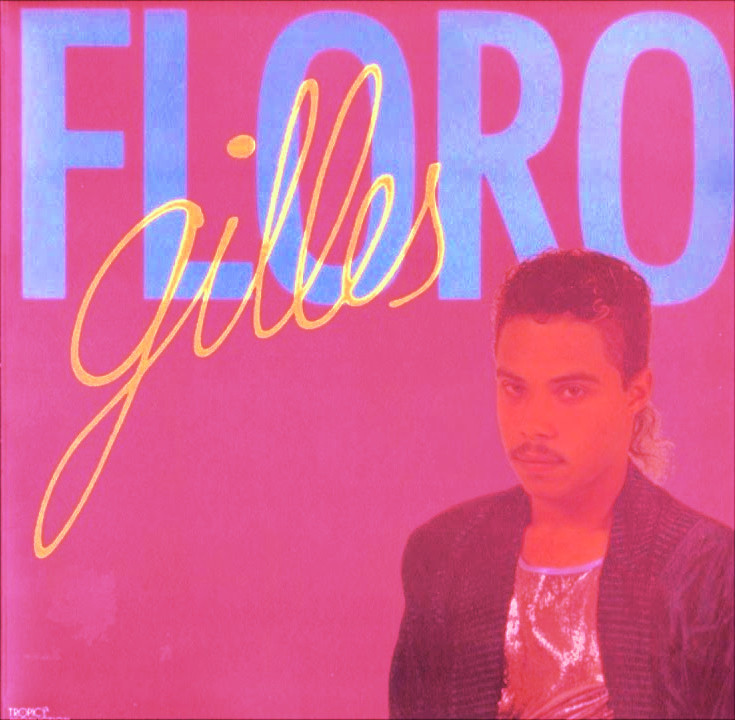Quand on a des enfants et que la musique est centrale dans notre vie – mais pour qui en fait ne l’est-elle pas ? –, on peut écrire la biographie familiale avec des chansons.
Je peux vous parler de chacune des berceuses que mes enfants ont choisies pour que je les câline chaque petit soir quand elle ou ils s’endormaient encore accroché·e·s à mon sein et bien après. Le « Good Night » des Beatles, « Fly me to the moon » de Sinatra ou « À la faveur de l’automne » de Tété n’ont absolument plus aucun secret pour moi. J’ai écouté et chanté ces morceaux littéralement des milliers de fois. Et franchement, je n’ai pas choisi, j’ai proposé un peu comme ça, sur le moment, et eux ont bloqué, chacun·e la leur. Et puis il y a les danses dans le salon, les rondes rock, les acrobaties aléatoires sur fond de guitares, les road trips dans la vieille Volvo – « Éteins la musique ! », me disait mon grand quand il était petit et ça me crevait le cœur, les mains sur le volant.
Il y a leurs premiers concerts aussi : ma fille dans sa robe fuchsia et dans la poussette regardant CocoRosie à Paris sur les bords de Seine, mon grand garçon, deux ans plus tard dans la même poussette, près de Rennes, dehors sous le soleil d’été, ses grands yeux marrons ronds d’émerveillement devant Montgomery et mon petit dernier beaucoup plus tard, dans une autre poussette donc, quand il s’est endormi au tout début du concert de tonton Norman de Teenage Fanclub à Bilbao.
Bien sûr, ils ont pris de moi, de nous musicalement : chanter L’Internationale à 2 ans puis par cœur chaque mot et chaque souffle de chaque chanson des Demoiselles de Rochefort à 6 pour la première, le second qui faisait peur à la baby-sitter, quand, à 4 ans, il demandait Anarchy in the UK pour s’endormir et qui connaît Belle and Sebastian presque aussi bien que moi et le dernier qui retient tous les airs après une écoute et qui bouge ses hanches le doigt levé comme personne. Ce dernier qui a tout digéré – qui est comme une symbiose de tous nos univers musicaux singuliers – a 6 ans aujourd’hui, enregistre et sait reconnaître à la première écoute les morceaux passés par les grands, son père, moi, sa sœur et son frère, bien plus grande et grand que lui.
Parce qu’au fil des années, évidemment, ce qui a joué sur la platine familiale, c’étaient autant nos morceaux que les leurs, ceux des enfants, devenus adolescents et même aujourd’hui jeunes adultes. Et je m’en suis pris des claques. Parce qu’après tant de soins musicaux, qu’est-ce qu’ils se mettent à écouter ? Forcément des trucs qu’on n’aime pas, des trucs selon nous pas à la hauteur – mais c’est pas possible, mais quand même !? J’en ai fait des moues jusqu’à entendre : « Mais maman, arrête de juger ! » Lancé par ma fille énervée du haut de ses onze ans. Et je me suis rappelée.
Je me suis rappelée instantanément de ce monde encore plus patriarcal qu’aujourd’hui, quand j’étais enfant, un monde où ceux qui savent soi-disant, ceux qui ont le bon goût aussi, ce sont d’abord les hommes, et puis les vieux, cette croyance tellement pratique pour que rien ne change, rien ne vive, pour que les désirs se ravalent. Et je vérifiais sans connaître Bourdieu qu’il avait raison, avoir du goût, c’est aussi avoir du dégoût, et c’est ainsi qu’on m’a dit « Madonna, c’est nul », alors que pour moi, à onze ans, Madonna, c’était ma vie. Et me voilà, des années plus tard, comme à d’autres endroits, adopter l’attitude que je détestais chez mes aîné·e·s. Et comme à chaque fois que je le réalise, je tente de redresser la barre vers la fidélité à mes sentiments de pré-adolescence.
J’ai donc vraiment ouvert les oreilles, j’ai écouté la musique que mes enfants écoutaient. Et je n’ai pas fait semblant, je ne l’ai pas fait avec une espèce de curiosité condescendante. Enfin peut-être qu’au début, si, j’ai fait ça. Parce que. Parce que des a priori, des grincements, auto-tune et compagnie… J’ai les oreilles réfractaires, conservatrices, si je ne fais pas bien attention à les ouvrir de manière nouvelle. Et puis, petit à petit leurs sons m’ont éduquée et franchement Dieu merci. Quand je remercie Dieu d’ailleurs, c’est vraiment à la manière d’une des plus belles chansons que je connaisse sur la parentalité écrite par Laura Marling, « For You » – « I thank a God I’ve never met, never loved, never wanted…for you » Je remercie un Dieu que je n’ai jamais rencontré, jamais aimé, jamais voulu… pour toi. Pour elleux.
Il n’y a que merci qui convienne pour le cadeau de ces présences dans ma vie, et pas si accessoirement, celui de toute cette nouvelle musique qu’iels ont porté vers moi comme autant d’univers venus étendre mon domaine de compréhension et de perception du monde. Sans mes enfants, j’aurais quand même, je crois, écouté Frank Ocean ou Tyler, The Creator, mais je les aurais écoutés de l’extérieur ; surtout, je serais restée complètement hermétique à cette nouvelle incarnation rap français qu’iels nomment new wave. J’aurais gardé cette oreille curieuse mais distante que j’ai tendue au départ vers la musique rap qui domine les goûts musicaux d’une majorité de celleux qu’en bonne boomeuse j’appelle les « jeunes », à me dire : c’est bizarre quand même tous ces enfants de petits bourgeois comme les miens qui ont intégré la langue des dominé·es et même leurs luttes, leurs peines… J’en serais restée là. Bêtement.
C’est parce que j’ai écouté cette musique de mes enfants, parce que j’ai suivi leurs goûts, comme j’ai pu suivre avant ceux de fiancés ou d’ami·e·s que j’estimais, qu’un jour c’est devenu – un peu – ma musique et que j’ai pu ajouter des items dans ma grille foutraque de lecture du monde. Et alors, alors seulement, j’ai été apte à juger de ce que j’aimais le moins, à le départir de ce que j’aimais le plus. Dans la seconde catégorie trône pas mal en ce moment Khali.
J’ai toujours eu du mal à comprendre, mais quand j’écoute Khali aujourd’hui, par exemple, j’ai l’impression de saisir. Je comprends, parce que je suis pris dans ce mouvement d’enrapture, dans cette énergie qui finalement est trans-âges et trans-classes : la flemme de vivre ce monde qu’on essore, la flemme de continuer quand même à le vivre fort avec un fond de faux espoirs. Pourtant il y a dans ses textes tous ces mots que j’ignore et même quand on m’explique, je ne comprends toujours pas, sauf que je comprends. Et si c’était une histoire de fréquences… d’arrangements qui captent le monde actuel de manière juste et précise.
Aujourd’hui, mes enfants disent « ça dead ça » ou « c’est un pick me », dans deux mois, ce sera autre chose. Il parle une langue qui m’est toujours un peu étrangère, parce qu’elle est d’une vivacité qui me dépasse continuellement. C’est drôle, j’ai la sensation qu’on ne parle que très peu de l’invention linguistique constante de cette génération ; de leurs activités débilitantes tiktokiennes, alors ça, par contre, des tartines en veux-tu en voilà ; mais cette langue, si peu considérée, cette langue, moi, me met des claques, la langue de Khali me met des claques, me réveille. Khali, il faut dire, il est doué pour nous accrocher, dans sa musique, et ses mots, et sa voix (cette baby voice façon Playboy Cartri), sa respiration même, il est doué pour nous prendre par la main.
Dans IL ME RESSEMBLE PAS NON PLUS (second album de Khali après le très bon LAÏLA en 2021), il y a cette matière synthétique que dorénavant on peut faire seul·e chez soi, et puis il y a une vibration humaine incroyable. Il y a longtemps qu’on sait que l’un n’empêche pas l’autre, c’est vrai. Mais alors qu’on est dans une époque où on nous dit que l’IA va nous bouffer tout·es cru·es, nous les organiques, c’est toujours bien de vérifier que le numérique ne fait sens qu’avec le souffle du vivant. Le monde justement, sa fin ou son trouble en tout cas, vient s’inviter dans toutes les chansons de l’album :
« Tu sais l’espoir, ça va, ça vient… C’est malheureux, on t’a fait croire que le monde est à oit »
Cette phrase fait écho en moi à une ligne d’une chanson des Pearlfishers qui me hante, « I was a cowboy » ; « Thought I’d grow handsome, funny and free », manière de dire qu’on se fout bien de nous et que finalement on sera tous perdus par nos espoirs. Personne n’est dupe du métarécit d’un monde en faillite dans lequel il faut bien rêver.
Qu’est-ce qui nous fait croire qu’ils n’ont pas tout compris, cette génération ? J’ai l’impression que mes enfants ont tout compris mille ans avant moi ; cette accélération de tout que l’on déplore, quand elle est associée à un peu de réflexion, la vache, ça envoie. Comme une pensée profonde sous des airs de plastoc, comme une musique qui se permet des libertés folles en pastilles de carcans-cachettes de trésors ; et la chasse à la beauté est facile, en fait : il y en a partout partout.
Au milieu des beats, un flow proche de la drill parfois et puis allez, on joue avec les sons acousmatiquement et en finesse, avec les normes esthétiques, jusqu’au bout. Il y a aussi une fragilité romantique très Europe du XIXe siècle passée au prisme nippon ; de la variété, un peu de chiptune, mais aussi du baroque et du gothique. Un sentiment proprement épique traverse cet album, de bout en bout ; sa couleur est crépusculaire, extrêmement noble.
Les allitérations s’entassent jusqu’à ce que les syllabes soient surfer, glissent d’un monde harmonique à l’autre, toujours dans le trouble – sur « PEPELE » : « pépélé / enchanté lé lé / … on y sera bientôt to to / j’en reviens pas pa pa….». C’est un rap qui se laisse emporter par les rouleaux de la parole qui se donne.
Aussi, il y a ce récit, un peu omniprésent chez les rappeurs aujourd’hui, cette mise en scène autofictionnelle de leur vie, pleine de désirs rabattus, recréés au gré des difficultés et va jusqu’à la mise au clair des processus créatifs. Parce qu’il faut comprendre à quel point ça écrit, ça auto-fictionne :
« (…) J’ai commencé le son à dix-sept, environ
Poto, j’suis pas dans c’qui est beau, là
La passion, c’est c’qui m’a passé la pommade
Guapo là a géré la tona’
J’ai vesqui ma chambre, les machins et les zonards
Mon reflexe n’a pas été d’bédave
J’ai fait des sons chauds et d’autres qui étaient très nazes
Moins de blabla, que des actes
C’est plus compliqué quand t’as les traits d’là-bas
Des tonnes de mots peuvent te mener en balade
Ça y est, le rap game c’est un cadavre
On l’a fait revivre là, ze3ma en banale
Ça y est, le rap game c’est un cadavre
Ça y est, le rap game c’est un cadavre
Ça y est, le rap game c’est un cadavre (cadavre)
Khali et Ponko et Tada
Je n’écoute pas ces MC, ils ont pas d’âme
Faire du son pour moi c’tait un choix pas mal (pas mal)
En vrai (en vrai de vrai)
À part au niveau relation où j’crée des états d’âme
Mais pas grave, toute la vida j’dirai qu’ça va
En vrai (…) »
On parle de soi, des autres et du réel, les mots défilent comme autant d’introspections, d’assertions, de certitudes et de doutes mêlés, jetés comme ça. On prend, on trie et on prend de toute façon une leçon de fractalisation de la modernité modernité. Récit de vie au son d’un piano toujours, dans un décor planté « ENTRE PALMER ET PARIS ZOO » ; vous qui n’êtes pas de Bordeaux, ça ne vous dit peut-être rien, mais c’est là où Khali a grandi ; décor de banlieue proche de province, tout en hauteur, de colline et d’immeuble, qui donne des envies de s’envoler en s’appuyant sur ses propres misères – « Une avalanche de soucis me résigne, des situations qui font serrer quand elles font grandir vite. » Et ce refrain à crever le cœur :
« L’enfer j’le vois en eux
Le feu, le seum dans leurs yeux
Avec cette image on comprend mieux
Pas tant besoin de toi
Je sais pas j’ai besoin de quoi
Participer ou mener la danse
Tu recommences avec tes scènes
La zik avec les veines
De la pluie d’œil plein les mains
J’tais un enfant plein de craintes
Plein de soucis, peu de monde »
Poésie.
Poésie et réalité.
Une réalité qui a sa place et qu’on entend peu ailleurs que dans le rap, une réalité du dedans, l’intérieur d’une tête qui s’entête et qui expose son monde, qui partage, qui explique des choses, comme ça, dans l’infra. Dans « NO PSY » (« Chez nous le psy, ça n’existe pas / chez nous tu pries pour que la tristesse passe / Ici personne n’aura pitié de toi / Parce que tu seras jamais le pire des cas… »), ou dans « JE FERAIS DE MON MIEUX » (« J’ai jamais vu la daronne sans aucune maladie »), par exemple.
La musique et le flow permettent de garder de la pudeur, d’exposer sans surexposer pour éviter d’imploser. Dans « JAMAIS COMME ILS VONT », ce constat d’injustice d’une vérité aussi cruelle que banale (« J’ai tout fait comme il faut et pourtant je ne vais jamais comme ils vont »). Et oui, c’est un décor, c’est une vie avec une sociologie, et qui n’est pas prêt à imploser dans ce monde ? On sait qui et ils sont peu finalement. Khali associe crise avec crime et on est beaucoup à comprendre ça, plus loin, ailleurs qu’entre Palmer et Paris Zoo.
« Ça y est, j’veux d’un festin, pas d’sandwich au Kiri»
Comme cette phrase, l’album IL ME RESSEMBLE PAS NON PLUS, est drôle un peu, vif, tranche ; c’est sombre beaucoup, mais Khali se dépatouille et sublime plus vite que son ombre. Que dire de plus ?
Merci Khali, merci mes enfants.


![Musique Journal - Rituels bruitistes et méthodiques des Indiens d’Amazonie [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2019/04/musique-journal-asurini.jpg)