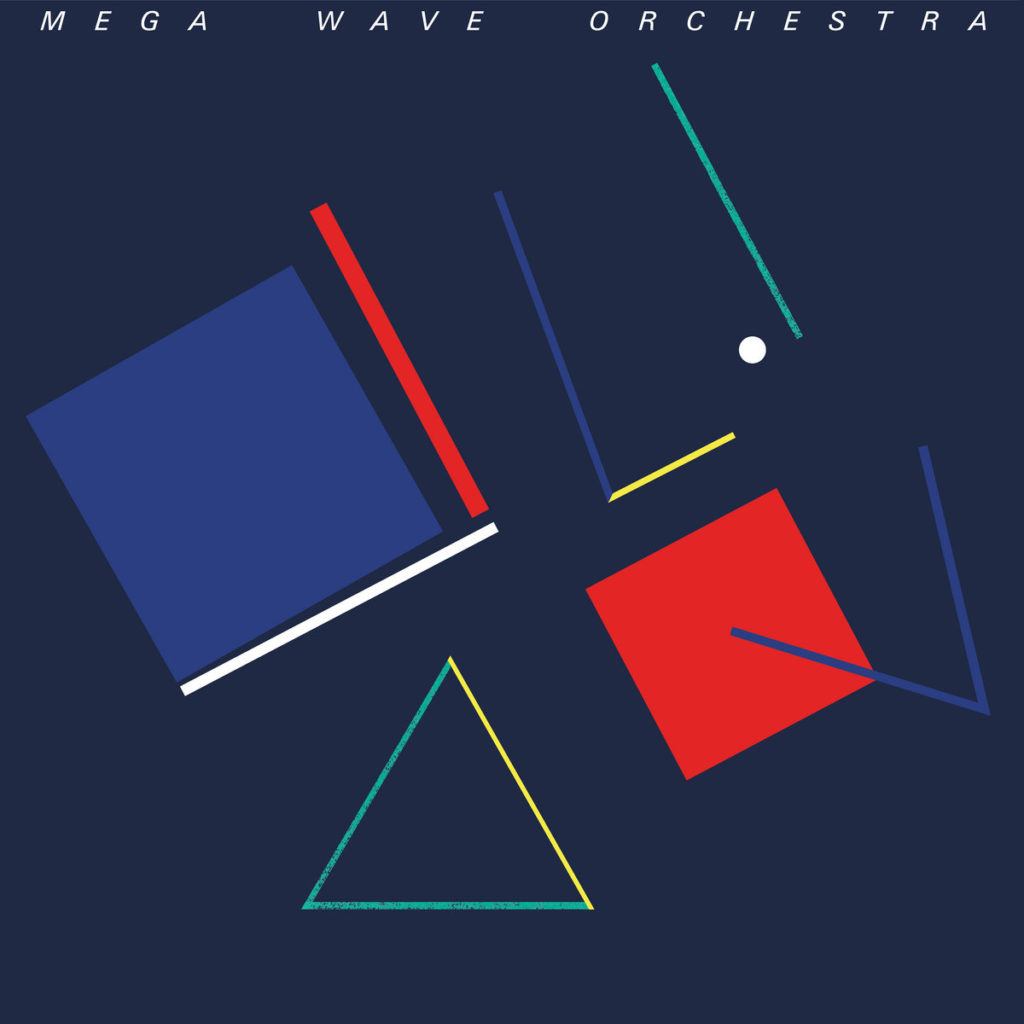Le TER me transporte vers Lyon. Je pars de Grenoble, le trajet est beau, grand, des toits de roches partout, parsemés de restes de neige hivernale. Mes écouteurs diffusent des morceaux, je suis sur un mode aléatoire et quelconque, et puis il y a cette chanson. Une basse rebondissante, une mélodie un brin mélancolique qui accroche au paysage et puis une voix masculine, délicate, que je reconnais. Je jette un coup d’œil : Miguel, « So I Lie ».
Miguel est de retour. Et ce retour s’accompagne de la question que je me suis déjà si souvent posée à son sujet : comment est-il possible qu’entre chacune de ses sorties, j’en vienne à presque entièrement oublier l’existence de cet artiste, alors même que ses albums sont ce qu’on a peut-être fait de mieux en termes de R&B/variété internationale ces dix dernières années ?
Depuis 2010, année de son premier album (All I Want is You, Jive Records), jusqu’à cet EP Art Dealer Chic 4 sorti ce mois d’avril 2021, Miguel est de ces chanteurs « comètes » qui disparaissent très souvent, pour une période plus ou moins longue, mais qui ressurgissent toujours. Avec un succès cependant toujours limité.
Né en 1985 en Californie, d’une mère afro-américaine et d’un père américano-mexicain, Miguel a été biberonné au funk, au jazz, et au classic rock. Des influences un peu old school qui s’entendront surtout à partir de 2012, année de l’éclosion pour le chanteur, désormais débarrassé d’une équipe artistique qui n’aidait pas à son épanouissement. Des influences digérées et retravaillées pour donner naissance à un alt-R&B suave agrémenté de lignes de guitares rock. C’est donc en 2012 que sort la trilogie de EP Art Dealer Chic, suivie de l’album Kaleidoscope Dream, tous très bien reçus par la critique. Mais déjà, Pitchfork déplore la faible portée de la musique de Miguel. L’album est pourtant brillant : il apporte un vent de fraîcheur dans le R&B de l’époque, à l’image du single « Adorn », bijou qui rappelle le tube « Just the Two of Us » de Grover Washington Jr. et Bill Withers. Un single qui n’invente rien mais qui a le chouette mérite d’être élégamment efficace.
En 2012, Miguel a 27 ans. À cette âge-là, Prince avait déjà sorti cinq albums et Billie Eilish en aura probablement sorti autant. Il n’est jamais trop tard, mais il est parfois juste un peu tard. Surtout dans ce monde sans pitié qu’est celui de la pop R&B, marché qui amasse le plus d’argent et d’audience, où la compétition entre artistes est si forte qu’elle tue dans l’œuf nombre de carrières prometteuses. Mais encore une fois, Miguel donne assez justement l’impression de s’en foutre, de survoler tout ça.
Les années passent et les disques sortent avec une ponctualité quasi métronomique, confirmant chaque fois la vocation d’expérimentateur du chanteur. Tous ont ce petit quelque chose, que ce soit dans le groove (« Told You So » sur War and Leisure, sorti en 2017), dans les élans falsetto de sa voix, dans les lignes de guitare, dans les thèmes joués au synthétiseur, nappes éthérées qui rejoignent les chœurs, ou inversement, dans de jolies harmoniques (« How Many Drinks » sur Kaleidoscope Dream, « FLESH » sur Wildheart, album « consécration » sorti en 2015). Un quelque chose qui interpelle, qui accroche l’attention et parfois le cœur, un truc qui fait sortir la musique de Miguel de la simple pop, et qui l’emmène vers un petit ailleurs un peu flou et paradoxalement immense. Oui, un petit ailleurs immense. Pourtant, Miguel n’a jamais réussi à faire trembler le Billboard, et ce malgré quelques récompenses.
C’est que 2012 fut une grosse année pour la « variété internationale », ce créneau devenu gros mot, injustement boudé de par sa grande facilité d’assimilation à un gigantesque n’importe quoi, souvent jugé de piètre qualité. Pourtant s’il y a bien un genre qui s’inscrit dans cette catégorie plus large, c’est bien ce R&B très pop auquel Miguel peut alors être assimilé. Un territoire notamment brigué par Rihanna, qui malgré son charisme de rock-star et son aura hip-hop reste néanmoins une artiste qui fait de la variété, et qui le fait magnifiquement bien. De son côté, Miguel explore les genres : il associe riffs princiens et lignes de basse à la Sly Stone, manifeste en outre une volonté d’aller toujours plus loin, semble-t-il, dans les retranchements de sa propre éducation musicale. Mais cette année 2012 si chargée, si concurrentielle, a sans doute eu raison de Miguel et son avènement au plus haut niveau. C’est l’année de « Diamonds », un des plus gros tubes des années 10, sinon le plus gros. C’est aussi l’année de l’explosion de deux artistes devenus depuis mastodontes du R&B moderne, et en concurrence plus ou moins directe avec Miguel : Frank Ocean et The Weeknd. Le premier fait sans doute un peu d’ombre à Miguel, mais c’est comme l’ombre légère et partielle d’un palmier, car en 2012, son Channel Orange ne touche pas encore un public aussi vaste que Blond en 2016. Et la véritable éclipse que va subir Miguel va venir du Canada.
En 2011 (soit un an après le premier album de Miguel et un an avant Kaleidoscope Dreams), Drake a reposté sur les réseaux sociaux le compte Soundcloud de l’un de ses compatriotes, Abel Tesfaye, aka The Weeknd. Cette visibilité inattendue va permettre à cet artiste de 21 ans, d’origine éthiopienne, de rééditer ses trois premiers EP, désormais réunis en un seul disque sobrement nommé Trilogy, puis de sortir son premier album studio en septembre 2013, Kiss Land, et au passage d’affoler les compteurs de ventes. Miguel, avec son album sorti pile entre les deux disques de The Weeknd, semble être passé par un petit trou noir qui va le faire souffrir au démarrage, et qui depuis lors, lui donne un retard permanent sur le grand vainqueur du genre.
La question du timing ne suffit pourtant pas à expliquer, sans pour autant parler d’échec, le petit succès de Miguel une fois franchis les océans. Le faux départ est handicapant mais ne parvient pas à éclairer la raison pour laquelle le Californien semble finalement non pas en retard sur ses concurrents, mais carrément hors course.
Reprendre cette idée de petit ailleurs immense peut aider. Non pas que les deux artistes partagent intégralement le même registre, mais les similitudes sont quand même indéniables. Des atmosphères sonores très marquées, groovy et lumineuses pour Miguel, sombres et suffocantes pour The Weeknd, des influences parfois semblables (Prince pour les deux hommes), et une volonté de jouer avec l’élasticité du R&B, jusqu’à l’amener vers des contrées encore peu explorées. Mais Miguel apparaît finalement comme le pendant heureux et positif du Canadien, dont l’esthétique mélodramatique peut vite s’avérer indigeste pour une partie des auditeurs. Car si la catharsis est une chose parfois bienvenue, le concept peut tourner au morbide après tant d’années d’usage. Mais le désespoir a quelque chose de robuste par les temps qui courent, ce depuis un moment déjà, et à moins d’un profond changement civilisationnel, d’un retournement de paradigme existentiel à 180 degrés, The Weeknd a encore de beaux jours devant lui. Tant pis pour la joie. La proposition artistique de Miguel, son R&B jovial et traversé par une positivité certaine n’est peut-être pas assez glamour pour déclencher des torrents de streams. Ce qui fonctionne en revanche dans la musique et dans le personnage de The Weeknd, c’est cette espèce de douleur existentielle insolvable, sans cesse réactualisée par autant d’évènements sociétaux pesants.
C’est ce petit ailleurs immense proposé par Miguel qui le met d’emblée hors course, ou disons hors-catégorie. Pas hyper-productif, peu présent médiatiquement (pas nécessairement de son plein gré par ailleurs), pas vraiment rentable, un peu loser. Il semble là encore survoler le prosaïsme de la variété et de son industrie, au profit d’une création musicale tout en joie, en plaisir et en lascivité. Ce qui, pour être tout à fait claire, ne peut pas constituer un vrai fond de commerce pour une popstar : son hédonisme décontracté n’est tout simplement pas très vendeur.
À l’image de ce quatrième volet de Art Chic Dealer, qui près de dix ans après la sortie des premiers volumes, continue d’honorer son adage éthique, et persistant, d’humilité et de positivité. Les quatre titres présentent chacun à leur manière une délicatesse bienvenue, même lorsque les productions s’aventurent dans des ambiances un peu plus tortueuses, aux titres évocateurs (« Funeral »), et même lorsque les paroles abordent des thématiques personnelles. Que ce soit à travers la circularité parfaite de la mélodie de « Thinking Out Loud » ou la rythmique sombre et chaloupée de « Triangle Love », chaque élément amène une finesse dans le mouvement sonore. Je me serais juste volontiers passée de l’extrait narratif qui termine « Triangle Love », un extrait du film de Mike Nichols, Closer, où l’on entend les personnages de Clive Owen et Julia Roberts, mais qui apporte une littéralité excessive au récit de la chanson.
C’est sans doute le dernier titre qui résume le mieux toute la richesse du Californien et son aura de gourou du bonheur : « So I Lie », ritournelle au groove solaire, à la basse bondissante, ronde comme une bulle de chewing-gum, portée par son timbre délicat, jouant d’une élégance nourrie des plus grands (difficile de ne pas penser à Al Green ou à Paul Kelly). Un titre qui à la vue des montagnes prend corps de manière singulière, la basse paraissant rebondir sur les sommets. Un titre qui évoque la détresse de l’être lorsqu’il subit les railleries d’autrui, parfois et y compris de ses pairs. Et qui parle de ce mur que l’individu a tendance à bâtir pour se protéger des assauts malveillants du monde. « I’m determined to connect w you deeper, and w that in mind this song is almost the perfect reintroduction » écrit-il sur Instagram, dans un post adressé à son public pour présenter ce nouveau single. La marche vers ce petit ailleurs immense est loin d’être terminée.