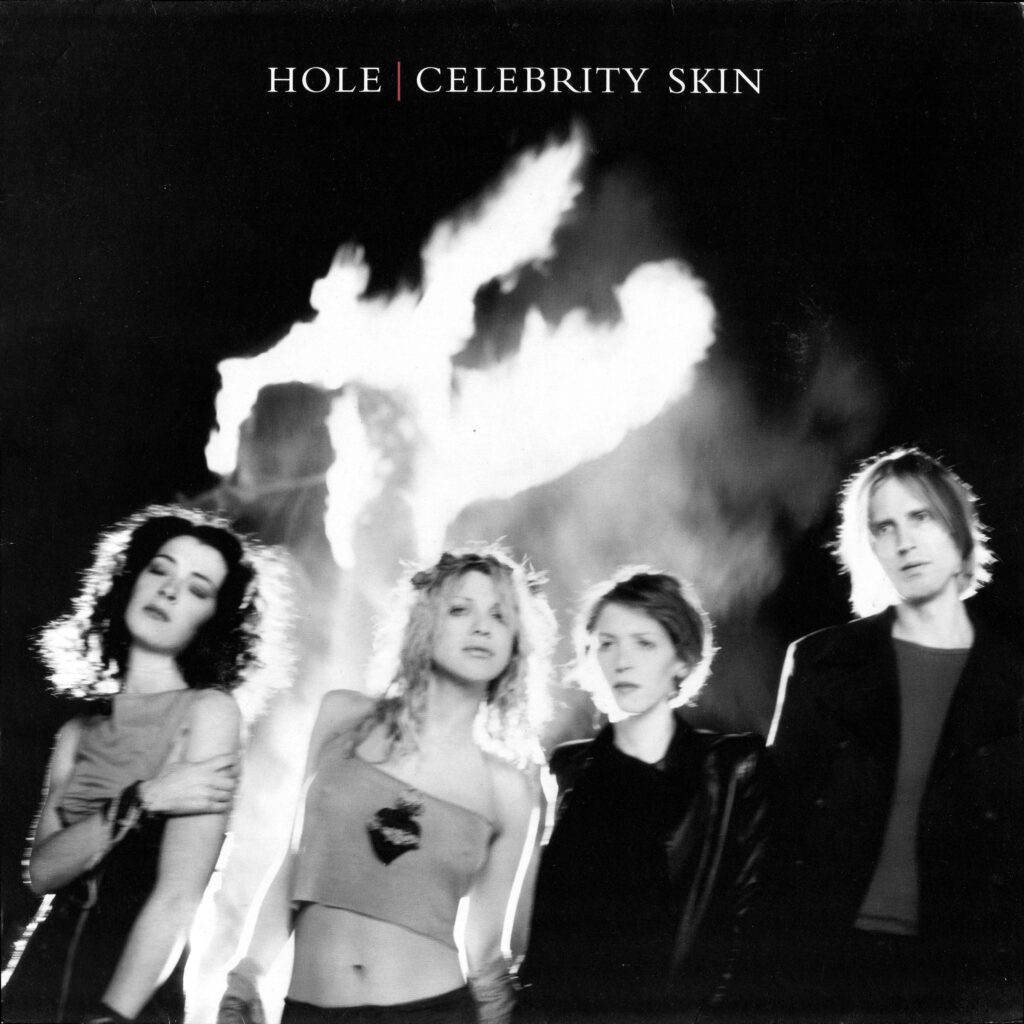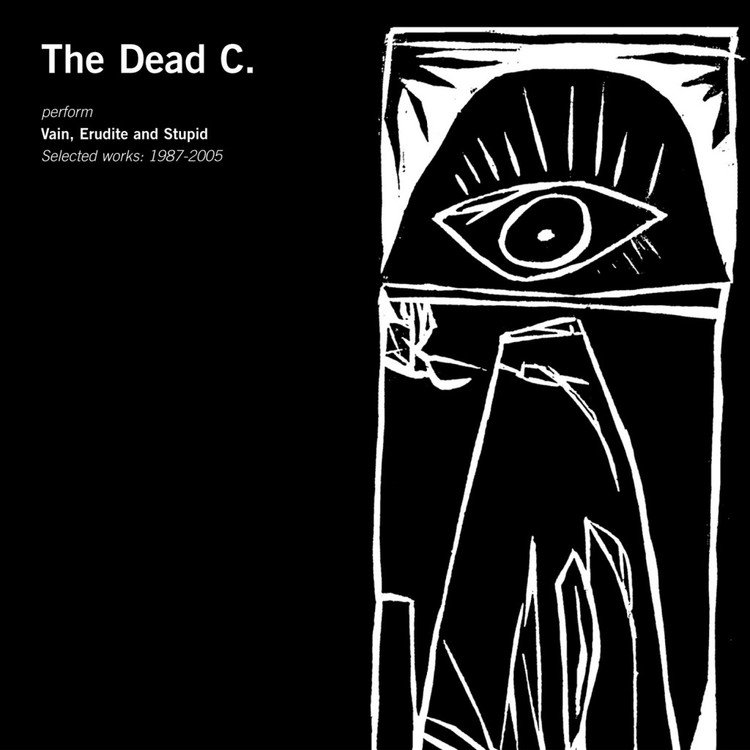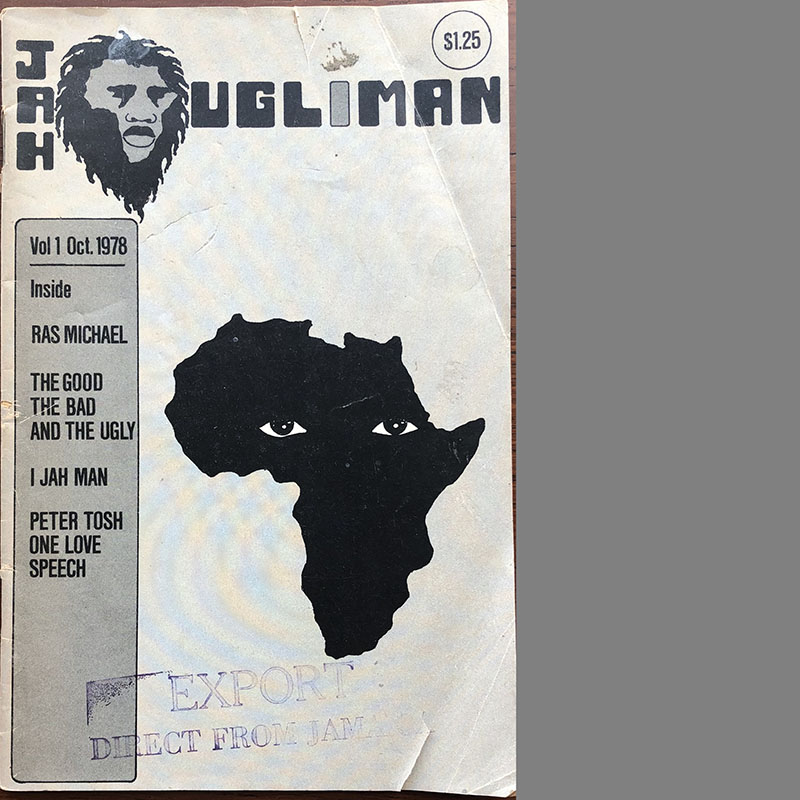Mes chances d’écouter Flawed Mangoes auraient été plus que minimes si je n’étais tombé au hasard sur un reel Instagram, dans la veine de ceux décrits par Laura Courty récemment. À force de voir passer ces reels accompagnés de musique, je m’étais retrouvé à remonter le cours de quelques titres omniprésents, par ras-le-bol de les entendre tout le temps sans savoir d’où ils venaient. J’ai eu ma réponse : en général, ils sont produits par des nouvelles boîtes d’IA musicales qui remplacent aujourd’hui les banques de sons libres de droits. Une entreprise nommée Anymind semble particulièrement prégnante sur le secteur, puisqu’elle a conçu deux gros tubes à la Hans Zimmer qui n’existent que pour être utilisés sur des vidéos courtes, « The Begin » et « Time and Hope ». Vous les avez forcément entendus si comme moi vous doomscrollez sur IG (et désolé du coup de vous les remettre en tête).
Mais au passage, j’ai donc aussi découvert que certains habillages récurrents pour shorts et reels avaient bel et bien de vrais auteurs : c’est le cas du « Dramamine » de Flawed Mangoes, projet du Californien Evan Lo. La musique de ce jeune artiste, qui cumule aujourd’hui plus de 300 millions de streams sur Spotify, est associée au style hopecore, dont quelques autres morceaux représentatifs ont d’ailleurs déjà eux aussi été « enreelés ». Si Lo trouve ça cringe de s’identifier à un nouveau nom de genre musical, comme il l’explique dans une interview, disons juste que le hopecore est une esthétique Internet à laquelle son travail s’est trouvé liée, dont les participant/e/s se remontent le moral mutuellement, la musique allant fondamentalement de pair avec une succession de trends, de mèmes, et de reels.
Il se trouve qu’au passage aussi, j’ai découvert que « Dramamine » était un morceau de guitare, ce qui, pratiquant l’instrument depuis un certain temps, m’a plutôt étonné. D’abord je n’aurais pas parié que cette rythmique de type aksak (un découpage des temps qui les rend syncopés et boiteux) et cette mélodie tortueuse puissent produire un tel tube, l’immense majorité des hits ayant des rythmiques binaires simples. Encore plus étonnant, ce son flottant vient de deux guitares superposées, et non pas d’une machine comme je le pensais. Il s’agit même de deux guitares assez virtuoses, et bizarrement comme si de rien n’était. Un trait de caractère plus qu’intriguant dans un milieu guitare où la discrétion n’est que rarement cultivée et où la démonstration de force et de technicité est quasiment un passage obligé – qui sait bien jouer le montre beaucoup, c’est la règle.
Or, s’il a beau avoir fait la couverture de guitar.com, Evan Lo a un côté guitariste de circonstance. Il explique d’ailleurs qu’il est revenu à la guitare après d’autres aventures, notamment dans la vaporwave, qu’il est loin d’en faire une obsession. Même son petit truc technique (sur lequel je vais revenir) tient surtout à un copain qui par hasard désossait une autre guitare pas loin de lui et qui lui a filé une pièce à réutiliser.
En interview, Lo se présente comme un guitariste qui n’en a rien à faire de la guitare, qui dégenre et déjoue l’instrument avec naturel. Dans « Dramamine », il arrive donc à faire sonner sa guitare comme un autre instrument – c’est le seul titre où il y arrive aussi bien pour être honnête, le reste sonnant parfois encore très math rock.
S’il superpose assez classiquement deux parties de guitare avec une pédale de loop, Evan Lo utilise aussi la technique plus rare du killswitch, c’est-à-dire qu’il joue avec le selecteur des différents micros pour couper le son brusquement et créer des absences et des coupures sèches, au lieu d’avoir des accords qui résonnent. Il n’est pas évidemment pas le premier à se servir du sélecteur : certains y ont recours pour profiter en cours de morceau de la couleur propre à tel ou tel micro. D’autres encore, comme Jonny Greenwood de Radiohead ou Tom Morello avec Rage Against the Machine, l’utilisaient déjà façon killswitch. Morello, c’est connu, allait jusqu’à « scratcher » en reproduisant presque exactement sur sa guitare le geste des DJs avec le crossfader. Evan Lo est néanmoins le premier artiste à faire en sorte que son recours au killswitch produise un son aussi ambient – genre qu’il aime assez pour aussi placer des reprises d’Aphex Twin dans des lives.
L’histoire de la guitare électrique ne manque pas de tentatives pour la faire sonner comme un autre instrument et jouer le mimétisme. Chez Hendrix, c’est le doublage et le remplacement des cuivres dans un orchestre qui l’a amené à construire un son particulier aussi ample. Aujourd’hui, les accessoires pour s’approcher du son d’un violon ou d’un clavier font partie des sonorités à portée de main. C’est l’affaire de quelques pédales ou d’un ebow, littéralement un e-archet, un instrument émettant un petit champ électromagnétique qui maintient une note infinie sur la corde. Mais rien là dedans qui ne sonne pas comme une guitare imitant un autre instrument. Et rien qui ne s’intéresse aux autres instruments autrement que pour se les approprier. La guitare électrique finit toujours par à nouveau sonner guitare à un moment ou un autre, dans une forme d’impérialisme instrumental.
Or, « Dramamine » fait exception à cette règle, et le titre s’avère d’autant plus intéressant que ce killswitch va de pair avec du tapping, , technique consistant à taper la corde directement sur le manche, inventée par un Eddie Van Halen au pic de la virilité hard rock eighties et prolongée ces dernières années dans des formes de math rock souvent inécoutables : ralenti pour une balade et rendue inaudible dans sa technicité, le tapping perd toute sa charge d’incel music.. Evan Lo accomplit donc l’exploit d’avoir été adoubé – plus ou moins sans le chercher – par la « commu » des gratteux, alors que son jeu n’est ni caractérisé par une vitesse sidérante, ni par l’usage d’un pedal board plus massif ou de guitares hors de prix – sa Telecaster est carrément mexicaine, même pas américaine, et encore moins vintage !
Non loin de lui, un autre guitariste et songwriter américain a attiré mon attention pour des raisons similaires : Mk.gee. Ce natif du New Jersey, Californien d’adoption depuis ses études de musique, noie les cordes de sa Fender Jaguar (d’habitude pas du tout un modèle pour virtuoses) dans des effets grandioses. Si la guitare reste présente, c’est à travers quelques traits, mais largement dissous dans de très belles chansons comme « Candy (live) ». Sa six-cordes a l’air comme mixée depuis le hall d’une friche industrielle abandonnée, avec des résonances et des absences étranges : Mk.gee sonne à mes oreilles comme quelqu’un qui reprendrait les stridences et les accords du Prince des années 1980 là où ils étaient restés, dans leur versant le plus expérimental et saturé, avec d’ailleurs la même tendance à pratiquer ce jeu sonore typiquement princien sur le surmix des titres au bord des limites (une habitude qui rendait dingue les ingénieurs du son du musicien de Minneapolis).
Ce que j’aime bien chez Mk.gee, c’est qu’il met en boucle le mimétisme sur lui même, un peu comme ce type qui avait fait une vidéo « VHS copied to VHS copied to VHS copied to VHS copied to VHS ». Il reprend le son mixé et strident d’une clavier-guitare des années 1980 qui lui même imitait de loin la guitare, en l’injectant dans l’esthétique passée et distante de la vieille cassette d’autoradio (même si lui n’a que 29 ans et n’était pas dans la voiture). Il le fait littéralement, d’ailleurs, puisqu’il doit une partie de son esthétique à un enregistreur quatre pistes Tascam cassettes détourné comme une pédale d’effet (pour ceux que ça intéresse le détail technique est là).
Certes, Mk.gee comme Flawed Mangoes n’inventent rien en suivant cette démarche, ils copient des musiques à la guitare, mais en cherchant moins à imiter un instrument qu’une texture, il se produit quelque chose d’intéressant : à refaire des sons qui tiennent parfois surtout au mix et au vernis de l’ingé son, à travailler le mastering plus que les instruments, ils décloisonnent au passage la guitare de manière assez inédite.
Mk.gee n’est pourtant pas loin d’une logique du gratteux solitaire qui s’est popularisée ces dernières années via les tutos YouTube et les influenceurs guitare comme Rick Beato. Mais il en fait autre chose, sans se limiter au seul plaisir de sonner comme un autre, le temps d’un riff, parce qu’il aurait acheté le bon matériel : par exemple, il désaccorde aussi sa guitare jusqu’à en faire un instrument baritone, à mi-chemin de la basse et de la guitare (ce qu’on pourrait comprendre comme la fusion de deux rôles autrefois distribués dans un groupe entre plusieurs personnes).
Ces deux artistes construisent quelque chose dans le sillage du covid, qui a tenu une génération à distance de l’exercice du concert-performance et des formes de compétitions dans et entre les groupes. Ils sont aussi les héritiers d’une individualisation de cet instrument (on joue statistiquement bien moins en groupe ces dernières années), et sûrement d’une nouvelle vague de féminisme et de progressisme sur une génération qui a grandi avec et l’intègre spontanément à ses pratiques – jusqu’à déconstruire en retour un instrument pourtant chargé de virilité historique, l’air de rien.