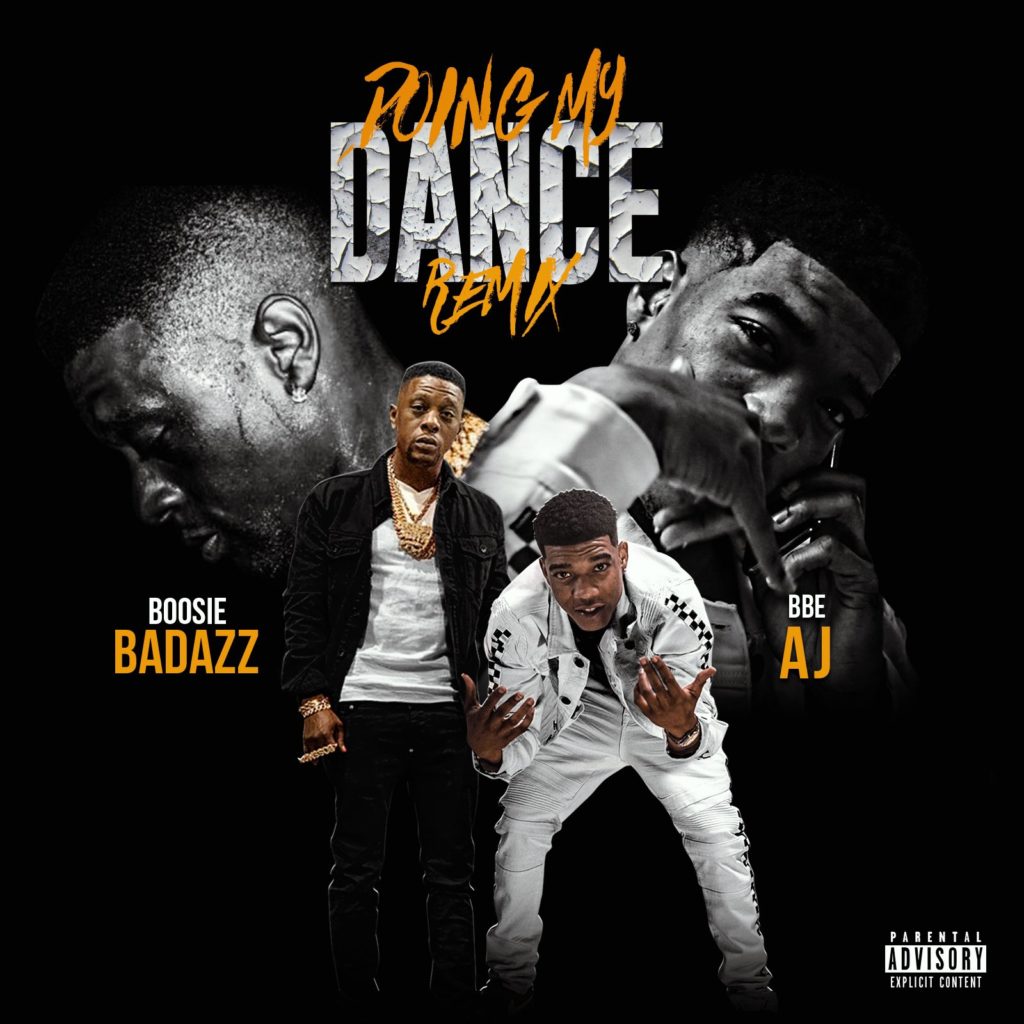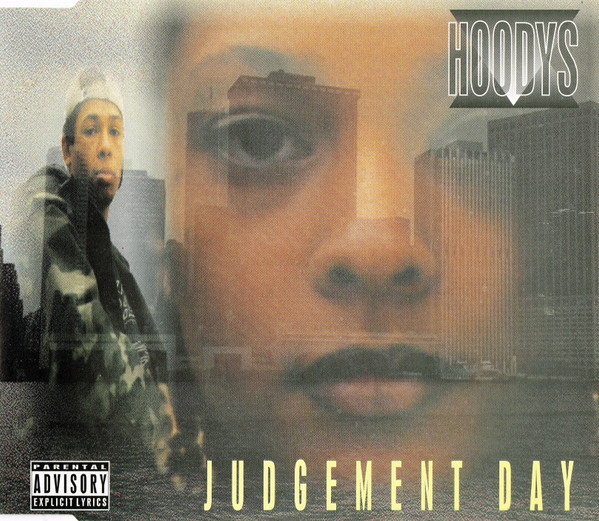Je n’ai jamais été sensible au rap de Machine Gun Kelly, aujourd’hui rebaptisé mgk. Je trouve son flow artificiellement technique, son placement de voix irritant et ses métaphores convenues ; quant à son idée de provoquer Eminem à coups de diss tracks, j’admettrai qu’elle dénote au moins un certain courage, pour ne pas dire une forme d’inconscience… En 2020, j’avais jeté une oreille curieuse à son incursion dans l’emo rock avec son album Tickets To My Downfall, mais les mélodies et les paroles m’avaient semblé très plates. Bien qu’amusé par l’initiative, je m’étais rendu une fois de plus à l’évidence : sa musique ne me parlait pas. Pourtant, quelques années plus tard, un morceau de mgk (ou plus exactement, une moitié de morceau) allait revêtir pour moi une importance presque vitale. La musique a ceci de magique, qu’on ne choisit pas par quoi on est touché…
En juillet 2025, j’ai perdu ma mère. Elle se battait depuis un an contre un cancer « rare et agressif », comme l’avaient qualifié les médecins. Le jour où elle est partie, je m’étais rendu en Lorraine, à la clinique où elle était soignée, pour lui dire un dernier au revoir. Elle respirait encore, mais était déjà inconsciente. L’infirmière m’a confirmé qu’il s’agissait de ses ultimes instants, que ne ce n’était plus qu’une question de jours, au mieux. J’ai rassemblé mon courage, et j’ai dit à ma mère tout ce que je voulais lui dire. Je lui ai promis que je serais heureux, que j’aurais des enfants un jour, et que d’ici là, je continuerais à être un bon oncle pour ma nièce, elle qui aurait bientôt son brevet puis son bac… Quelques heures plus tard, j’ai pris un TGV pour Paris, histoire d’aller chercher des affaires en prévision des obsèques qui ne tarderaient malheureusement pas à venir. J’ai reçu un appel de la clinique m’annonçant le décès de ma mère à l’instant même où le train a démarré. J’ai simplement répondu « d’accord », puis j’ai raccroché. Alors que le paysage commençait lentement à défiler, j’étais comme abasourdi. Je me trouvais dans un carré de quatre, et je ne parvenais pas à m’écrouler face à ces inconnus qui ignoraient tout de la peine immense qui venait de me frapper. J’avais une impression de vide et surtout, de silence. Machinalement, j’ai pris mon iPhone et ouvert Spotify ; j’ai toujours eu pour habitude de mettre en musique les moments importants de ma vie, et je voulais tenter d’en faire de même pour celui-ci. Mais que choisir dans un moment pareil ? Comment être à la hauteur de la gravité de la situation ? Et est-ce que je ne risquais pas d’entacher à jamais un morceau que j’aimais en l’associant à une expérience si douloureuse ? Je suis resté de longues secondes immobile, à fixer l’écran de mon téléphone, sans parvenir à prendre une décision. Je finis par m’en remettre au hasard d’une playlist. J’ai tapé « grief country » dans la barre de recherche, espérant qu’une compilation éponyme existe déjà, ce qui était le cas. Il y avait Brad Paisley, Cole Swindell, Chris Young, Diamond Rio… J’ai appuyé sur lecture, et je me suis endormi presque aussitôt. À mon réveil, le train arrivait à la gare de l’Est. La playlist continuait de jouer dans mes oreilles. Je l’ai laissée tourner sans y prêter attention jusqu’à ce que j’arrive chez moi, marchant comme un robot dans les rues et les couloirs du métro. Une fois entré dans mon appartement, j’ai enlevé mes écouteurs et suis allé me coucher. Je n’arrivais toujours pas à pleurer.
Ce ne fut pas le cas les semaines qui suivirent. Le manque, les obsèques, la maison à vider, les photos qu’on retrouve… J’ai parfois eu l’impression de me noyer dans mes larmes. L’été était à son apogée, mais je me sentais fatigué et froid. Le soleil du mois d’août dardait ses rayons et moi, je déambulais, hagard, au milieu de cet enfer blanc et chaud. J’avais remisé mes écouteurs sur un meuble dans mon entrée, je n’ouvrais plus Spotify, je n’allumais plus ma chaîne hi-fi. Pour la première fois, je n’avais pas envie de musique. Pour la première fois, je préférais le silence aux décibels.
Il m’a fallu presque deux semaines pour retrouver le goût des notes. Ce jour-là, je me rendais dans le Sud pour répandre les cendres de ma mère dans la Méditerranée. J’étais une nouvelle fois dans un TGV, et je ne pouvais envisager un voyage en train sans musique – ce trajet était d’autant plus significatif que c’était sur cette même ligne que j’avais découvert l’un de mes groupes préférés quelques années plus tôt. J’ai commencé par des choses tristes, de circonstance : de la musique classique d’abord (des requiem ou des stabat mater), puis 808s & Heartbreak de Kanye West, plusieurs fois d’affilée. À environ une heure de l’arrivée, j’ai eu envie de plus de légèreté. Je me suis alors rappelé de memes que j’avais vus sur le nouveau single de mgk, présenté comme une daube mainstream beaucoup trop sucrée. Ayant toujours eu un faible pour les chansons cheesy, je décidai de laisser une chance à cet artiste qui m’avait toujours laissé de marbre jusque là. Le morceau en question s’appelait cliché, et figurait en deuxième position sur la tracklist de Lost Americana, le dernier album en date du rappeur devenu chanteur. Après quelques secondes de lecture, le verdict était clair : pour être sucré, c’était sucré… mais pas déplaisant du tout. Le songwriting était bon, et le côté pop tellement assumé qu’il en devenait presque une posture (d’où le titre du morceau). Après des années de déception, mgk était enfin parvenu à me surprendre en bien. Ce n’était pas transcendant, mais très agréable tout de même. Encouragé par cette bonne impression, je décidai d’écouter l’album dans son intégralité. Le premier titre s’appelait « outlaw overture » et commençait par un synthétiseur strident rappelant le début de « Money For Nothing » de Dire Straits. S’ensuivait une chanson aux accents pop punk, sympathique mais pas vraiment mémorable… du moins dans sa première partie. Car autour de la troisième minute, un cataclysme s’est produit : le synthé de départ est réapparu dans une sorte d’apothéose, avant de se taire brusquement. Il a alors laissé la place à deux guitares acoustiques jouant un air plus calme. Dénué de tout effect vocal ostensible, mgk entamait un nouveau refrain sur ces arrangements apaisés : Take me somewhere cheap, where the living is easy / Out of all their reach, set my spirit free. En entendant ces mots, je ressentis instantanément une chaleur autour de moi, comme si quelqu’un m’enlaçait doucement. J’avais l’impression de flotter à quelques centimètres au-dessus de mon siège. Mgk parlait ensuite de sa difficulté à être au monde, puis de sa volonté de prendre un nouveau départ : Survived being insecure but it led to my decline / This time I don’t think I’ll turn back, this time I’m gonn’ do shit my way / I’m gone by the time they come back, this route is a one-road highway. Quelque chose dans son chant me faisait du bien, et me donnait à croire que tout allait s’arranger. Sitôt le morceau fini, j’ai glissé mon doigt sur le curseur pour rembobiner et réécouter ces deux minutes magiques. J’ai répété l’opération plusieurs fois, plongeant à chaque reprise plus profondément dans un bien-être inédit. Les paroles prenaient de plus en plus de sens au fil des répétitions, me donnant le sentiment que mgk s’adressait à moi personnellement, nos deux expériences se fusionnant en une. J’avais toujours du chagrin, mais je ne me sentais plus seul dans ma peine. Mieux encore, j’avais la conviction que je sortirai plus fort de cette période si troublée. Une promesse radieuse m’était faite, dont j’avais la certitude qu’elle serait tenue. Je venais de trouver la chanson de ma renaissance future.
Cette fameuse moitié de morceau, je l’ai écoutée des centaines de fois dans les mois qui ont suivi ; tantôt pour bénéficier de ses effets, tantôt pour percer son mystère. Qu’avait-elle de si spécial pour avoir un tel effet sur moi ? J’ai lu et relu ses paroles jusqu’à l’obsession, fredonné sa mélodie sans relâche… J’avais toujours cru au pouvoir de la musique, mais je n’avais jamais rien vécu de comparable. Des tas d’artistes avaient traversé ma vie auparavant, m’avaient touché, inspiré, motivé… Aucun n’était devenu mon compagnon à ce point. Comble de l’improbable, il avait fallu que ça tombe sur mgk. Lui qui m’avait toujours gêné aux entournures, voilà qu’il s’était mis à parler à mon âme… À la suite de ce petit miracle, j’ai aussi beaucoup écouté Lost Americana dans son intégralité. Peut-être suis-je complètement biaisé, mais je trouve que c’est un excellent album. J’ai essayé de vanter ses mérites auprès de nombreux amis, sans succès. Les réactions étaient toujours les mêmes : « mgk, t’es sûr ? » ; « ma meuf me laissera jamais mettre ça en voiture » ; « euh ok, mais non merci… ». Visiblement, je n’étais pas le seul à avoir des a priori sur l’intéressé. Je ne me suis jamais vexé face à ces refus. Lovée au creux de mes écouteurs, « outlaw overture » continue de me guérir, en secret…
Depuis le décès de ma mère, j’ai changé tout mon mobilier, adopté un chat, fait du bénévolat à l’Armée du salut et me suis remis à la muscu. Je suis toujours traversé par des sursauts de nostalgie, voire de franc chagrin certains jours. D’autres fois, je me sers de cet évènement comme d’un moteur pour continuer à avancer, et j’essaye de mener une vie plus harmonieuse et épanouissante. Et lorsque viennent les moments où je cherche à donner du sens à ce malheur, je me souviens des mots qui clôturent le morceau le plus important de ma vie : What’s left behind, what’s left behind, can’t take it with me / Nothing’s left behind, nothing’s left behind, can’t take it with me. Pour moi, ces deux phrases juxtaposées ne sont pas une contradiction ; elles sont la preuve que deux choses peuvent être vraies à la fois. Le malheur et le bonheur. La tristesse et l’espoir. Je me dis alors que la vie est loin d’être totalement tragique, et je repars de plus belle.