Longtemps j’ai tiré une certaine fierté à mettre la main sur quelque chose de rare. Cette sensation à la fois d’élection (et donc d’orgueil), mais aussi d’excitation à me dire que j’allais peut-être être à la source d’un bouleversement chez mes amis, me paraissait suffisante – l’œuvre passait après. J’ai tenu un blog dans ce sens avec un ami il y a quelques années, nous y recensions des films rares de cinéastes connus ou méconnus, parfois totalement inconnus, afin de faire découvrir (et espérer peut-être une ressortie en salle), mais aussi dans le but, moins avouable, de briller aux yeux des autres. Le digger agit toujours un peu par vanité mais il lui reste tout de même la petite joie, non-narcissique, d’avoir pu exhumer un film, un album ou un livre des limbes dans lesquelles la marche du temps, la surproduction, l’injonction incessante à la nouveauté ont pu les jeter. C’est ce que je me dis maintenant en tout cas, même si à l’époque c’était plus bordélique que ça.
En avançant dans la vie, je constate que cette recherche frénétique du rare – qui, pour moi à ce moment, voulait dire beau – s’est un peu étiolée, voire a complètement disparu au profit d’un désir plus calme, moins exalté et au fond plus durable : comprendre, m’attarder sur ce que j’aime, et explorer mon goût. J’enfonce une mini-porte ouverte en disant ça, mais si je le précise c’est que l’album dont je vais parler est venu raviver avec joie cette logique, alors que ça faisait longtemps que les choses dites « rares » frayaient leur chemin loin du mien, m’étant habitué, pantouflard, à écouter des albums de groupe dont je connaissais le nom ou à me contenter, en guise de découvertes, de noms qui avaient un lien avec eux.
Là, il s’agit donc d’autre chose, j’ose même le dire, d’une vraie épiphanie. C’est au détour d’une mixtape faite par un ami que j’ai découvert « Born 2 Be Fly », morceau de hip-hop étrange qui, à la première écoute, m’a semblé un peu nul, avec son flow frêle, voire mal scandé. La seconde m’a percuté cependant, notamment par le biais de ce son synthétique qui va et vient comme une houle jusqu’à éclater à la fin – une dynamique et une sonorité assez incongrues pour le genre, dont je ne suis certes pas un expert. M’étant empressé de demander à mon ami à peu près tout ce qu’il savait sur ce morceau, c’est comme ça que j’ai fini par tomber sur le long format Da’Brats from Da’Ville des Fly Girlz sorti en 2009, dont j’ai pu écouter quasiment tous les morceaux sur YouTube.
J’étais donc bien heureux de savoir qu’il y avait d’autres morceaux et qu’il ne s’agissait pas d’une occurrence isolée. Il y avait quand même une petite appréhension avant d’écouter l’album, car j’avais peur que celui-ci ne prolonge pas la bizarrerie du premier morceau. Je pressentais tout de même être au seuil de la rareté, et la pochette de l’album – assez moche il faut le dire, rose et blanche, avec ces six ados nonchalantes et cette typo mi-random mi-ringarde – me confortait dans cette idée ; je retardais donc le moment qui allait confirmer ou pas cette intuition.
Pourtant dès le deuxième morceau, « Tired », j’ai compris que j’étais tombé sur une sorte de trésor : beat sec, basse lancinante agrémentée petit à petit de bleeps électroniques et de la boucle vocale d’une des ados réverbérée, oscillation insolente ; puis le premier flow, plaqué d’une traite, assuré mais en même temps bancal, le tout formant un truc qui me transportait comme rarement dans mon quotidien récent. Je pense que c’est ce mélange de fragilité de voix adolescentes qui ne portent pas trop et d’assurance dans la façon de chanter qui m’a le plus interpellé et qui est resté dans ma tête longtemps après la première écoute. La musique qui accompagnait ces voix, je l’ai saisie après, ce qui est venu donner encore plus de coffre à cette sensation grisante.
Le reste de l’album se déployait devant moi en ne cessant de m’émerveiller, je prenais pas mal de temps entre chaque morceau avant de l’écouter, pour que le moment ne passe pas trop rapidement. Un peu comme quand on commence à lire une phrase qui semble vous être destinée, où l’on retarde le moment de la finir.
Mais avant que je continue de parler de mon ressenti, c’est quoi cet album en fait ? En l’écoutant, je me disais que j’avais affaire à une expérience chelou faite par des ados, belle et hasardeuse, en tout cas d’un truc obscur et marginal ; mais en me renseignant, l’excitation s’est un peu estompée. L’album est donc le fruit d’une collaboration entre Nathan Corbin – aka Zebrablood, « artiste interdisciplinaire américain basé à New York travaillant dans le cinéma et le son » comme le dit sa bio, proche de HTRK et membre de Excepter, qui a par ailleurs sorti un split avec CS + Kreme sur Efficient Space sous le nom Blazer Sound System – et six ados d’un collège difficile de Brownsville, quartier de Brooklyn connu pour ses rappeurs assez peu gentrifiables tels que MOP, Boot Camp Click, AZ, Smoothe da Hustler ou encore l’incroyable Ka. C’était donc moins chaotique que ce que je pensais, mais une oreille plus avertie que la mienne l’aurait direct grillé à la première écoute, je pense. Par ailleurs, l’album fait partie du programme Representing NYC initié par Sam Hillmer – musicien free/noise/expé/arty (rayez la mention inutile), entre autres membre du groupe Zs –, dont le but est d’aider des jeunes de quartiers difficiles à s’exprimer et s’épanouir à travers la musique en les associant à des musiciens confirmés de la scène indépendante new-yorkaise. L’album des Fly Girlz (un terme né dès les débuts du hip-hop pour désigner les membres du mouvement de genre féminin) se situe du coup à la croisée des chemins d’un projet, disons, d’éducation périscolaire – d’où le côté un peu bricolo-hasardeux de certains morceaux (« Welcome to Brownsville » et surtout « Love Hurtz ») – et d’un album de producteur expérimental aguerri.
Un morceau sort du lot en cristallisant bien ces deux trajectoires, « I Could Give You Reasons », souvent cité dans les rares occurrences des Fly Girlz sur Internet, et il est aisé de comprendre pourquoi. Dès les premières secondes, on est saisi par cette vague de synthés qui semble venir de loin pour s’échouer devant nous, un va-et-vient qui se répète tout au long du morceau ; une autre nappe s’y mêle, dessinant ce qui semble être le paysage intérieur d’un amour qui grandit en elles, vaste et ample, peut-être trop grand justement, qui les effraie et les ravit. Les paroles, qui forment une litanie de trois phrases sur le fait de ne pas réussir à expliquer pourquoi elles tombent amoureuses, s’estompent et laissent place à une nouvelle étendue, allégorie permettant de mesurer pleinement ce que c’est de tomber amoureuse pour la première fois. Mais le chant laconique des filles transforme lentement la chanson de manifeste à complainte, et vient contrarier la gaieté du message. Elles ont beau parler de quelque chose d’a priori réjouissant, on sent autre chose les grignoter et les empêcher de pleinement croire en cet amour naissant. La plupart des tracks sont construits ainsi en fait, autour de ce mystère logé dans la voix qui vient contredire ce qu’on entend – mystère sans doute propre à la jeunesse dont les accents ne sont pas au diapason des paroles.
Ce qui me touche aussi beaucoup dans l’album, c’est la place que chacun y trouve : entre le flux saccadé des jeunes rappeuses et les prods élégiaques de Zebrablood, un équilibre advient qui semble créer de l’humain, un vrai projet solidaire qui m’a l’air honnête et pas chiqué, pas juste un truc branché pour musicien indé qui veut se donner une street cred’ politique. La franchise totale avec laquelle l’album a été conçu m’émeut et même, à force de l’écouter, je me dis que j’ai affaire à la dernière lettre que quelques ados nous adressent d’une époque qui leur a été à la fois triste et gaie, pleine d’ennui et d’excitation, qu’elles n’ont pas vraiment comprise mais qu’en tout cas elles ne reverront jamais. Elles ont grandi depuis.



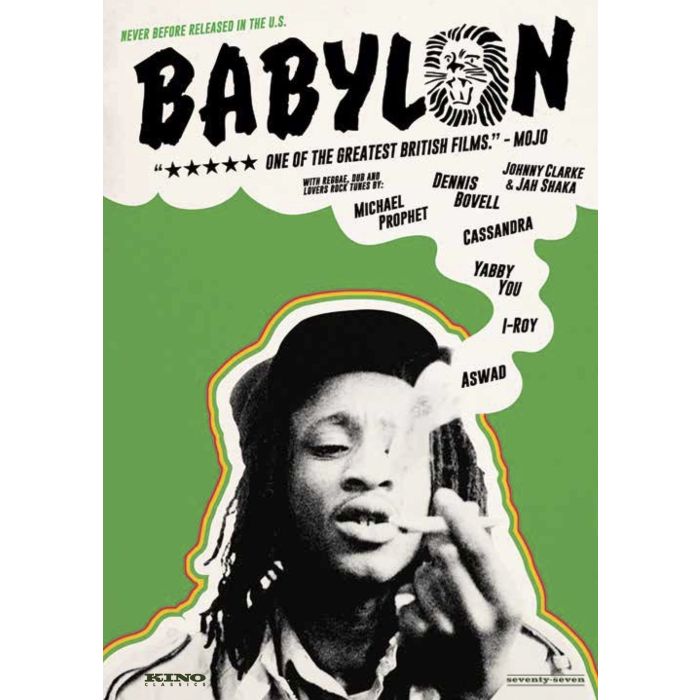
![Musique Journal - La vie quotidienne des machines [notes sur quelques sorties électroniques]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2020/10/musique-journal-a2274085080-10-1024x1024.jpg)