« Point » pourrait aisément constituer l’un des exemples méritants d’une catégorie d’albums ayant dû succéder, malgré eux, au magnum opus, au chef-d’œuvre généralement reconnu comme tel, à la tentative (réussie) d’un artiste d’accomplir un acte à la mesure de son ambition, de son génie créatif — et à laquelle les critiques et les fans ne cesseront de le ramener. Lorsque le quatrième album de Cornelius paraît en 2001, l’artiste japonais a précédemment signé Fantasma, pièce-maîtresse de sa discographie (et parmi les plus importantes productions musicales japonaises, sans aucune exagération), d’une audace et d’une versatilité inouïes, qui lui aura conféré un statut de démiurge, et sur lequel nombre d’articles élogieux ont été rédigés depuis, aux quatre coins du monde.
Plutôt que de tenter d’en reproduire l’amplitude, de réitérer un tel tour de force, Cornelius préféra alors privilégier une certaine retenue, une quiétude qui m’a toujours paru bienvenue. Bien sûr, quelques-unes de ses compositions y sont toujours très frénétiques — il est passé maître dans l’art de la rupture de ton, de l’ambivalence et de la variation de rythmes, jusqu’à être parvenu à produire, aujourd’hui, une musique que l’on pourrait presque qualifier d’arithmétique —, et la seule écoute d’un titre comme « Another View Point » suffit à dynamiser l’ensemble d’une toute autre manière, au point d’évoquer le mouvement incessant (et éprouvant) qui peut animer n’importe quelle métropole. Mais j’estime surtout cet album pour sa nature apaisée, son infortune, son détachement et sa renonciation pleine d’entrain, et m’y attarde toujours avec beaucoup de bienveillance.
L’apparente humilité de « Point » n’a jamais dissimulé une quelconque faiblesse ou un manque d’inspiration. Il est assez aisé de se projeter, depuis le quartier discret de Meguro à Tokyo (l’indication from Nakameguro to everywhere, 45’29 » paraît elle-même sur la cover), dans lequel résidait alors Cornelius (de son vrai nom Keigo Oyamada), préférant déserter un temps la marche du monde et s’abandonner aux rêveries ; sur le littoral (les sonorités aqueuses y sont particulièrement présentes, s’insinuant çà et là, en ouverture et en fermeture de certains titres, ou tout au long parfois) et dans des milieux plus ruraux (le recours au field recording, là aussi : le bruit de la pluie, des chants d’oiseaux et de grillons), notamment sur les ravissements que sont « Bird Watching At Inner Forest » et « Drop », sûrement le titre le plus réputé de l’album. Lorsque le tumulte et la clameur de la ville résonnent à nouveau, sur le titre « I Hate Hate », le silence est presque aussitôt imploré ; un chuchotement se répète jusqu’à ce que le calme revienne et que l’on perçoive seulement l’aboiement d’un chien en pleine nuit, dans l’une de ces paisibles banlieues pavillonnaires de Setagaya, ou d’ailleurs — cela importe peu. A ce titre, « Nowhere » et « Tone Twilight Zone », dont on jurerait qu’est est extraite du soundtrack d’un jeu Animal Crossing (probablement l’univers le plus paisible qui soit) revêtent, d’une manière plus significative que les autres, cette insouciance et cette tranquillité d’esprit, et figurent sans doute parmi mes préférées.
Ce sont ces interstices en particulier, ces moments de repli et d’intimité qui me captivent, et me font penser, soit dit en passant, qu’ils ont dû tout autant marquer l’esprit de Panda Bear lorsqu’il concevait son grand œuvre (honnêtement, il est aussi assez difficile de ne pas être touché par la candeur excessive et la limpidité de Person Pitch) ou Buoys, son dernier album en date, lui-même partisan d’un certain minimalisme et animé par la même tentation de l’évaporation, déambulant, anonyme, dans Lisbonne (sa ville de résidence).
Point, dont la réédition est finalement prévue cette année, paraissait également au crépuscule du Shibuya-kei, et dissimule, sous des airs désinvoltes, une douce mélancolie. Cornelius fut l’un des chefs de file de cette scène (bien que Point et Fantasma évoluent au-delà), nommée d’après un quartier emblématique et vivace de Tokyo.
Dans un jazz bar de Mitaka, l’un des clients japonais m’affirma un soir, au sujet du Shibuya-kei, qu’il ne serait « non pas défini par ce qu’il est, mais davantage par ce qu’il n’est pas ». Je dois dire, pourtant, qu’il est plutôt rare (dans mon cas du moins) de découvrir un genre musical aussi facilement identifiable, dont les propriétés sont si bien définies. Le Shibuya-kei marque lui-même la fin d’une époque. Lorsqu’il survient, la société japonaise assiste à la déchéance de son système économique. La bulle spéculative, pinacle du miracle japonais, éclatait en 1990 et entraînait le pays dans une période terne et monotone (la décennie dite perdue), inversement proportionnelle au faste et à l’extase des années 80, époque où les Japonais célébraient avec éclat l’incroyable essor économique de leur pays et les plaisirs d’une vie citadine confortable et insouciante — dont on retrouve les traces à travers les multiples productions city pop, aujourd’hui rééditées et consommées jusqu’à l’indigestion en Occident (au passage, Resident Advisor a récemment publié un article intéressant à ce sujet, d’un point de vue japonais).
Le Shibuya-kei pourrait dès lors constituer — et il s’agit là de ma propre intuition, ou en tout cas de l’idée qui me séduit le plus — la meilleure réponse qui soit d’une partie de la jeunesse, elle-même concernée par le dérèglement économique du Japon : l’édification d’un monde utopique, d’un univers inoffensif, excessivement coloré, festif et enrichi d’une multitude d’influences. Disons, au hasard, l’imaginaire américain des sixties et notamment la Sainte Trinité Bacharach/Wilson/Spector, la chanson française, et en particulier le couple Gainsbourg-Birkin, l’easy-listening, la musique brésilienne, Joe Meek et les Tornados, l’esthétisme du Swinging London, la musique dite d’ascenseur et l’orgue Hammond, les bandes originales des films de Stanley Donen et de Blake Edwards…
Je dois admettre que cela peut paraître un peu rébarbatif en théorie, mais ce sont finalement moins ces innombrables influences que certaines caractéristiques positivement singulières du Shibuya-kei que l’on retient le plus à l’écoute. Je ne me souviens plus très bien du premier titre que j’ai entendu (ce devait être un single de Towa Tei, étant donné qu’il faisait partie de Deee-Lite, c’est lui qui apparaît d’ailleurs dans le clip de « Groove Is In The Heart », que j’écoutais alors), mais je me rappelle avoir été absorbé aussitôt, ou plutôt propulsé vers cette sphère et avoir dû écumer des blogspots (en espagnol, d’ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi) à la recherche d’albums à télécharger. Ce devait être en 2008, bien après l’extinction d’un genre qui n’a donc finalement subsisté que quelques années et dont l’apogée doit se situer quelque part entre 1997 et 2000.
J’ai pu repérer peu à peu les attributs du Shibuya-kei et les artistes associés au mouvement. Des appellations aux accents enfantins : Hazel Nuts Chocolate, Fantastic Plastic Machine, Buffalo Daughter ou Capsule, qui me rappelaient à juste titre l’unique album d’un duo féminin de Glasgow, Strawberry Switchblade — littéralement « un couteau à cran d’arrêt à la fraise » — sorti en 1985 et devenu extrêmement populaire au Japon, et dont le titre « Ecstasy » aurait pu avoir une influence considérable sur le genre tant il sonne Shibuya-kei. De l’excentricité et des expressions béates, une mélancolie quasi inexistante, ou anodine lorsqu’elle survient, traduisant tantôt l’humeur chagrine d’un jour pluvieux, ou la torpeur suscitée par la chaleur excessive des îles japonaises, dans l’océan Pacifique, entre le sommeil et l’éveil (« Flow In a Tide » de Takako Minekawa, « Jellyfish Blues » de Buffalo Daughter, « Sleep Warm » et « Nowhere » de Cornelius, mentionné précédemment), héritée, selon toute vraisemblance, d’une certaine tradition nippone et remarquée (à quelques occasions, rares mais significatives) aussi bien chez Haruomi Hosono et Yellow Magic Orchestra (« Nettaiya », « Pacific » et « Simoon », lui-même très proche des sonorités du Shibuya-kei), Yuji Ohno (le merveilleux album-concept Lifetide), Hiroshi Sato et Yuji Toriyama, Casiopea, Tin Pan Alley ou le Sadistic Mika Band.
Les précurseurs du mouvement s’appelaient Flipper’s Guitar. Leur nom pourrait ne pas interpeller, mais ce fut en tout cas le premier projet officiel de Keigo Oyamada, aux côtés de Kenji Ozawa, qui ont tous deux débuté en 1989, avec deux albums particulièrement flamboyants et représentatifs de la scène de Shibuya — à titre d’exemple, l’un d’eux s’avère être une ode aux vertus du café au lait au petit déjeuner (« Coffee-Milk Crazy »), un autre est tourné en 8mm dans les rues de Paris (« Young, Alive, In Love »), dans lesquelles les deux jeunes artistes déambulent, non sans naïveté, à la découverte des éléments les plus saillants de la culture parisienne. Ils signeront un troisième et dernier album (avant de se séparer, du fait de tensions survenues au cours de l’enregistrement) qui, s’il n’est nullement associé au Shibuya-kei, a le mérite de présenter l’un des rares essais (voire le seul à ma connaissance) de baggy et de shoegaze japonais, notamment le somptueux « Aquamarine », très semblable aux productions de My Bloody Valentine.
Ozawa paraîtra l’année suivante sur l’un des premiers titres de hip-hop japonais (« Kon’ya Wa Boogie Back », avec Scha Dara Parr) et entamera une carrière solo plutôt instable, et Keigo Oyamada adoptera à ce moment-là le surnom de Cornelius. Il est également une figure que j’affectionne peut-être encore davantage, et qui incarnerait le plus, à mes yeux, l’esthétique du Shibuya-kei. La destinée du groupe Pizzicato Five, fondé en 79, s’est transformée de manière radicale à l’arrivée de Maki Nomiya en 1990, devenue en quelques temps la figure de proue, charismatique et classieuse, du mouvement japonais, de son hédonisme, de ses traits d’humour légèrement taquins et de son attrait pour les cultures d’ailleurs, spatiales et temporelles.
Le Shibuya-kei semble avoir prolongé l’insouciance des années 80, jusqu’à l’excès, en un élan profondément régressif, retenant de manière capricieuse et infantile les choses les plus plaisantes, les plus ludiques d’une situation donnée, rejetant le reste, jusqu’à en étouffer toute forme de réalisme. C’est Towa Tei qui convie Kylie Minogue sur « GBI (German Bold Italic) » et que celle-ci se prête au jeu, se dévêtant au début du clip et corrompant, avec intention, son image relativement lisse de pop star, puis qu’elle traverse les avenues de Tokyo, vêtue d’un kimono et follement maquillée, dans un Japon morne et dénué de coloris, symbolisant avec exactitude la place du Shibuya-kei en cette période morose, en cette réalité si peu fantasque. C’est Yoshinori Sunahara qui se décide à produire un album en hommage à la défunte Pan Am Airways (les titres-simulacres « Theme From Take-Off » et « Theme From Landing » en particulier, empruntés aux jingles commerciaux de la compagnie aérienne), très agréables à l’écoute — si tant est que l’on apprécie les mélodies sirupeuses —, mais en même temps totalement anachroniques et trompeurs. C’est Kahimi Karie qui s’accapare le timbre de voix de Jane Birkin, qui susurre et soupire en français et en japonais sur des mélodies produites par Cornelius et Philippe Katerine (en 95, c’est-à-dire quasiment à ses débuts). C’est Maki Nomiya et Pizzicato Five qui écrivent une ode à Twiggy, en s’attardant sur ses poses et sur sa mini-jupe, dans un clip débordant de dérision et d’auto-dérision. C’est lorsque tout, ou à peu près tout, fait allusion à des notes suaves, voire sucrées, notamment dans le single « Sugar Water » de Cibo Matto, merveilleusement retranscrit en images par Michel Gondry, évoquant les univers établis par Björk, elle-même modèle d’insouciance, facétieuse et visiblement peu attachée à la notion de réalité.
Tous ces éléments et ces détails définissent finalement bien mieux le Shibuya-kei que toute tentative de le contenir et de l’enfermer dans une caractérisation formelle et didactique. J’estime que tout y est étonnant et digne d’un intérêt certain, et je m’étonne encore que le mouvement n’ait pas déjà été cité maintes fois, et ne soit toujours pas victime de cette tendance actuelle à vouloir tout exhumer et à donner une seconde vie, par le pastiche d’artistes contemporains ou par le travail de réédition, à toute forme artistique disparue. Peut-être s’agira-t-il de la prochaine étape, après tous ces efforts fournis en faveur du folk japonais des seventies, de la city pop, de la techno kayo et du new age nippon. L’algorithme de YouTube cessera peut-être de nous recommander le sempiternel « Plastic Love » de Mariya Takeuchi, ou « Kakashi » de Yasuaki Shimizu (que l’on adore, là n’est pas le problème), au profit des acteurs du Shibuya-Kei. Ce ne serait certainement ni indigne, ni illégitime.
![Musique Journal - Quel disque faire après avoir sorti un classique ? [vol. 1]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2019/07/musique-journal-jukebox-original.jpg)



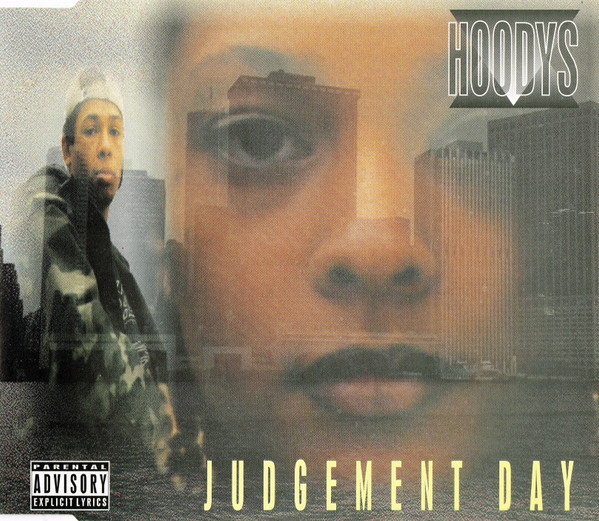
Un commentaire
Le deuxième exemple de baggy nippon : https://www.youtube.com/watch?v=rOjIMSuqEh4&list=UUV5DjC-EwUR5wJ-Az7-Kecw&index=1
On peut aussi évoquer les Pale Fountains qui étaient une énorme influence sur Flipper’s Guitar et toute la vague « neo accoustic » : Aztec Camera, Style Council, Evereything But The Girl, etc…