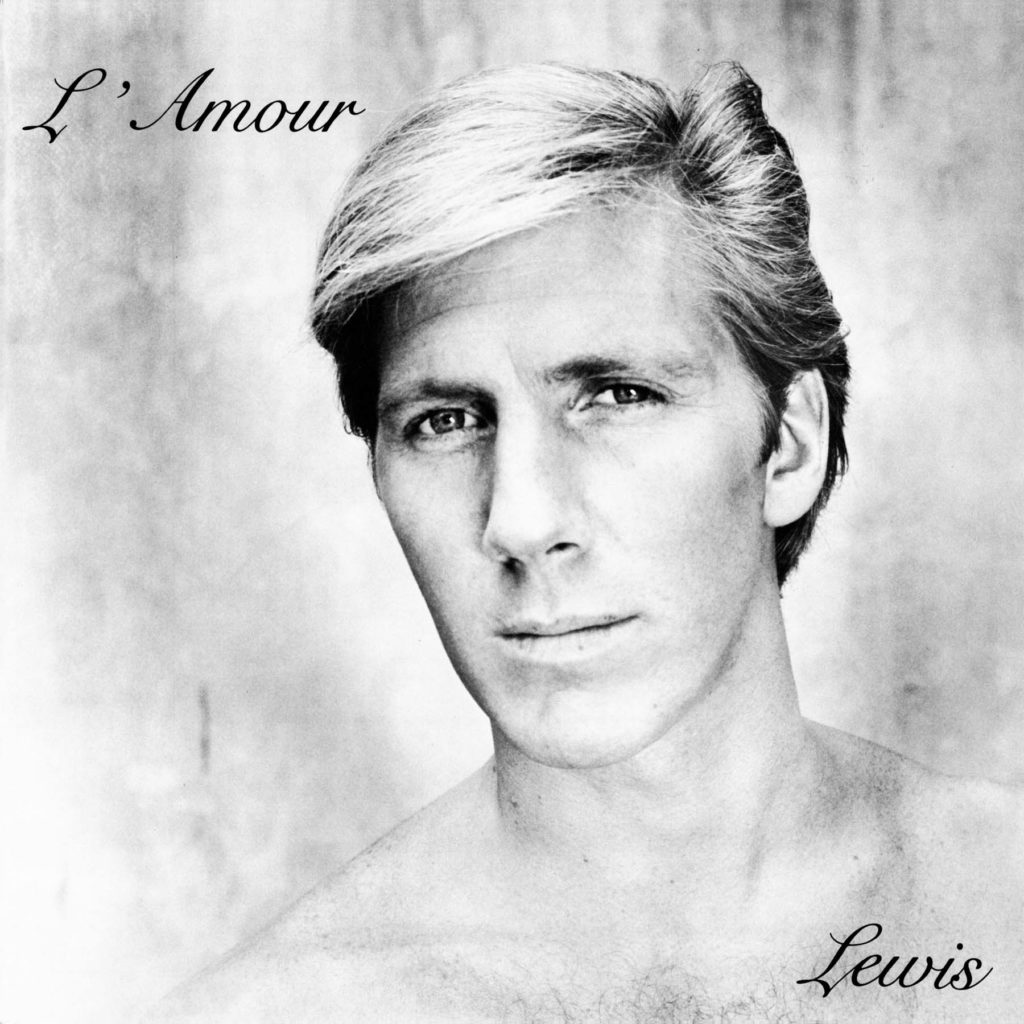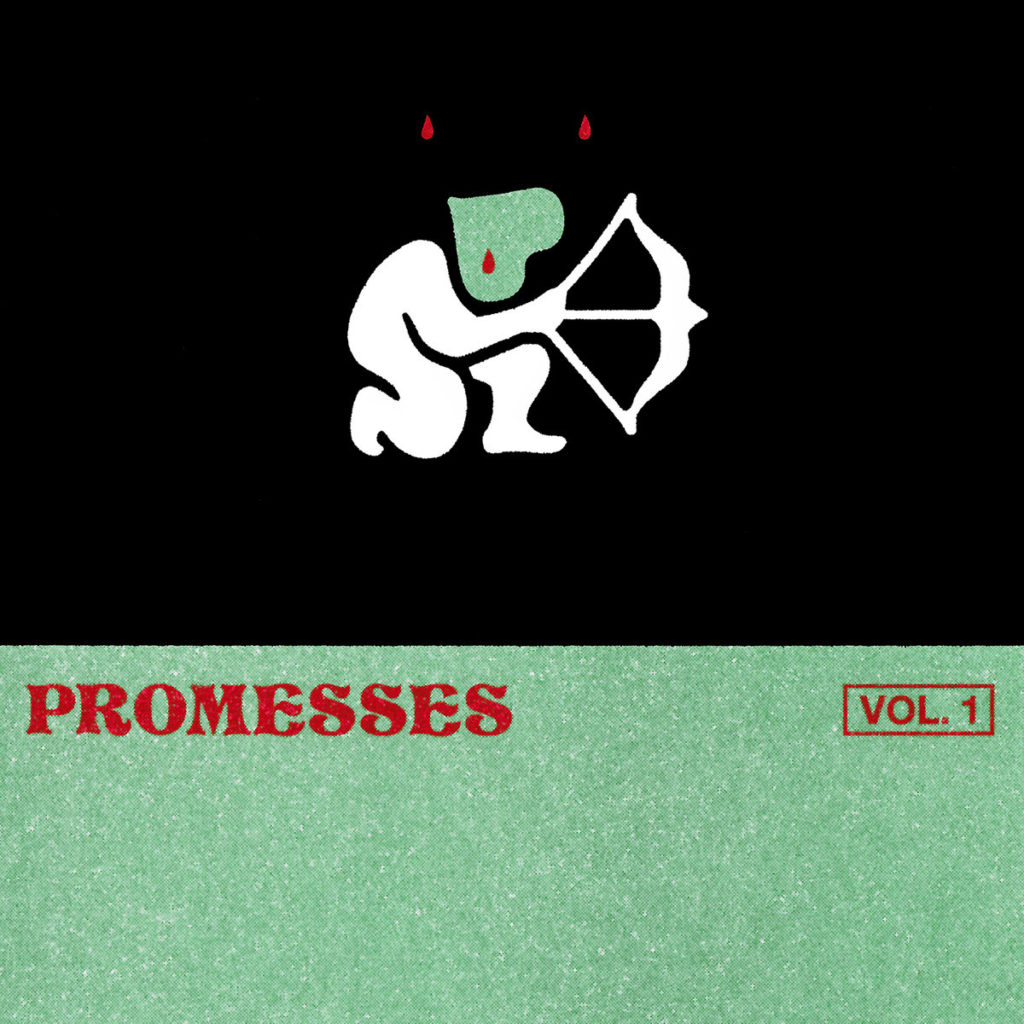Autumn de Louderbach est un disque plutôt loin de mes goûts et c’est sûrement pour ça que je ne sais pas d’abord bien quoi y écouter ou y apprécier, puis que je prends donc un plaisir en creux à m’y immerger en sachant que peu de choses m’y déclencheront. C’est comme regarder un match de cricket ou entendre parler des experts en fiscalité : on ne sait pas bien ce qui se passe mais ça peut griser quelques minutes, voire plus. La violence, la raideur, le pathos, la gravité des esthétiques goth/EBM/indus (je sais que je généralise mais je veux parler de la darkness 80, en gros) ont tendance à me crisper ; mais dans le cas de cet album pourtant très plombé enregistré pour le label de Richie Hawtin par le producteur de techno minimale Troy Pierce avec le chanteur Gibby Miller – et aussi dans le cas de pas mal de choses sorties je dirais dans la deuxième moitié des années 2000, notamment par Kill The DJ –, les atmosphères ténébreuses se changent en un nuage plutôt gris foncé (avec des nuances cobalt, anthracite et taupe, pour parler déco), plus proche d’une pseudo-neutralité vicieuse que d’une agression frontale. C’est une expérience à part que de se sentir magnétisé par ces climats que l’on trouve dépourvus de caractère : on ne ressent jamais d’aussi près l’engourdissement, l’absence quasi totale de qualité sensible. Le goût et le toucher d’Autumn sont ceux du papier d’alu froissé, d’un monte-charge lourd mais pas très vieux, d’une bouche d’aération défectueuse, d’un métal léger qui brûle sans vraiment menacer. On y devine des céphalées, des petites pertes d’équilibre, des décrochages perceptifs – oui évidemment tout ça sent la drogue et même si je ne suis pas assez connaisseur pour dire laquelle ou lesquelles je crois savoir que la kétamine a un rôle important là-dedans, et plus largement dans la minimale berlinoise – mais sans que jamais l’on ne plonge pour autant dans une spirale de confusion psychédélique : il n’y a pas de filtre déformant, pas d’effet de trouble, le son est net, propre, d’une clarté presque effrayante par moments.
J’ai vu une chronique évoquer Depeche Mode et Coil – d’ailleurs Autumn a fait l’objet de quatre ou cinq chroniques sur des sites français à l’époque, qui sont toutes intéressantes et anglées, et qui soulignent souvent leur gêne face à cette patine clinique limite psychorigide – et de fait il s’agit là d’une œuvre au romantisme sombre, qui connaît des rapports complexes avec les machines et avec le non-vivant en général. La production est assez ancrée dans cette époque où, après plusieurs années de domination, la minimale commençait à bien se faire outcooler par diverses nouvelles modes. Mais Troy Pierce, ici comme en solo, avait déjà cette touche pseudo-live légèrement mate, comme dysfonctionnelle en apparence mais très soignée en réalité, une patte que je qualifierais de post-à peu près tout et de post-apo aussi un peu. Et ce qui me marque le plus dans ce disque, c’est sa non-place dans le temps, son atemporalité plus que son intemporalité. On ne se dit pas vraiment qu’on l’écoutera encore dans 100 ans – même si pourquoi pas, on n’en sait rien – mais en revanche on se demande bien où et quand on se situe, sinon dans les limbes, lorsqu’on l’écoute là maintenant. Les limbes de l’histoire musicale, peut-être, mais surtout les limbes d’une histoire sensible et culturelle qui n’aurait pas dû durer si longtemps et donc se chiffonne, se recroqueville, se retourne sur elle-même et se froisse comme ce papier d’alu évoqué plus haut mais qui se met alors à muter en une substance à la texture instable et fuyante. C’est le son du temps qui ne s’écoule plus comme il devrait, c’est de la musique de barrage cosmique.
La voix de Gibby Miller, les effets de volumes désincarnants exercées sur elle, son chant parfois pas toujours juste mais déroulé avec une certitude elle tout sauf contestable, sont malgré la production si fascinante de Pierce les acteurs principaux de l’album. Non pas leurs prouesses techniques ou expressives, mais plutôt parce qu’ils servent de témoins à la désolation – désolation pas du tout spectaculaire – de l’environnement où ils se trouvent. La désolation d’une époque qui, il y a donc dix ans, marquait (en tout cas pour moi) non pas la fin d’un esprit ou d’un espoir mais plutôt la disparition discrète et cruelle d’un chemin, d’une certaine relation au temps et à la narration : les choses continuent d’exister mais l’horizon s’est dissipé sans qu’on s’en rende compte. C’est un disque dont les omniprésentes sculptures synthétiques ne cherchent pas à faire peur ou à générer une quelconque catharsis, mais plutôt à exposer la victoire taciturne du néant, du réifié. Ses moments censés être dansants et fougueux – “Notes”, “Shine” – restent des gestes et des élans vus à travers une gigantesque vitre, ou peut-être au contraire à travers des millions de lentilles de contact truquées et posées sur les âmes et les organes sensoriels des individus. Les dimensions s’y chevauchent, s’y confondent, et le point ne s’y fait jamais complètement. On y constate juste la fin sans fin d’une utopie dont on ne sait même plus très bien qui elle venait sauver, ni ce qu’elle venait remplacer.
Ce n’est donc pas parce que Autumn n’est pas un album dancefloor qu’il se prête pour autant à une écoute domestique sereine : il perturbe et nie en toute situation les attentes de l’auditeur, lui impose son monde en inversion sans chercher à l’annoncer ou à l’expliquer. Et c’est sans aucun doute ce qui le rend à peu près inusable : composé de matières génériques, dénué de tout secret et de toute révélation, il flotte dans un hors champ que je continue d’échouer à bien distinguer, encore une décennie plus tard, et c’est bien pour ce que je l’aime de cet amour pervers et démobilisé.