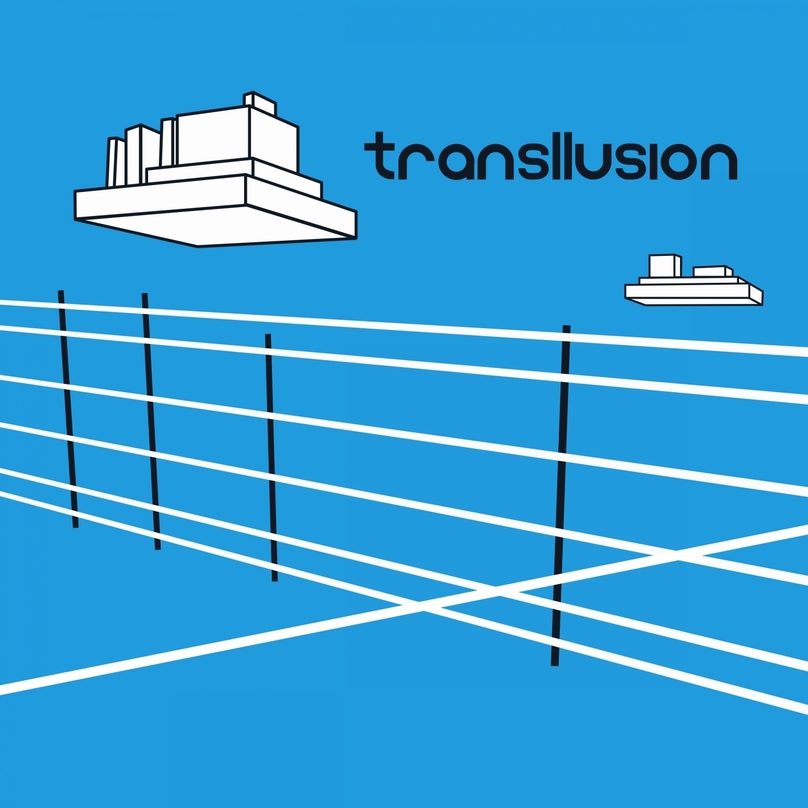Évidemment que c’est juste pour rameuter du monde que je pose tout haut cette question que personne ne se pose tout bas. Vous m’en excuserez par avance, surtout qu’il me semble qu’il existe déjà un certain consensus, en ce qui concerne les nombreux disques sous alias de Drexciya, autour du délicat Lifestyles of the Laptop Café (2001) de The Other People Place, que même cette brute EBM hispanophile de The Hacker qualifie de chef-d’œuvre absolu, tous genres confondus – en tout cas c’est qu’il dit vers la fin de cet article. Gesamtkunstwerk de Dopplereffekt avait aussi eu sa petite cote à l’époque de l’electroclash, mais c’est vrai qu’avec les années Lifestyles a acquis un statut particulier, et puis le clou a été enfoncé en 2017 avec la réédition chez Clone (dans le cadre de leur série Aqualung, spécialement dédiée aux rééditions du duo de Detroit) de ce EP oublié mais tout aussi génial.
Cela n’empêche que de façon générale, j’ai tendance à me dire que le vaste univers conçu – ensemble ou séparément, sur presque une centaine de disques au total – par James Stinson et Gerald Donald sous le nom de Drexciya ou sous d’autres alias ne peut pas être strictement hiérarchisé. C’est rare de trouver un de leurs morceaux « pas terrible », et même dans les récentes sorties de Donald c’est dur de se dire « mouais, très moyen, là tu fatigues un peu Gerald, peut-être tu devrais changer de style ». Certes, c’est possible de penser que cette musique peut parfois être aride, voire chiante, et oui, on peut avoir envie d’entendre autre chose que cette austérité à base de 808 et de crypto-géographie sous-marine. Il est aussi légitime de faire remarquer qu’on entend, en certaines occasions, les mêmes plans d’un morceau à un autre, les mêmes harmonies, les mêmes énergies, mais c’est justement pour ça que l’édifice Drexciya nous fascine et se démarque de tout le reste du domaine électronique. C’est un véritable « monde en soi », même s’il doit soniquement quelques petits trucs à d’autres artistes. Il ne s’agit pas d’une musique où des individus s’expriment personnellement : c’est plutôt la description musicale (mais aussi littéraire et visuelle) d’un environnement science-fictionnel aux vertus thérapeutiques, qui propose une reconstruction de l’histoire des Afro-Américain.e.s. L’œuvre de Stinson et Donald est un paysage fabriqué par les mêmes machines – la TR-808, plus quelques synthés (Korg, si j’ai bien compris), et par moments des vocaux, déformés ou non – dont l’expansion à chaque nouveau disque se justifie par ce révisionnisme « positif ». C’est un révisionnisme issu du besoin plus collectif qu’individuel, pour les Noir.e.s d’Amérique, d’honorer les âmes de tous les déportés jetés par dessus bord lors de la traversée de l’océan, et d’ajouter un long chapitre à l’histoire de l’esclavage en imaginant que de l’horreur du « Middle Passage » aurait pu sortir quelque chose de beau, de constructif, de stimulant, à savoir cette prodigieuse civilisation subaquatique appelée Drexciya.
Pris ensemble, les disques de Drexciya, comme tous ceux sortis sous leurs différents alias, avant ou après la mort de Stinson en 2002, constituent à la fois le meilleur exemple de « faceless techno music » (puisque l’identité des auteurs a longtemps été maintenue secrète) et le meilleur contre-argument à l’idée d’une techno qui ne « raconterait rien », qui n’aurait pas de propos. L’electro-techno de Drexciya n’existerait pas sans son propos, sans l’histoire qu’elle narre, celle de cet univers né au fond de l’Atlantique, du ventre des cadavres de femmes enceintes éliminées par les négriers lors de la déportation de l’Afrique vers l’Amérique. Ces êtres, les « Drexciyans », auraient développé une manière propre de respirer sous l’eau et organisé leur propre société, avec ses machines et ses métropoles, et peut-être même remonté, depuis l’océan et le golfe du Mexique, les eaux du Mississippi pour rejoindre le Midwest, plus précisément le Michigan et ses lacs. Ce nouveau mythe, suggéré en partie par les écrits afrofuturistes de Paul Gilroy, est sans nul doute le récit le plus puissant à être sorti de toute l’histoire de la musique électronique. Et je peux me tromper mais j’ai l’impression qu’il n’est pas si répandu que ça, en tout cas en France, alors qu’il porte pourtant à lui seul une charge politique et historique, mais aussi émotionnelle et esthétique, dont beaucoup d’amateurs de techno ou d’électro ne sont pas familiers. Et bien sûr, cette idée résonne aujourd’hui plus largement avec le sort des milliers de migrants africains qui meurent en voulant rejoindre l’Europe en traversant l’Atlantique et la Méditerranée.
Les travaux de Drexciya donnent aussi une bonne idée du pouvoir narratif de la musique électronique, en dehors du secteur, lui déjà assez balisé, des bandes originales de Carpenter, Vangelis ou Tangerine Dream. Et puis ils sont aussi, je le dis d’expérience, d’excellentes façons de convaincre les technophobes de la grandeur et de la richesse de ces créations sonores machiniques. Mélodies folles, rythmiques qui transportent au sens littéral, cohérence parfaite du matériau, textures « vivantes », sans oublier les titres, les pochettes et donc ce récit tragique mais vertueux : l’auditeur électro-sceptique ne trouve en général pas grand-chose à répondre si on prend la peine de lui présenter correctement l’œuvre de Stinson et Donald.
Comme je le disais plus haut, il me paraît vain d’isoler dans cette œuvre un morceau ou un disque qui sortirait particulièrement du lot. Ce qui est notable dans le plébiscite dont bénéficie Lifestyles, c’est que c’est sans doute le disque qui détonne le plus dans toute la discographie de Drexciya : il n’a pas cette dureté, cette âpreté typique, et sa thématique très « mondaine » – l’amour, le bien-être, la vie rendue fluide par les technologies –, bien qu’envisagée sous un angle critique sinon ironique, n’a rien à voir avec les questions beaucoup plus imposantes qui animent en général les productions du duo. L’immense majorité des sorties de Donald et Stinson, dont notamment l’album de Transllusion ici recommandé, jouent en effet sur le contraste incessant entre la violence et l’apaisement, l’humain et le post-humain. Les nuances esthétiques entre chaque projet sont en général assez peu marquées : en gros, on peut dire que la discographie de Drexciya s’adoucit légèrement au fil des années, et qu’elle s’étend sur un spectre allant très progressivement du plus ou moins ambient au plus ou moins industriel. Mais je dirais néanmoins qu’il n’y a pas, genre, un alias 100% dancefloor, un autre 100% dédié à l’écoute domestique, un autre vraiment très pop ou un autre vraiment très expérimental. C’est toujours à chaque fois un peu de tout ça en même temps, même si certains trucs récents de Donald se distinguent peut-être plus fort du reste – je pense notamment au projet Black Replica, auquel participe une vocaliste aux accents que je qualifierais de « darkwave ».
Bref, trêve de détails, j’ai choisi ce disque de Transllusion pour des raisons en grande partie affectives puisque je l’avais acheté à a sortie en vinyle sans trop savoir ce que c’était, et que je me souviens avoir mis un certain temps à l’apprivoiser, pour finalement en faire un de mes disques de chevet. Il m’était au départ paru trop agressif par rapport aux choses plus rondes et plus claires que j’avais kiffées jusqu’ici chez Drexciya, notamment à cause de ce premier morceau infernal qui fait tourner un arpège de synthé abrasif, comme un essaim de frelons cyborg qui viendraient menacer nos crânes, et qui droppe un beat techno 4/4 bien droit, chose pas si fréquente chez Drexciya où les grooves electrofunk sont plus courants. Ce que j’ai saisi au bout d’un moment dans cet album, et qui me l’a fait aimer toujours plus, c’est ce que les machines y sont jouées en live – certes, j’ai appris par la suite que Stinson et Donald enregistraient toujours dans ces conditions, mais là ça m’avait vraiment frappé. Il y a aussi ce parti-pris descriptif si singulier et si propre au tandem – enfin, je dis ça, mais pour le coup Transllusion est crédité au seul Stinson, même si cet article extrêmement bien fait de RBMA suggère que chaque alias de Drexciya est toujours un peu le boulot des deux, et ce, même après la mort de James en 2002. C’est un parti-pris qui consiste à ne jamais trop faire évoluer les morceaux en dehors de quelques effets : ça reste toujours les mêmes boucles, comme une scène sonore qui se tourne encore et encore, qui existe même quand on appuie sur stop ou next. Il y a bien des intros, presque comme des petits génériques, parfois des drops, mais je dirais que la dramaturgie est toujours déjà réglée dès le départ, et que la notion d’invention n’est pas le cœur de l’affaire – ça évoque en cela les musiques religieuses ou sacrées, des formes de composition très strictes, aux visées cultuelles ou rituelles, même si l’élément spirituel n’est pas tout à fait manifeste dans les travaux du binôme. Ce que je veux dire, c’est que le monde que Drexciya, Transllusion, ou Der Zyklus, Japanese Telecom, Arpanet, Dopplereffekt, Shifted Phases, Abstract Thought, Other People Place, Elecktroids ou Lab Rat XL nous montrent à chaque morceau n’est pas un monde qui apparaît soudain par la magie de la musique, mais une entité au service de laquelle ils se trouvent : c’est un univers qui existait déjà avant que ne s’allument les machines, et qui demeurera encore, quelque part, lorsqu’elles s’éteindront.
The Opening of the Cerebral Gate est aussi et surtout un album qui condense de façon exemplaire l’ambivalence affective du projet Drexciya : tension versus sérénité, vertige ou réconfort, fuite ou abri, douleur contre anesthésie, agression contre protection. Que dire de la thématique cérébrale du disque, de ce concept « neurocentré » à l’œuvre sur presque chaque titre ? Il semble être question de modifier son câblage mental, ses circuits synaptiques. Sur « Look Inside », le son du clavier passe d’un branchement à l’autre, hésite entre deux pôles, raison et déraison, je ne sais pas. « Unordinary Realities » suggère des visions altérées, des opérations qui jouent en direct sur les contours d’une vision, d’un son, d’une couleur : il s’agit en fait d’un exercice qui se déroule sur un plan certes musical mais aussi sur un plan imagé, tactile, cognitif. « Dimensional Glide » est une sorte de tube : sa ligne de basse rassurante et majestueuse est perturbée par un clavier évoquant un horizon moins clair, une perspective brouillée par un doute, voire une angoisse métaphysique qui point, à la fois lointaine et proche. Ce qui me frappe le plus dans la palette émotionnelle, c’est sa dimension non-personnelle, non-individuelle. Sa facture « robotique » sert de véhicule à l’expression non pas d’un sentiment post-humain, mais macro-humain, celui du collectif de l’Atlantide noire ; il résonne dans les machines et fait en sorte que les auditeurs y reconnaissent un ressenti, un refoulé ancien, un impensé historique, un brutalité barbare qui remonte, nuancée tant bien que mal par sa propre proposition de réécriture, de réconciliation par le mythe, chargée du conflit provoqué par ce choc entre une réel horrifique et une fiction guérisseuse, voire pacificatrice. C’est tout à fait autre chose que de la musique machinique qui respire tel ou tel résidu d’humanité, comme c’est le cas de beaucoup de très bonne techno, notamment à Detroit. Il faut la considérer autrement, à savoir comme une représentation sonore authentique de la souffrance des Noir.e.s, d’aujourd’hui comme d’hier, et des moyens de l’atténuer, de la retourner, de le transformer ou de la détruire. Transllusion semble donc se plonger, comme Dopplereffekt ou Arpanet, dans les enjeux plus ou moins techno-cognitifs de cette problématique. Mais ce n’est qu’une déclinaison de l’immense masse mémorielle dont s’occupe à chaque manifestation, à chaque storm, le continent Drexciya. Ecoutons-le donc encore une fois, et tâchons de faire honneur, en tant qu’auditeurs « actants », à ce qu’il essaie de nous dire.