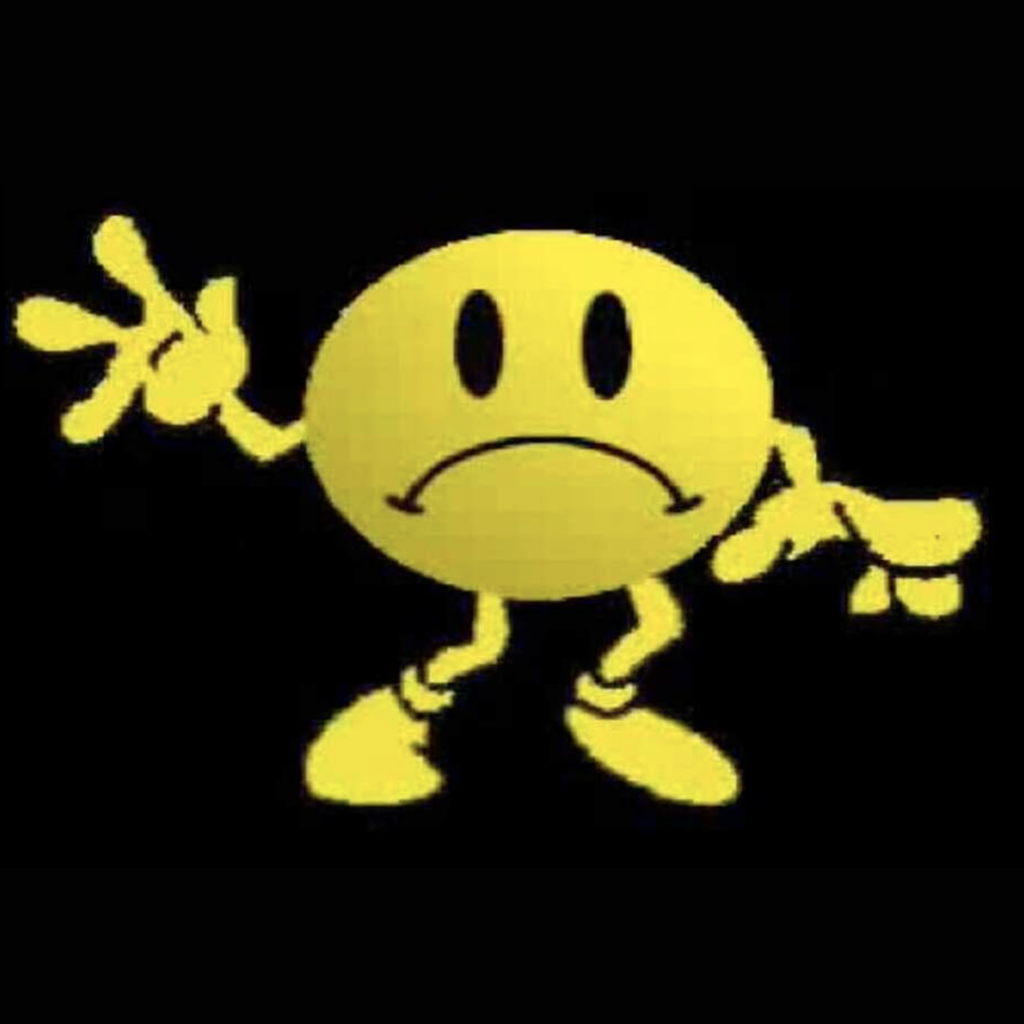Les Honeycombs sont un groupe vocal mixte que j’ai découvert tout récemment via une interview de World of Twist, dont il était question ici voici quelques semaines. La carrière de ces Londoniens produits par Joe Meek n’a duré que quatre ans, de 1963 à 1967, le temps de faire quelques hits – dont le plus gros fut le premier, « Have I The Right », qui dans sa ligne de chant me fait penser de loin à « God Only Knows » des Beach Boys sorti deux ans plus tard – et de devenir l’objet d’un petit culte au Japon. Ce best-of est un peu long, c’est limite une intégrale puisqu’il fait trente titres, mais l’essentiel est qu’il donne une excellente idée de l’étendue du répertoire de ce quintette mixte, qui a la particularité d’avoir une femme à la batterie, Honey Lantree – sachant que Moe Tucker ne prendra les fûts du Velvet qu’en 1966. Je me suis rendu compte en parcourant cette anthologie pleine de morceaux géniaux – le tube en ouverture, mais aussi « Can’t Get Through You », un proto-synth-punk sans synthé mais chargé au speed, « That Loving Feeling » dans un style The Mamas & The Papas tombé dans un caniveau de Soho, le tabassage mignon de « It Was Nice While It Lasted », ou encore « It Ain’t Necessarily So » qui lui sonne comme du rhythm’n’blues surfisant – que j’écoutais en fait très peu de musique des sixties, et même presque aucune musique sixties pré-psyché, en gros de la première moitié de la décennie. Je me suis demandé pourquoi et je crois que cela tient à plusieurs raisons diversement intéressantes.
Il y a d’abord une explication « pop-culturelle » plutôt simple : c’est que les tubes de cette époque sont, depuis les années 80, matraqués dans les films et les médias au point où ils se sont totalement banalisés à mes oreilles. Ils sont identifiés par défaut à des chansons de boomers satisfaits d’écouter en boucle les trucs de leur jeunesse et incapables de s’intéresser à ce qui est arrivé ensuite et donc, logiquement, ils me saoulent, même si en soi ce n’est pas la faute des chansons mais celle de ceux qui les écoutent et les exposent.
Mais il y a aussi une raison moins relative aux générations, moins socioculturelle, et qui touche à la nature même du son sixties, au-delà de ses tubes et de ses clichés. C’est que je dois être un auditeur trop soft, trop bourgeois et trop post-moderne pour avoir la capacité de bien recevoir le modernisme violent, radical et populaire d’un producteur comme Joe Meek, ou celui de sa nemesis américaine Phil Spector, ou encore celui du son de la Motown à cette époque, ou dans un autre genre celui des groupes garage. C’est-à-dire, corrigez-moi si je me trompe, le son de disques souvent enregistrés en mono, avec quatre pistes maximum, afin de générer ce rendu très frontal, pensé pour les sillons serrés du 45-tours et l’écoute sur des petits transistors, des autoradios ou des tourne-disques bon marché. Je pense que je me suis trop construit en aimant des morceaux dont les arrangements ont l’air plus fluides, avec plus d’espace et moins de densité, où les éléments s’entrechoquent peu, où l’on ne voit pas les jointures et les articulations. On m’a fait en effet remarquer il y a quelque temps, alors que je me disais moyennement séduit par la BO de Once Upon A Time in Hollywood, que j’avais tendance à préférer les productions où l’on ne voyait pas la tuyauterie. Pourtant lorsqu’on y songe, c’est en laissant apparaître la tuyauterie (on pourrait aussi dire le châssis, la charpente, l’armature, que sais-je) que la présence humaine survient au cœur de la technique et qu’elle produit du lien avec l’auditeur. C’est au contraire quand la technologie vise le frictionless et fait disparaître les mains du labeur humain qu’elle devrait nous inquiéter, non ? Et alors, si je me sens instinctivement gêné par l’agressivité grésillante et cahoteuse des productions sixties (ou du moins peu réceptif à cette agressivité), serait-ce que je prône sans me l’avouer la disparition du sujet, la dissolution de sa liberté et de son travail dialectique ? C’est hélas possible, et je vais en tout cas méditer là-dessus.
En attendant, il y a clairement dans l’approche de Joe Meek une perception de la technique et des machines comme un ensemble d’outils qui ne sont pour nous pas évidents, pas courants, qui ne devraient peut-être pas cohabiter avec l’existence des individus. Meek est quand même né en 1929, il a grandi dans les années 30 et 40 en découvrant les premiers appareils grand public, les ondes magnétiques ou électriques devaient lui paraître encore habitées par une âme possiblement dangereuse, sinon maléfique. D’ailleurs, on sait qu’il pensait communiquer avec l’au-delà à travers ses enregistrements, et que ses différentes méthodes de prise de son et de mixage relevaient en partie d’une forme personnelle d’occultisme – on sait aussi qu’il traversait régulièrement des épisodes délirants et qu’il a fini par tuer sa logeuse avant de se suicider. Mais son modernisme est donc à entendre au sens premier du terme, c’est-à-dire en un sens beaucoup plus proche du rapport qu’entretenaient au réel et à la technique les avant-gardes artistiques de la première moitié du XXe siècle, que celui propre à l’ère plus ou moins technophile, amoureuse des ustensiles domestiques, qui allait peu à peu prendre le dessus à partir de la fin des années 60. Il est aussi connu que Meek, et avec lui la plupart des grands producteurs et ingénieurs du son de cette époque, devaient passer un temps fou en studio pour assembler, synchroniser, agencer les pistes et les bandes sur lesquelles ils bossaient. C’est un boulot de composition presque plus plastique que sonore : quand on écoute certains titres de ce best-of des Honeycombs, ou ce morceau phénoménal des Sharades (que les B-52s ont dû rincer et rerincer à leurs débuts), ou encore ces deux-là, de Glenda Collins, on se dit qu’on devrait plutôt parler de compositing, un terme employé dans l’industrie des effets spéciaux. Le travail de modelage des sons a pour but de créer des effets de morphing rudimentaire, des illusions audio aux vertus tactiles saisissantes, la collision des volumes et des textures produisant dans le meilleur des cas des espèces de sublimes leurres, des trompe-l’œil dont l’abrasion reflète celle d’une société industrielle tardive envahie par la machinerie et les bruits parasites – et ce, alors qu’il s’agit de singles largement distribués en magasin, plusieurs années avant l’explosion psychédélique.
Dans la première moitié des sixties, les travaux de Meek mais plus généralement la production pop anglo-américaine dans son ensemble ont ainsi proposé quelque chose qui, au moins indirectement, prolongeait certaines idées du futurisme italien et de l’art des bruits de Luigi Russolo. C’était une conception moderniste de la pop, pas forcément avant-gardiste dans le sens Dada du terme, mais néanmoins capable de bousculer la forme standard de la musique légère attaquée par Adorno grâce à une batterie de perturbations que l’auditeur de cette époque ne pouvait, je crois, pas tout à fait ignorer. C’est cette idée d’une pop music subversive mais aguicheuse, engageante et engagée, fabriquée à la fois pour et contre, qui reviendra plus tard avec le punk, bien sûr (je n’ai toujours pas lu Lipstick Traces mais je crois que j’ai compris l’idée) mais également avec Trevor Horn, Art of Noise et ZTT. Puis aussi, voire surtout, avec les premières phases très mécaniques et très raides du rap et de la dance music, où la tuyauterie ainsi exposée aux oreilles de tous peut parfois prendre un tour profondément critique et dialectique, quoique pas tout à fait articulé comme dans une pièce de Schoenberg, et dont Theodor Wiesengrund n’aurait sans doute pas su quoi dire.