Autant vous le dire tout de suite : aujourd’hui nous n’allons pas découvrir ensemble un bel album oublié, car j’ai décidé pour une fois de ne pas me concentrer sur la musique, mais plutôt sur ce qui s’est passé autour de ce disque en lui-même peu captivant. Ou plutôt sur ce qui s’est passé après la sortie de ce disque peu captivant, et plus généralement après la séparation de ce tandem de chanteurs, Nina & Frederik, qui avait connu un franc succès entre la fin des années 50 et le milieu des années 60. J’ai tendance à croire que, par un curieux retournement des pratiques d’écoute, on ne connaît de l’easy-listening que sa la facette chic, exotique et bien arrangée, telle qu’elle a été redécouverte dans les années 80 puis 90, et qu’on a plus ou moins oublié qu’une vaste partie de la production de ce genre était extrêmement ennuyeuse, voire glauque, limite capable de vous dégoûter de la musique, tant elle manque de relief et d’audace. La discographie de Nina & Frederik appartient à cette zone plombante du répertoire, au sens où il s’agit vraiment d’une musique faite pour ne pas être entendue, de chansonnettes qu’on n’écoute sans les écouter, pour ne pas dire carrément du bruit de fond. En gros, c’est de la muzak, sans que l’aspect commercial et fonctionnel ne soit assumé. Il y a en outre chez eux une dimension « tropicalisante » puisque de nombreux titres sont d’inspiration calypso, inspiration qui tourne carrément au sinistre lorsque le chanteur, Frederik van Pallandt, de père hollandais et de mère danoise, se met à imiter l’accent caribéen. Et la présence de Louis Armstrong sur d’autres chansons ne rend moins rances pas ces « plaisanteries », mais bref, j’imagine qu’à l’époque ce type d’abus passait sans problème – et on notera d’ailleurs le choix du morceau « Limbo », toujours chanté « avec l’accent » par Frederik, qui dit « When woman say no she means yes » et semble en substance considérer avec un mélange de mépris et de bienveillance une espèce de culture du viol prétendument banalisée chez « les gens des îles ».
Bref, j’ai essayé d’en savoir plus sur l’histoire de ce couple et voici ce que j’ai appris. Nina Moller et Frederik van Pallandt se sont rencontrés tout petits, à la fin des années 30 au Danemark. Le père de Frederik, un baron (son fils le sera donc aussi), y est ambassadeur des Pays-Bas et les parents de Nina ayant eux-mêmes intégré la bonne société de Copenhague, les deux bambins font connaissance. La famille van Pallandt doit ensuite déménager à Trinidad, où Frederik découvre les charmes du calypso, au point de monter un groupe à l’adolescence. Il continue néanmoins de correspondre avec Nina et la recroise enfin, au terme des années 50, lorsqu’il revient en Scandinavie. Un soir qu’ils sont ensemble avec leurs familles respectives, le jeune homme commence à jouer un standard calypso et la jeune femme, à l’époque déjà mariée à un fils à papa anglo-danois, se met à chanter sur ses accords de guitare. C’est le coup de foudre, à la fois artistique et sentimental. D’abord le jeune couple se produit juste en privé, pour leurs amis, mais bientôt ils se font une petite réputation dans le milieu et se professionnalisent : ils apparaissent dans des hôtels et des mariages, puis bientôt très vite signent un contrat avec le label suédois Metronome. Leur image de grands blonds aux yeux bleus crypto-incestueux – ils ont clairement plus l’air d’un frère et d’une sœur que d’un mari et d’une femme, même s’ils se sont bel et bien épousés en 1960 – qui s’approprient le répertoire trinidadien pour le mêler à des ritournelles folkloriques nord-européennes semble à l’époque séduire les foules. Ils tournent en Europe et aux États-Unis, en tenues traditionnelles, et comme toute bonne formation de variété internationale de cette époque sortent une ribambelle de disques : une alternance de collections de standards, de captations live et d’albums de Noël, souvent chantés en plusieurs langues (espagnol, français, allemand, etc). Nina trouve tout de même le temps – façon de parler – d’avoir trois enfants entre 1961 et 1965, mais à partir de 1966 le couple décide de ne plus tourner, et commence surtout à battre de l’aile, tant sur le plan musical que personnel. Leur discographie s’arrête grosso modo vers 1968 et la séparation est consommée en 1969.
C’est à partir de cette date que les choses commencent à se corser. Nina poursuit une petite carrière en solo, d’abord en 1969 en interprétant la chanson d’un James Bond, mais manque de bol, c’est celui avec Roger Lazenby. Puis elle publie trois albums au début des années 70 sur des labels anglais, en général des disques de reprises dans une veine variété haut de gamme mais peu aventureuse, alors qu’elle a déjà la quarantaine, sur un marché où elle doit se mesurer à des artistes de dix ou vingt ans de moins qu’elle, et où son storytelling de baronne folklorique / jet-setteuse divorcée n’est pas tout à fait vendeur. En parallèle, elle entretient une liaison clandestine avec le romancier et reporter américain Clifford Irving, au moment où celui-ci publie une tristement célèbre autobiographie contrefaite d’Howard Hughes, qu’il prétend avoir rencontré lors d’un voyage au Mexique. Le milliardaire reclus sera tellement scandalisé par cette publication bidon qu’il sortira de son ermitage pour dire que cet Irving est un escroc et qu’il ne l’a jamais rencontré. Et là, bizarrement, Nina témoignera contre son amant en affirmant qu’elle avait fait le voyage au Mexique avec lui et qu’à aucun moment celui-ci n’a rencontré Hughes, puisqu’elle était quasiment tout le temps en sa compagnie. Tout ça est raconté dans un passionnant article-fleuve lisible dans ce numéro de Life. En tout cas, sympa, la Nina, qui devait sûrement en vouloir à Irving, lequel était marié et ne semblait visiblement pas prêt à quitter son épouse, une certaine Edith, dont elle se trouvait par ailleurs être la voisine à Ibiza, où elle avait acheté une maison. Elle se remariera ensuite à Capetown avec un dénommé Robert Kirby, comédien et satiriste sud-africain par ailleurs fanatique d’avions (et je ne veux pas dire mais ça consiste en quoi exactement être satiriste sous l’apartheid ? c’est quoi le type de « blagues » à faire sur un régime qui parque, emprisonne et tue les Noirs ?).
Néanmoins bien intégrée dans les milieux artistiques, la chanteuse se reconvertit vite dans le cinéma et joue plusieurs rôles secondaires dans des films de Robert Altman (dont The Long Goodbye mais aussi le mal-aimé Quintet avec Paul Newman), et plus tard dans American Gigolo avec Richard Gere et Cutter’s Way avec Jeff Bridges. À Ibiza, elle continue de côtoyer régulièrement son ex-mari, dont elle est restée proche, qui lui aussi habite une villa sur place et va épouser en 1977 une aristocrate portugaise, María Jesus de Los Rios y Coello de Portugal. Avec son insupportable barbe blonde – les blonds, à l’exception d’Arnaud Sagnard, ne devraient pas avoir le droit de porter la barbe, ça met tout le monde mal à l’aise –, Frederik passe le plus clair de son temps à faire de la voile, sa grande passion, et navigue donc dans les eaux méditerranéennes avec sa nouvelle femme. Il rachète un temps une maison d’édition spécialisée dans les arbres généalogiques de la noblesse européenne, preuve qu’il reste fidèle à ses racines, et puis dans les années 80 on ne sait plus très bien ce qu’il fait. En revanche, au tournant 80/90, on découvre qu’il a quitté sa seconde épouse puisqu’on le croise au bras d’une Philippine, une certaine Susannah, dans l’océan Indien où il se balade sur son yacht. Il fréquente vraisemblablement les cercles d’expatriés qui évoluent entre les Philippines, l’Indonésie et l’Australie. Jusqu’à ce qu’un jour de mai 1994, au lendemain d’un dîner qu’ils ont donné sur son yacht dans les eaux philippines avec quelques amis, Susannah et lui sont retrouvés morts, assassinés par balles. On pense d’abord à des pirates qui auraient braqué le riche navigateur, mais l’enquête va orienter l’affaire vers une autre piste. Car on découvre que depuis son installation dans la région, Frederik van Pallandt a commencé à frayer avec une grande famille mafieuse australienne, le crime syndicate de Michael Hurley. Plus précisément, son bateau et son image respectable lui ont permis d’offrir ses services de transport de drogue à la pègre de Sydney, qui importait la came depuis, entre autres, les Philippines, et le rétribue grassement (on parle de millions de dollars). Pour ça, il s’est acoquiné avec Ronald Milhench, un lieutenant de Hurley, déjà versé dans les relations publiques puisqu’il a précédemment fait équipe dans des entreprises louches et périlleuses avec un autre aristocrate, britannique en l’occurrence, le baron Anthony Moynihan (dont, par ailleurs, la fille Aurora a récemment été retrouvée morte aux Philippines, vraisemblablement tuée par les autorités pour ses liens avec le trafic de drogue). Milhench aurait embrigadé Frederik dans une affaire de commission jamais reversées par un autre malfrat, Malcolm Field, alors qu’en réalité, l’affreux Ronald aurait touché sa part sans le dire à Frederik avant de lui monter le bourrichon pour qu’il se mette à traquer Field, de façon à lui tendre un piège pour le localiser et l’exécuter sans avoir à lui verser son fric. Quelle joyeuse ambiance ! Sur les lieux du crime, von Pallandt, qui sentait bien qu’un sale truc se tramait, avait laissé une enveloppe pour Susannah où il lui indiquait comment procéder pour récupérer ses fonds s’il en venait à se faire descendre, mais hélas c’était trop tard puisque sa petite amie ne put s’en sortir mieux que lui. Nina, amie fidèle, sera sur place dès le lendemain pour faire rapatrier le corps. Milhench et Field fournirent des alibis prouvant qu’ils n’étaient pas aux Philippines ce soir-là, mais la police argua qu’étant tous deux de grands adeptes des faux passeports, ils auraient pu l’un comme l’autre avoir fait le voyage sous d’autres identités. Depuis, les deux hommes ont passé du temps à l’ombre.
Je vais continuer de me renseigner sur ce dossier, par exemple en me faisant traduire les mémoires en danois de Nina, ou en consultant les archives des faits divers de la presse australienne et asiatique de langue anglaise. C’est une triste affaire, bien sûr, mais j’ai envie de souligner qu’en termes de fiction, de destinée, quelque chose de pas clair s’annonçait dès le départ dans l’existence de Frederik von Pallandt : des vapeurs grisâtres soufflaient sur son horizon personnel, celles de son faux-self de baron chanteur de calypso, de sa virilité performative au bord de la rupture, du conflit interne qui devait le ronger, entre ordre aristocrate et liberté marine, amour des valeurs traditionnelles et besoin terrestre d’argent. Et le fait qu’il ait été un musicien si sage, si bête, si naïf, ne fait que rendre l’affaire plus intrigante.

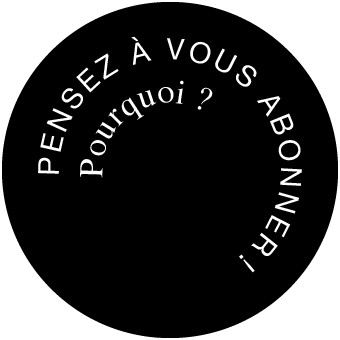
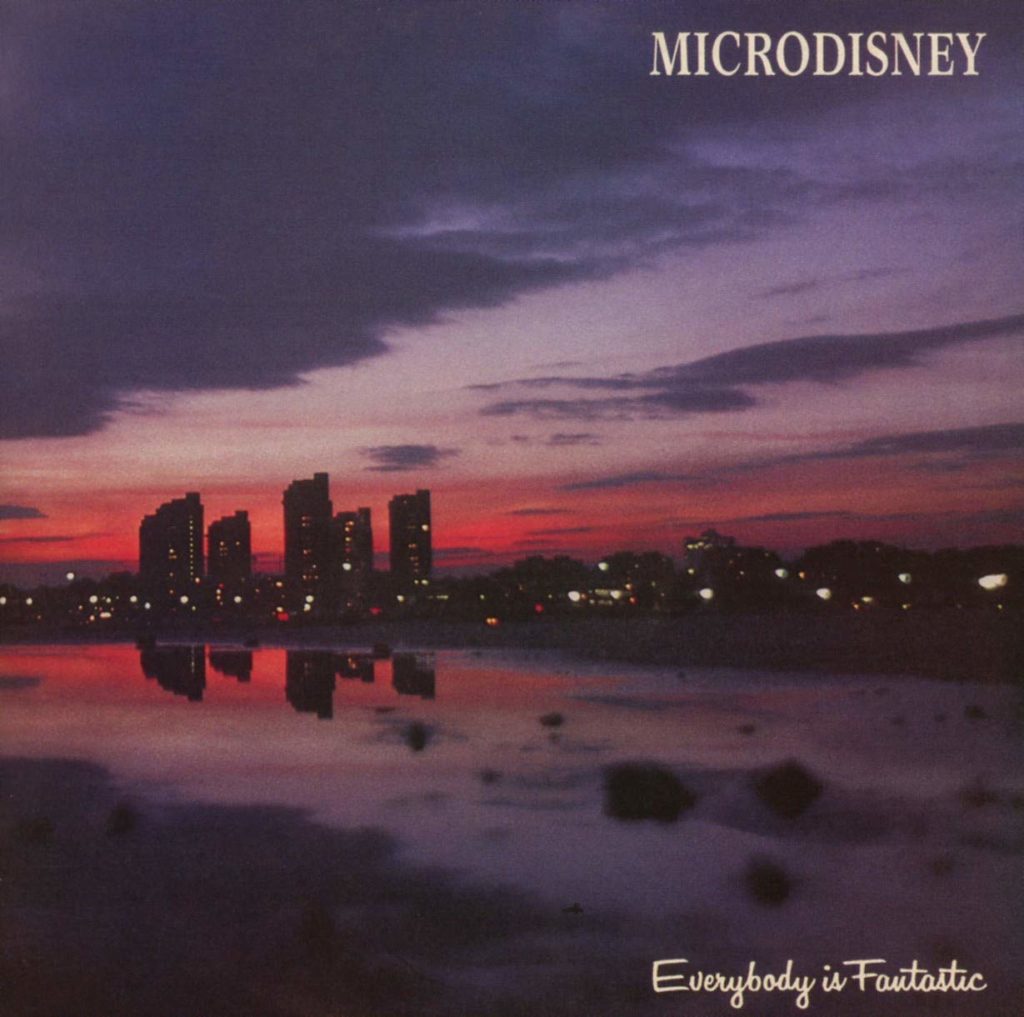
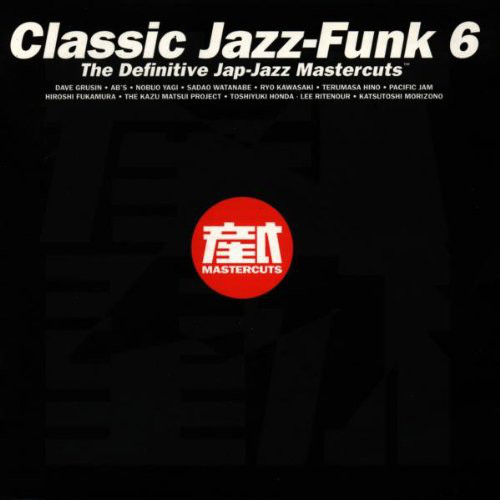

Un commentaire
Bonjour Etienne,
Enquête très intéressante et qui mérite en effet un approfondissement. C’est du polar haut de gamme ! Concernant le disque en lui-même, je ne sais pas si on doit évoquer un « monde interlope glauque » derrière l’easy-listening. Je crois surtout que les disques easy-listening, à l’époque, étaient surtout de la bonne daube qu’on sortait en semi-remorques dans les magasins de disques et qu’on offrait à Noël à la famille (non mélomane) qui de toutes façons écoutait le disque une ou deux fois et basta. Bref du hard consuming comme une boite de chocolats. D’ailleurs les disques de Nina & Frederik valent entre 1 et 5 euros sur Discogs. Donc de la daube en effet. C’est comme du Frank Pourcel ou du Paul Mauriat… De l’ameublement. Plus ou moins bien troussé, mais de l’ameublement.
Le racisme est latent oui, mais pas plus que chez Robert Mitchum et son album calypso, bien blindé lui aussi… Alors faut-il contextualiser ? Sans doute. Un vieux Mitchum aujourd’hui regretterait-il ce genre de sortie discographique ? Peut-être…
Mais il est vrai que l’effet miroir du couple propre sur lui qui verse ensuite dans de la criminalité lourde (tout du moins pour Frederik), ça jette un froid… Bravo pour cet article qui m’invite aussi à évoquer dans un registre assez glauque aussi l’excellent article d’Aureliano Tonet hier dans le Monde sur la crise d’identité de l’eurodance, qui n’est pas piqué des hannetons non plus… Cheers ! (avec ou sans daïquiri). Hervé