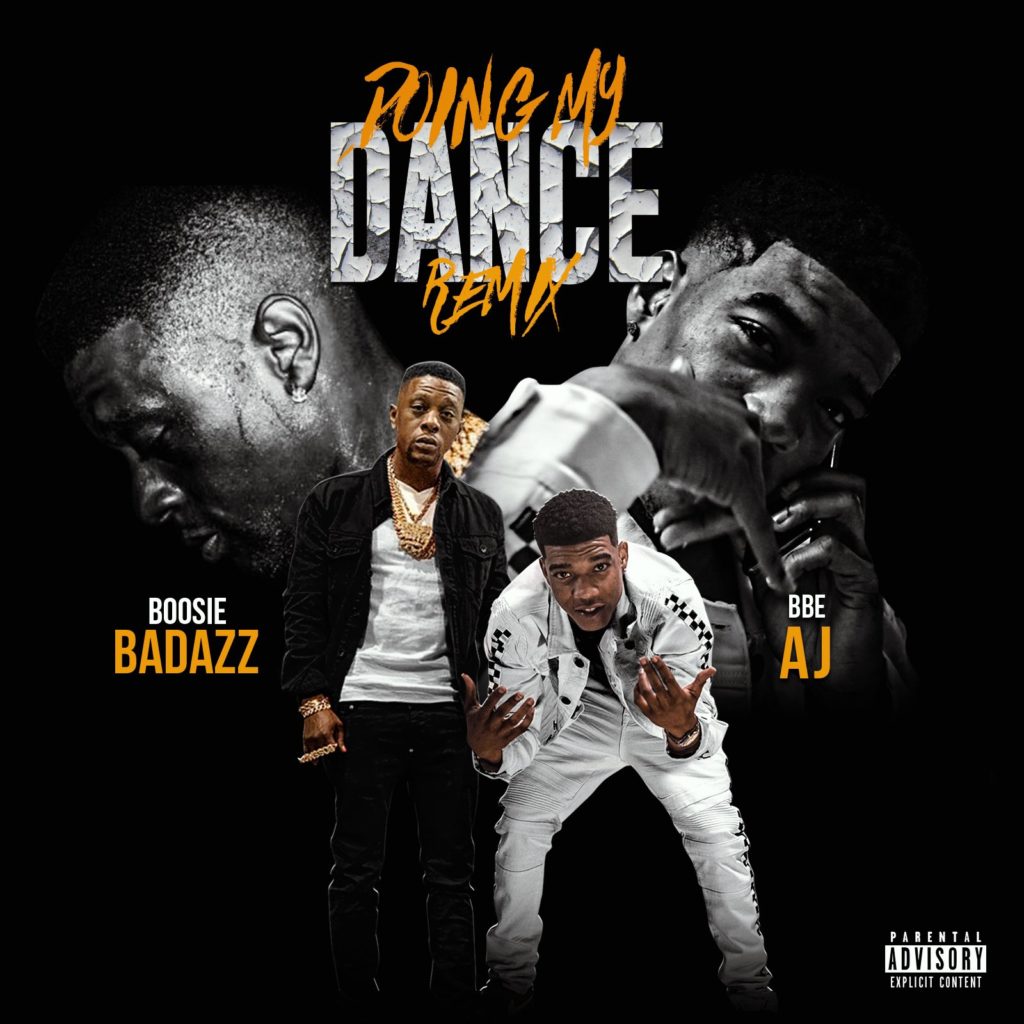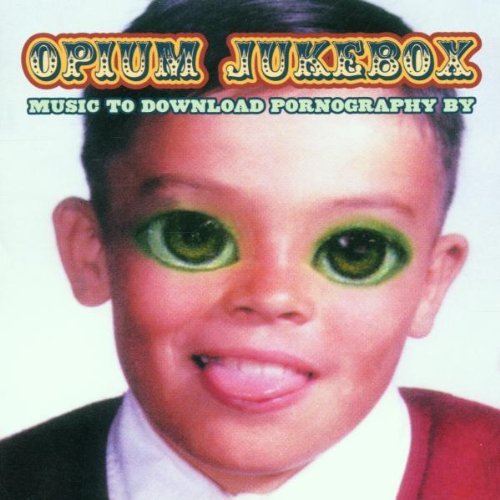Dans le cadre du projet en ligne « Musique et soin » que les Siestes électroniques ont lancé l’an dernier en l’absence du festival IRL, le service jeune public du centre Pompidou nous a commandé plusieurs courtes vidéos en animation, centrées sur des disques que j’ai été chargé de sélectionner pour leurs vertus thérapeutiques et au sujet desquels j’ai rédigé puis lu des petits textes que j’espère compréhensibles pour les bambins qui m’écouteront. Mais c’est surtout le travail d’animation de notre ami (voire petit ami) Nicolas Balas qui devrait leur plaire, et qui je pense plaira également aux adultes : dessiné en noir et blanc, il montre les artistes et leur imaginaire en train de se déployer lentement sous nos yeux et je trouve ça très beau, simple et réussi. Les vidéos sont insérées au milieu du programme Mon Œil, qui dure une vingtaine de minutes, mais le lien que je vous ai mis est « timecodé », donc vous devriez tomber directement sur l’anim de Nicolas. Celle que j’ai intégrée ici concerne les cassettes d’Alice Coltrane (1937-2007), sorties en private press entre 1982 et 1995, mais vous en trouverez aussi une autre qui aborde Dancing for Mental Health de Will Powers, et il en reste deux à sortir, l’une sur Karezza de George Issakidis et l’autre sur l’anthologie Berceuses du Monde éditée par Mental Groove et l’AIMP/MEG.
Cette période longtemps restée secrète de la carrière d’Alice Coltrane a fait l’objet d’une compilation sortie chez Luaka Bop en 2017, dont il avait été pas mal question dans les médias. Vous connaissez donc peut-être déjà un peu l’histoire de ces disques (trois cassettes et un CD, pour être précis) mais je vais quand même la raconter au cas où vous n’auriez pas suivi. Après la mort de John Coltrane en 1967, Alice a décidé de faire son deuil en poursuivant les recherches spirituelles et musicales qu’ils avaient débutées ensemble. Elle a continué à jouer, à enregistrer et à publier des disques, principalement chez Impulse! puis chez Warner, notamment accompagnée de Pharoah Sanders sur le fantastique Journey in Satchidananda dont parlait Marc-Aurèle la semaine dernière. Elle reste ainsi très présente dans les années 1970 et ses compositions, où elle adjoint au piano et au Rhodes le son d’une harpe majestueuse, font aujourd’hui partie des classiques du jazz dit « spirituel » de cette époque. Une spiritualité qui chez Alice s’est traduite par une conversion à l’hindouisme en 1970 et par le choix d’une vie dévouée aux pratiques védiques et au culte de Vishnou. Elle fonde elle-même un centre védique en Californie en 1975, puis se fait rebaptiser Turiyasangitananda.
Hélas en 1982 un nouveau malheur frappe Alice et sa famille : son fils aîné John Jr. meurt à 18 ans, dans un accident de voiture. Pour réussir à dépasser l’horreur et le désespoir, sa foi s’intensifie et avec elle sa croyance en la réincarnation. L’année suivante, elle ouvre l’ashram Shanti Anantam au nord de Los Angeles et y relocalise le centre védique. Elle y vit en communauté, parmi sa famille et plusieurs dizaines de convertis. La musique reste bien sûr au cœur de sa vie mais elle ne va désormais plus la faire entendre hors de l’ashram : chaque dimanche, pendant la cérémonie hebdomadaire, elle joue pour ses proches et surtout, se met à chanter, elle dont la voix n’avait jusqu’ici jamais été enregistrée et qui n’avait jamais chanté ailleurs qu’à l’église à Detroit, dans sa jeunesse. Elle chante d’abord seule, avant de peu à peu encourager les fidèles à reprendre en chœur ses prières, puis plus tard à prendre eux-mêmes le lead au micro. Si la dimension indienne reste très forte dans ces morceaux, on sent au fil des années l’influence gospel nourrir de plus en plus ces chants dévots. Surya Botofasina, qui est alors un jeune garçon vivant dans l’ashram avec sa mère, une musicienne amie d’Alice, fait remarquer dans les notes de pochette de l’anthologie que les chants s’appuient, contrairement à leurs versions indiennes « originales », sur un « backbeat » que Coltrane/Turiya et ses différents percussionnistes lui impriment chaque dimanche. « On sent qu’il y a truc très Detroit dans ce backbeat, c’est le même truc que dans les chansons de Stevie Wonder, qui comme Alice vient lui aussi de Detroit », résume-t-il simplement.
Ces morceaux qui mêlent l’élan du gospel à la méditation vishnouïste ne s’entendent pas encore sur Turiya Sings et Divine Songs : ce seront surtout sur Infinite Chants (1990) et Glorious Chants (1995) qu’ils s’épanouiront, deux albums pas disponibles sur YouTube mais que vous pouvez trouver ailleurs et dont quelques titres figurent sur le disque de Luaka Bop. Honnêtement, je ne sais pas s’il existe un mélange plus bouleversant que ça, cette fusion sonore de l’église et de l’ashram, des spiritualités hindouiste et chrétienne afro-américaine, et je parle en tant que blanc français non-baptisé et élevé dans l’ignorance religieuse crasse. Mais l’élément qui rend cette rencontre encore plus immense, encore plus enveloppante et élévatrice, c’est sans aucun doute la seconde innovation d’Alice après l’usage de sa voix : son recours aux synthétiseurs, et surtout à un synthé spécifique, le Oberheim B8, clavier majeur du son synth-pop, qu’elle a su s’approprier sans pour autant qu’on n’en reconnaisse plus les « origines » : elle conserve la même brume ondoyante et les mêmes glissandi qu’on entend, en vrac, chez les Pet Shop Boys, Jam & Lewis, Sun Palace ou Prefab Sprout. Et par dessus le marché, la musicienne et compositrice a aussi adjoint de vraies cordes. Le résultat est vraiment, littéralement, sublime, au sens kantien, j’ose le dire.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus que de commencer en allant écouter « Jagadishwar », premier titre de Turiya Sings, et de vous fondre dans ce mouvement éternel de nappes, de cordes, et de voix, ces changements d’accord qui ont l’air de vous effacer et de vous alléger peu à peu. C’est un sentiment très troublant où vous devinez le bien que ça pourrait vous faire de ne plus avoir de corps et de n’être qu’une âme qui volerait sur le monde sans le juger, qui aurait résolu les mystères du poids de l’existence, pesante car indissociable du bien et du mal. Les morceaux gardent cette sérénité indifférente aux tumultes bien que consciente de la noirceur, qui peut porter l’ombre en elle en même temps que l’espoir, et je me dis que ce sont les nuances vaporeuses du Oberheim B8 qui permettent de faire émerger ce sentiment double, tellement puissant. Il y a quelque chose de statique, de suspendu, qui dans la musique new-age de la même époque peut parfois se révéler déprimant ou juste ennuyeux, mais là les ondes stationnaires du synthé diffusent une impression de vie, de vie meilleure ailleurs que la vie d’ici, mais qui ne donne pas juste envie de quitter son existence en se jetant de la falaise, mais plutôt d’y installer cette conscience d’un après, une perspective qui soigne en aménageant, au cœur même du monde fini et du temps sourd, un espace de beauté et de paix, qui nous met en contact avec un je-ne-sais-quoi de sain et de satisfaisant, dans un sens bien sûr différent de la satisfaction personnelle, saturée de sérotonine et d’ego et gonflée de déchets « moïques », celle de notre quotidien, de nos relations, de nos discours et de nos regards.
Comme je le dis dans la vidéo, c’est de la musique qui fait couler les larmes, mais des larmes qui nous rincent, nous lavent non pas de nos péchés mais de ces déchets qui prolifèrent en nous, sinistres sujets gloutons. C’est un rinçage qui est tout le contraire d’un Kärcher, un jet très très très doux, comme un ruisseau, un imperceptible quoique dense brumisateur qui estompe nos silhouettes du grand canevas de l’humanité défectueuse. Effaçons-nous toustes, et laissons seulement la musique d’Alice Coltrane et de ses amis résonner le temps que nous nous dissolvions.
Mais comme, hélas, nous devrons attendre la décomposition réelle de nos corps pour nous quitter (nous quitter les uns les autres mais surtout nous quitter nous-mêmes, enfin), il nous faut en réalité continuer à vivre et donc le mieux, pour attendre et honorer les âmes, c’est de chanter et de danser, et c’est là qu’on écoutera donc, après Turiya Sings et Divine Songs, les albums suivants ou l’anthologie Luaka Bop. La musique y est toujours planante, ou plutôt elle est planée, comme un drone sauvage avec le créateur pour seul guide. Mais le fameux backbeat lui donne son groove et les chants, souvent en call and response, génèrent cet esprit collectif, ce truc d’unicité très frappant, c’est la chanson de personne et de tout le monde à la fois. « Om Rama » est dingue, mais j’ai l’impression que la version Luaka Bop diffère de la celle d’Infinite Chants. Encore plus dingue, « Sita Ram » devrait bien passer en closing de n’importe quelle fête quand on pourra recommencer à sortir la nuit, tout le monde tapera des mains, et d’ailleurs je ne serais pas étonné que des producteurices n’aient pas déjà composé un bon edit de ces dix minutes épiques. D’autres passages du disque sonnent presque garage du New Jersey, Nu Groove, tous ces trucs deep mais souvent lo-fi, fin 80 début 90.
Bon allez, j’ai beaucoup trop parlé là, cet écran est jonché de déchets moïques. Alors allez donc écouter cette œuvre secrète qui est sans doute la meilleure chose secrète à avoir jamais été dévoilée, et qui nous expose un pan totalement exceptionnel de la musique synthétique et spirituelle, et qui a été pour moi sûrement la plus belle rencontre musicale que j’ai faite depuis dix ou quinze ans.
NB : je vous encourage chaudement à aller mater les notes de pochette qui sont en ligne sur le site de Luaka Bop, où l’on peut lire des interviews des membres de l’ashram et trouver plein d’informations sur la fabrication des disques et la manière de procéder d’Alice et ses amis. On y apprend en outre que l’ashram avait un temps carrément eu une petite émission sur une télé locale, à la fin des années 80, je n’ai pas cherché si des archives étaient en ligne mais ça devait être quelque chose !
HARI RAMA. HARI KRISHNA.