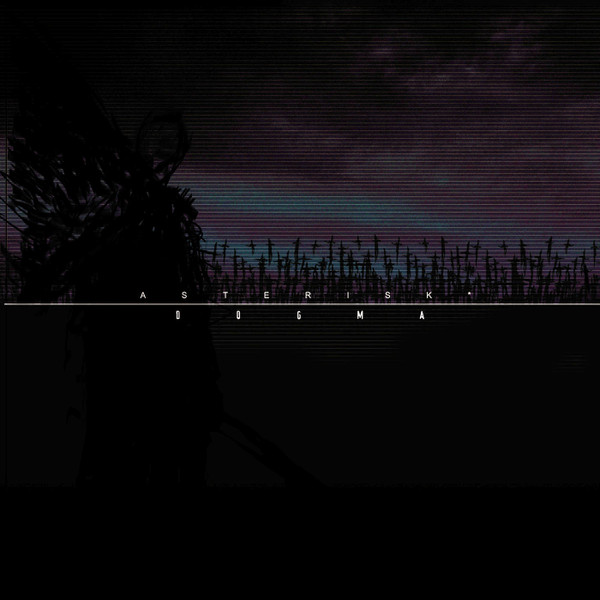Après Hejira de Joni Mitchell dont Antoine Kharbachi parlait voici quelques mois, ce sont de deux autres classiques dont on va parler aujourd’hui sur Musique Journal (et ce genre de choses devrait d’ailleurs se reproduire régulièrement puisque ça y est, je crois qu’on a épuisé le stock des trucs pas connus !). On sait que les deux premiers albums de Soft Machine sont des œuvres reconnues par tout le monde ou presque comme des monuments du psychédélisme et du rock progressif. Au-delà de ça, on peut dire que ce sont deux disques fascinants parce qu’ils marquent une vraie rupture dans la forme pop tout en procurant une expérience d’écoute totalement irrésistible, jamais torve : c’est une espèce de source chaude dans laquelle les auditeurs se baignent à volonté, sans que jamais son eau ne tiédisse ni ne croupisse. Mais ce que je voudrais essayer ici de souligner, c’est que même si on considère donc Soft Machine comme l’un des groupes pionniers du prog-rock, je trouve que leur identité prog « orthodoxe » n’apparaîtra que plus tard, à partir de Third. Sur The Soft Machine et sur Volume Two, il y a évidemment déjà une certaine complexité d’écriture (time-signatures pas toujours simples, changements d’accords imprévisibles, etc.) ainsi que des morceaux en plusieurs parties et des textes moins accessibles que la moyenne de la pop song de 1967. Mais néanmoins, si l’existence de ces traits proto-prog ne peut être contestée, l’ambiance générale et le registre émotionnel, le son, les mélodies, le ton, et évidemment la voix de Robert Wyatt n’ont rien en commun avec ce que deviendra le prog officiel – à savoir une musique assez sérieuse, parfois fabuleuse, mais souvent très calculée, voire dans le pire des cas pontifiante, et qui en tout cas cherchera à se démarquer du « Ça » infantile qui depuis le début des années 1950 avait alimenté le rock. Et surtout, si ces deux albums sont aussi jouissifs à écouter, c’est parce que leurs tracks s’enchaînent les uns aux autres, il n’y a aucune interruption : en somme ce sont des véritables mixtapes, des projets conçus pour passer une soirée géniale entre copains et copines. Une mixtape où certes ne figure qu’un seul groupe, mais ce groupe veut jouer et faire entendre tellement de choses que finalement il occupe presque une fonction de DJ avant l’heure.
Pour des raisons sans doute en partie personnelles, le early Soft Machine m’évoque également des ambiances de cocons hivernaux, mais de cocons où plutôt que de « chiller » ou d’hiberner, on se retrouve donc à faire la fête, chanter, boire et danser. J’imagine un climat hostile dehors, la pluie le vent le gel qui sait, et Robert Wyatt, Kevin Ayers et Mike Ratledge trouvant refuge à l’intérieur d’une caverne, ou d’une taverne, ou juste d’une de ces maisons anglaises pas forcément bien isolées mais où la bouilloire chauffe plus ou moins tout le temps. On y sirote des cocktails maison, des grogs ou des choses à base de cidre chaud, on se prépare vite fait des savouries pour éponger tout ça, et on joue ensemble des chansons, on teste des compos, voire on tape le bœuf, puisque c’était comme ça que ça se passait en 1967 : ça jammait fort.
Il y a plein de façons de décrire le son de Soft Machine première époque mais je voudrais donc insister sur ça, sur cette ambiance chaleureuse, ce groove d’intérieur, ces corps britanniques qui se protègent des assauts climatiques et se détendent en faisant cette musique souple, qui part dans tous les sens au début mais qui finalement ne se perd jamais trop. Si vous n’avez vraiment écouté ce premier album, et donc a priori pas écouté le suivant non plus, on peut quand même résumer le style Soft Machine à quelques éléments. Il y a ce groove, donc, mené par la batterie de Wyatt et bordé par la basse souvent distordue d’Ayers et l’orgue électrique vrombissant de Ratledge, et marqué par l’absence totale de guitare, ce qui me plaît beaucoup puisque j’ai souvent du mal avec la dimension guitare-centrée du rock de cette époque. Il y a aussi évidemment la voix et le chant de Robert, qui semble toujours s’embarquer un peu au dernier moment dans l’aventure tout en donnant l’impression de savoir exactement ce qu’il va faire, et qui donne une humanité, une fragilité vibrante à l’ensemble. Une fragilité parce qu’il prend des voies pas toujours faciles dans ses lignes de chant, frôle le faux, le raté, le chouinant, mais finit par imposer ce quelque chose qui fait qu’on l’écoute encore aujourd’hui comme un moderne, un contemporain – je sais pas si c’est une question de prise de son mais il y a un truc très actuel, « en direct du réel » dans la résonance de sa voix. Il y aussi le fait que contrairement à la plupart des chanteurs anglais des sixties, qui en général imitaient des hommes afro-américains, on se demande de qui peut s’inspirer Wyatt avec sa voix, à la fois haut perchée et un peu éraillée : de chanteuses blues, de chanteuses soul ? En tout cas la douce familiarité qui auréole ses performances vocales se diffuse vite sur ce que font les instruments et au-delà de la physicalité dont je parlais plus haut, ce qui frappe dans Soft Machine et dans Two c’est bien la nature si hospitalière des mélodies et la façon si fluide qu’elles ont de s’enchevêtrer à la matière psychédélique que malaxe le groupe sur ces deux disques. Ça s’entend dès « Hope for Happiness », le premier morceau du premier LP, et puis ça revient très vite avec « Why Am I So Short », « A Certain Kind », ou « Save Yourself », « Why Are We Sleeping? » et sur Two ça s’affine encore, et ce dès l’intro, « Pataphysical Introduction pt. 1 », avec Ratledge touché par la grâce divine au piano, puis « Hulloder », « Dada Was Here » (sans doute mon morceau préféré de Soft Machine ces dernières années), qui s’enchaîne avec « Thank You Pierrot Lunaire », un peu plus loin il y a « As He lies Perfectly Still », franchement quelle masterclass ce double album (je l’ai à l’époque découvert sous cette forme en l’empruntant à la médiathèque de Boulogne Billancourt, encore merci à Alain, qui d’ailleurs avait le même look que Robert Wyatt).
En résumé c’est de la musique quasi parfaite, qui construit une utopie sonore combinant des affects et des passions qui me sont chères, à savoir le groove, la mélodie et l’expérimentation, ou disons en tout cas l’expérience, l’aventure, la quête d’un truc encore inconnu mais désirable. J’aimais beaucoup The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd à la même époque (et de la même époque aussi) mais aujourd’hui je le trouve clairement plus crispé et solennel que ces deux chefs-d’œuvre de Soft Machine. On y entend le futur de tellement de choses incroyables, je songe à des groupes francophones comme Aksak Maboul ou Etron Fouleloublan notamment, mais aussi à toute une petite nébuleuse d’artistes qu’on peut réunir sous l’étiquette art-pop et qui reprendraient cette idée de musique qui se la pète pas et qui cherche avant tout la liberté via une sorte de poésie de la sensation, le goût de la surprise, l’exploration d’un truc infantile puissant. Je dirais aussi, pour finir, qu’en termes d’identité masculine et de rapport au corps, quelque chose se passe dans la façon que ces musiciens britanniques qu’on ne sent au départ pas super à l’aise physiquement ont de se façonner une sorte d’exosquelette sonore en jouant de leurs instruments. C’est évidemment flagrant chez Wyatt (dont le corps connaîtra hélas un triste destin), mais ça se sent aussi dans la joyeuse furie d’Ayers à la basse et dans les sculptures et les fumées élaborées par Ratledge à l’orgue. Ces hommes se construisaient des organismes alternatifs, parallèles, la musique était leur métavers et ils n’en profitaient pas pour imposer une virilité surjouée comme celles d’autres rockeurs de leur temps. On les sent forts mais gracieux, pleins d’élan et d’amour, tels des apôtres sans prophète et sans religion autre que celles du son, de la fête, et de la musique comme art empirique d’un temps miraculeusement vivant.