À un moment, j’ai cru que j’aimais le tango parce que j’aimais Astor Piazzolla, mais cela ne va pas de soi, en réalité. En m’intéressant de plus près à ce genre musical, j’ai appris que l’œuvre du bandonéoniste – qui se présentait à mes oreilles comme une évidence – avait suscité de multiples controverses esthétiques. Pour en savoir plus sur ce dernier, je me suis mis à lire Le Tango, de l’auteur argentin Horacio Salas. Lecture passionnante, désarçonnante aussi : il faut attendre la page 408 (sur 423) pour croiser le nom du supposé grand maître. Pas exactement, selon Salas : « Polémique, arbitraire, ayant le goût de la controverse et des coups de génie, Astor Piazzolla incarne la différence, la nouveauté, le changement. »
Comparons brièvement le cas de Piazzolla à celui du chanteur Carlos Gardel, né en 1890 à Toulouse, considéré comme la figure la plus importante du tango. L’écoute du « Mi noche triste » de Gardel enregistré en 1917 me donne l’impression d’aller au musée, et le morceau arrive à mes oreilles autant comme une chanson que comme un document-témoin, une archive historique. Si j’écoute en revanche « Novitango » de Piazzolla, sorti en 1974 sur le classique Libertango, la sensation est plutôt cinématographique. La qualité de l’enregistrement, couplée à celle de la composition, donne à l’ensemble quelque chose de soufflant et de palpable ; cela pourrait rejoindre la B.O. d’un drame d’auteur contemporain sans faire poussiéreux. Pour le dire pompeusement, Gardel c’est LE tango, et Piazzolla c’est…
– J’en ai assez que tout le monde me dise que ce que je fais n’est pas du tango. Moi, comme je suis fatigué, je réponds que je fais de la musique de Buenos Aires. Mais la musique de Buenos Aires, qu’est-ce que c’est ? Du tango. Alors ce que je fais c’est du tango.
Merci pour cette clarification, Astor. Voilà où je voulais en venir : Piazzolla, même si je n’ai pas capté cela direct en écoutant ses morceaux, se pose en rupture. Il est l’incarnation d’une mutation de cette musique populaire née dans les bas-fonds de Buenos Aires, d’un moment où celle-ci incorpore de manière très directe d’autres influences, du jazz par exemple, et surtout de la musique classique. Piazzolla a eu l’occasion d’étudier auprès de Nadia Boulanger en France, qui l’a d’ailleurs encouragé à ne pas abandonner le tango au profit d’autres musiques prétendument plus sérieuses. Prenons le superbe « Pulsación n°4 » du bandonéoniste et mettons le curseur vidéo sur 3 minutes 20 ; sin on n’est plus tout à fait sûr d’entendre du tango, cette musique est fabuleuse. Piazzolla n’était cependant pas tout seul : Salas consacre à la fin de son livre un court chapitre à ceux qu’il appelle « les piazzolliens », qui débarquent dans la seconde moitié du XXe siècle. Nous parlerons plutôt d' »avant-gardistes », histoire de ne pas placer ces musiciens accomplis sous la tutelle d’une figure un peu (trop) mastoc. Je voulais d’ailleurs évoquer le cas de l’un d’entre eux : Eduardo Rovira.
Salas décrit le style de Rovira comme « plus mathématique » que celui de Piazzolla. Même si tout ce qui tend à mathématiser la musique me fait froid dans le dos, la remarque est juste ; et particulièrement sur son disque Que lo paren. Ses autres enregistrements valent aussi la peine – comme Tango en la universidad avec son trio, ou encore Sonico – mais j’y retrouve moins ce côté millimétré, ce sentiment de maîtrise totale qui fait que les morceaux ne sont plus seulement beaux, mais en deviennent sublimes. Les compositions de ce disque m’apparaissent comme des arborescences : tout s’y déploie avec naturel, sans hésitation ; il y a de la virtuosité mais rien de démonstratif et de trop appuyé (voir « Majó Majú », « Que lo paren »). La musique de Rovira est à l’image de ces plantes qui poussent logiquement, organiquement, mathématiquement, sous l’effet de la photosynthèse, et dont les fragiles membranes chlorophylliennes suscitent notre émerveillement lorsqu’on les observe s’agréger les unes aux autres. Comme toute pratique, l’art de Rovira se nourrit de son environnement ; et, comme en arithmétique, le changement d’une variable de l’équation induit nécessairement un autre résultat.
S’il veut rester authentique dans les temps nouveaux, le tango n’a d’autre solution que de ne plus être ce qu’il a été, ce qui est forcément dur à accepter pour les tenants de la tradition. Cela l’est d’autant plus lorsque la jeune génération s’éloigne elle aussi du tango pour lui préférer, par exemple, la pop. Ces avant-gardistes s’inscrivent en fait dans une époque jugée de déclin pour le tango. On aurait pourtant tort de les écouter comme des fossoyeurs : peu de doutes sur le fait que les subtilités – harmoniques, rythmiques, structurelles – qu’ils soumettent à nos oreilles sont un coup de pied dans la fourmilière des origines de cette musique. Le magnifique « El violín de mi ciudad » de Rovira illustre cette rupture de manière exemplaire.
Ajoutons un peu de piquant à cette querelle des anciens et des modernes : Rovira, ce « piazzollien », n’aime pas bien Piazzolla. Mais ça, Horacio Salas ne le dit pas. Eduardo est précisément agacé par la propension d’Astor à vouloir monopoliser l’espace de l’avant-garde, quitte à se compromettre, par exemple dans un disque avec Gerry Mulligan. « Piazzolla n’y joue pas du tango, pas plus que Mulligan n’y joue du jazz », affirme Rovira. Il déclare néanmoins : « La polémique ne m’intéresse pas. M’intéresse en revanche la possibilité d’éclaircir certains concepts, cela rend nos œuvres plus humaines. »
Le tango naît à la fin du XIXe siècle, à une époque où l’Argentine connaît une croissance démographique sans précédent, en raison de l’immigration. Les dirigeants du pays ouvrent massivement les frontières aux Européens, mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu : « ceux qui entreprirent le voyage n’étaient ni des Florentins cultivés capables de savourer les hémistiches de Dante, ni des Espagnols épris de Don Quichotte ou de Garcilaso, mais de pauvres hères analphabètes dépourvus d’instruction et ignorant tout des cultures millénaires de leurs pays » (dixit Horacio Salas, sympa !). C’est donc dans un faubourg miséreux grandissant à vue d’œil que le tango s’enracine, suscitant d’abord la répulsion de l’intelligentsia argentine.
Quand j’écoute les compositions de Rovira avec ce passé en tête, l’histoire semble tenir la route. Mais il y a autre chose, plus insaisissable, qui m’amène à penser que sa musique ne chausse pas exactement du même pied. Pour essayer de le comprendre, penchons-nous sur un vieux et célèbre tango, « El Choclo » d’Angel Villoldo, composé en 1903. Simple sans être simpliste, il me semble retrouver dans ce morceau un peu de l’innocence des débuts. Le résultat est saccadé et rugueux, à l’inverse des compositions toutes en fluidité et en finesse de Rovira ; j’y entends aussi du comique, de la loufoquerie, une certaine malice. L’histoire n’est tout de même pas si innocente : il s’agirait en fait du premier tango à avoir été joué devant les bourgeois, dans un restaurant de Buenos Aires, et pour qu’ils y consentent, il fallut d’abord les duper en le leur présentant comme une « danse créole ». Finalement, quelques décennies plus tard, le tango sera définitivement accepté par la plupart des Argentins, qui le revendiqueront comme un symbole fort de leur identité.
Dans les années 1970, Rovira donne ainsi à entendre un tango en âge de poser un regard sur son histoire. Je l’écoute spontanément avec une forme de romantisme, en ayant ce passé en tête. Mais l’innocence des débuts n’est plus vraiment là ; et paradoxalement, tandis que certaines des misères du passé ont dû s’amoindrir, la musique semble avoir acquis une nouvelle valeur tragique. Le faubourg n’est plus le même et cette musique n’a plus la même valeur de rébellion non plus. On peut présumer que c’est un moment de réancrage pour le tango : ce qu’il perd en pseudo-authenticité, il tâche justement de le gagner en communicabilité ; un nécessaire renouvellement qui a pu passer pour une trahison. C’est peut-être aussi un moment de riposte, celui où les descendants des « pauvres hères analphabètes » font se mélanger une partie de ce tango faubourien populaire avec un certain héritage classique européen, parfaitement assimilé ; au risque, pour ces tangueros adeptes de Jean Sébastien Bach, de déplaire à la vieille garde. Équilibriste, Rovira assume la nécessité de faire advenir une nouvelle musique pour exprimer une nouvelle réalité, sans pour autant se compromettre dans des oppositions manichéennes entre générations que la pop tend trop souvent à monter artificiellement en épingle :
– À l’inverse de Piazzolla, cela ne m’intéresse pas d’être le meneur de l’avant-garde. Je cherche au contraire à montrer avec fidélité quelle est ma manière de créer, et la possibilité permanente d’enregistrer ce qui incarne ma vérité au sein de l’avant-garde. […] Je ne suis pas contre le tango traditionnel. Je le respecte comme l’expression d’une époque qui n’est déjà plus la nôtre.
Sur son disque Que lo paren, on l’entend rendre compatibles ces divers héritages présumés contradictoires. S’il me plaît particulièrement, c’est aussi parce qu’il dénoue merveilleusement bien le « problème » de ma non-adhésion aux musiques dites « classiques » (pas par principe, c’est un simple constat), vers lesquelles je me suis assez peu dirigé, de par mes habitudes d’écoute. Sur « Milonga para Mabel y Peluca » – sorte de « musique de chambre » –, Rovira me convainc cependant que oui, moi aussi je peux aimer ces choses-là. Je ne me sens plus obliger de porter une perruque in-folio Louis XIV pour apprécier ces sonorités et m’y identifier, je prends conscience de la part d’arbitraire qui existe dans mon rejet a priori de cette autre musique – merci Eduardo. Sur le même disque, il cale de manière parfaitement cohérente son « Tango para Charrúa », et on n’est clairement plus dans le salon du Roi Soleil, mais plutôt au bistrot en mode Un singe en hiver, avec Gabin et Belmondo qui font des conneries : je crois même retrouver un instant cette malice des débuts. L’orchestration et la narration restent en tout cas impeccables, c’est burlesque et beau, les mélodies poussent comme du lierre sur un mur de pierres, elles montent très haut, tout en bazar, et on ne comprend plus vraiment le pourquoi de ces débats sur la tradition et les avant-gardes.
Quelle frustration de ne pas pouvoir citer toutes ces compositions qui me bouleversent : « A Evaristo Carriego », « Tema para un hombre solo », « A Don Pedro Santillán »… N’hésitez pas à aller creuser. C’est finalement par cette dynamique perpétuelle de rejet-assimilation entre deux héritages en conflit que le tango s’offre aussi à nos oreilles comme une musique créole exemplaire, dont l’évidence peut parfois masquer les affrontements qui jalonnent son histoire. Ces avant-gardistes nous donnent à entendre ce moment unique où les frontières explosent, ou plutôt dansent ensemble. Mais de l’explosion à la danse, il n’y a qu’un pas – de tango bien sûr.

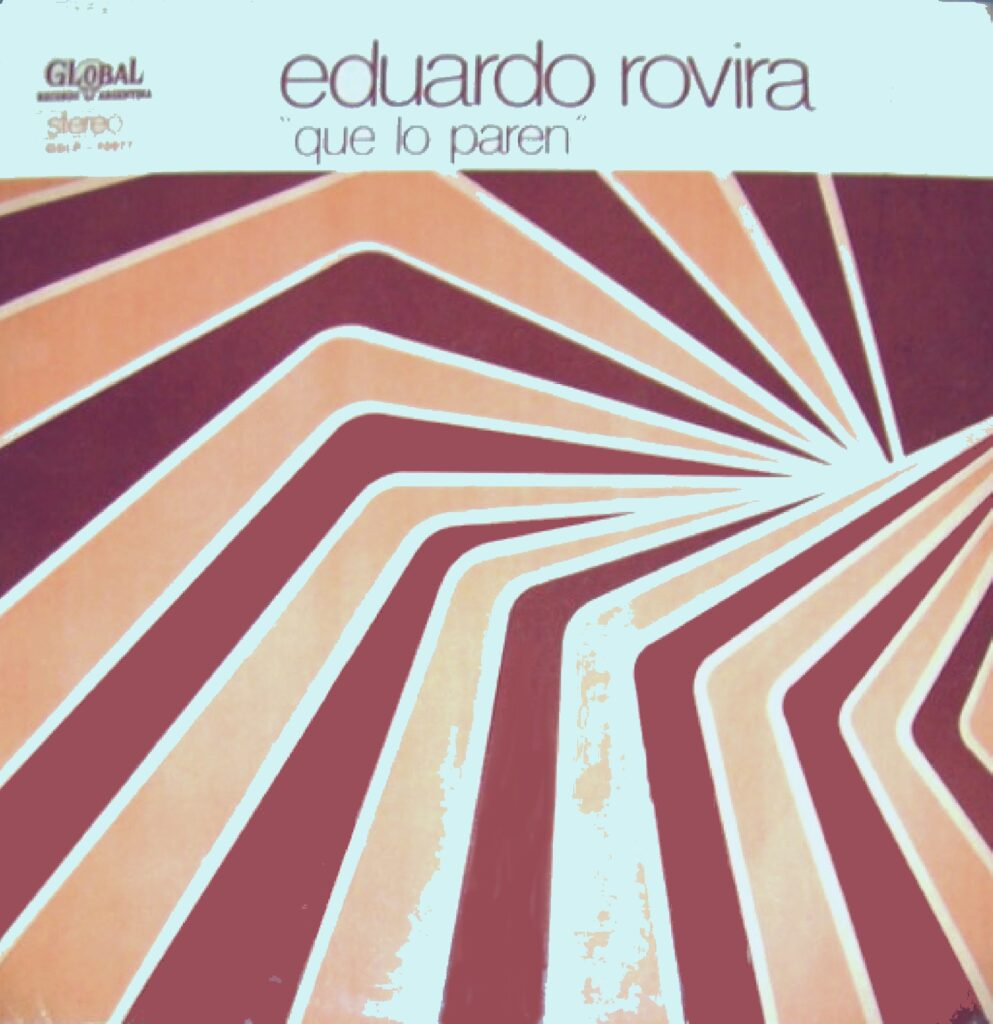




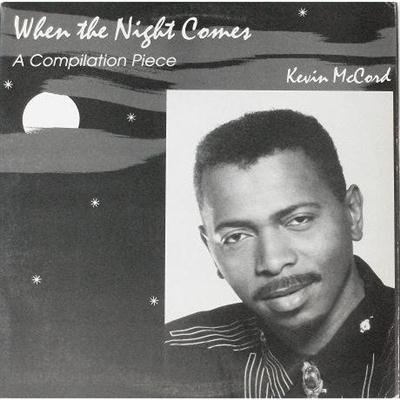
Un commentaire
Pour voir, un article bien informé : https://www.monde-diplomatique.fr/2022/04/MINGALON/64588