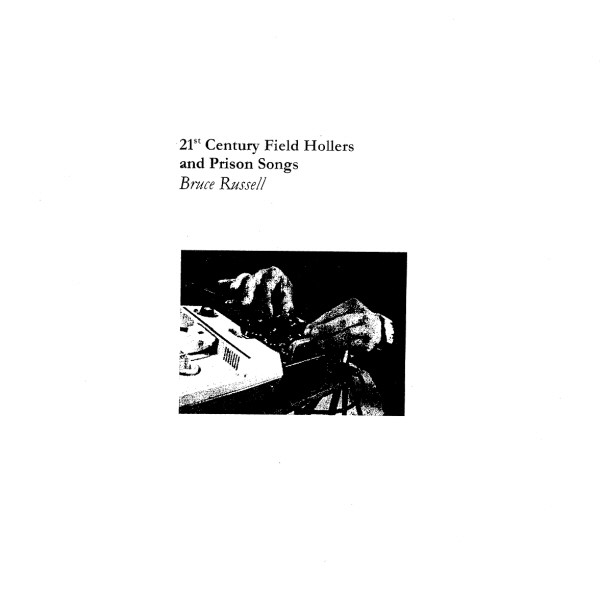C’est un fait, ou plutôt un stéréotype : les musiques fortement glucosées s’épanouissent sans peine dans les localités du capitalisme estival. Là où il fait chaud – et il fait chaud absolument partout, maintenant –, les tubes de l’été prennent comme du chiendent, collent mieux à la frénésie de soleil et d’achats compulsifs qui caractérise la période. Mais j’oublie que l’aridité et la torpeur sont des environnements tout aussi adéquats pour les musiques plus sèches et dures. Les assauts de l’astre solaire prennent alors une autre signification : intenses encore, ils entraînent une écoute plus « en dedans », tout aussi physique.
Je me rappelle avoir découvert les Dead C sur la fin d’une adolescence sans fin, alors que je commençais à expérimenter musicalement, à sortir des cadres du « tout-pop ». J’avais téléchargé Eusa Kills, leur second album sorti en 1989, pour la pochette, sans vraiment savoir de quoi il retournait ; ce free rock rêche, entre improvisations et chansons, toujours à deux doigts de se casser la gueule, m’avait entièrement retourné. Un batteur qui ne compte pas mais fonce (Robbie Yeats), un joueur d’ampli lançant des larsens comme des arcs électriques (Bruce Russell) et un guitariste aussi parfois chanteur à la finesse crépusculaire (Michael Morley) : voilà un trio dont la force vitale et la liberté formelle me parlait sans peine.
Cette épiphanie n’est pas allée beaucoup plus loin, dans un premier temps du moins. Si j’ai beaucoup réécouté cet album, je n’ai pas forcément cherché à explorer plus profondément la discographie (pourtant bien fournie) du groupe, ni à me renseigner plus assidûment sur lui. Ce n’est qu’une bonne dizaine d’années plus tard, en juin 2018, à l’occasion d’un passage de l’ensemble aux Instants Chavirés, que j’ai pris conscience, au-delà du choc esthétique, de l’importance historique des Dead C dans la construction d’une musique viscéralement électrique et dangereuse, qu’elle soit rock, noise, expérimentale, improvisée – souvent un peu de tout ça.
Durant la bonne heure qu’avait duré le concert, les trois musiciens, alors sexagénaires, n’avaient rien concédé. Improviser toujours, sans perdre la tension, rythmique et narrative ; remplir l’espace vite et fort afin d’en faire un nouveau cosme saturé et évolutif ; laisser la place à ce qui surgit dangereusement, aux éléments fragiles, formant un contraste : une seconde épiphanie.
Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressé aux travaux des néo-zélandais à partir de là ; ensemble, et séparément. J’ai notamment scotché sur leur trilogie sortie sur Siltbreeze – Harsh 70’s Reality, The White House et Tusk, plus free-form et diversifiée que Eusa Kills – ainsi que sur des albums plus tardifs, comme Secret Earth et Rare Ravers, sortis sur Ba Da Bing!. Dernièrement, ce sont deux albums solo des membres du groupe qui m’ont particulièrement touché : 21st Century Field Hollers and Prison Songs de Bruce Russell et Electric Guitar de Michael Morley. Si les deux productions n’ont pas grand-chose à voir dans les matières qu’elles déploient, elles demeurent les œuvres de musiciens ayant joué pendant plus de 35 ans ensemble, et des similitudes sont donc bien évidemment apparentes. Première analogie : nous avons là deux disques de guitare – pour toi, Étienne Menu –, certes très différents, mais également centrés sur l’instrument cordophone.
Sorti en 2006 et 2007 sur les labels w.m.o/r et Rococco Records, 21st Century Field Hollers and Prison Songs est construit comme une reconfiguration de Midnight Crossroads Tape Recorder Blues, album réalisé en collaboration avec le musicien allemand Ralf Wehowsky, dont Russell a presque exclusivement re-travaillé les matériaux. Selon ce dernier, ces morceaux s’ancrent entièrement dans les univers du blues et du dub. L’œuvre originale porte en effet une forte coloration blues des origines, bien que très expérimentale ; pour autant, les similarités avec la pratique insulaire jamaïcaine me semble bien plus difficile à percevoir dans cette version alternative – et c’est un euphémisme. Ne vous attendez donc aucunement à entendre les signes distinctifs de ces deux genres musicaux ici ; s’il s’agit de blues et de dub, c’est dans leurs versions les plus ascétiques, fantomatiques, et niquées possible. À l’écoute, on pense beaucoup à Wolf Eyes et Aaron Dilloway, à certaines choses de Kevin Drumm, un peu à Pansonic aussi, pour cette façon d’installer une ambiance à la fois lourde et dépouillée. Tout se chevauche, et de ces amas aux premiers abords un peu anarchiques – bande magnétique lue à diverses vitesses, boucles de feedback, collages, souffle, silences, saillies de guitare et bourdon – émergent une indéniable cohérence. C’est un dub encore un peu plus singulier que celui dont Thomas Dunoyer de Segunzac nous parlait à propos de To Live and Shave in L.A. ; aride et tranchant, il s’agit presque d’un négatif de dub, où les ressemblances se devinent justement parce qu’on ne les fait pas apparaître.
Electric Guitar a été publié en 2021 sur un label de Chicago bien chouette, Radical Documents. Les manières d’y appréhender la guitare et les matériaux sonores paraissent d’abord antithétiques avec celle développées par Bruce Russell : tout est plein, dans la répétition et le tuilage des harmonies, réalisé avec une certaine finesse instrumentale. Un parallèle s’établit d’ailleurs entre les jeux que les deux musiciens déroulent en solo et ensemble, au sein des Dead C ; il y existe aussi des résonances entre ces pratiques, où les façons de gérer les larsens, la temporalité, la dramaturgie se font écho. L’album de Morley laisse cependant beaucoup plus de place au temps long : les quatre plages qui le composent s’étalent toutes sur plus de quinze minutes ; s’y développent des mélodies homériques et simples, un peu post-rock parfois, d’où émerge une sensation d’insularité ; quatre îles, également marquées par l’ascèse et le spectral, mais d’une manière autre. Le soleil frappe fort, encore. Là où Russell fait fondre l’asphalte en un temps record, Michael Morley évapore et condense, alourdit graduellement, jusqu’à ce que le corps tinte dans son entièreté.
Alors que le soleil assomme pour toujours, apparemment, revenir à ces musiques entraîne un processus d’assainissement, une purge extatique et profane. Le soleil engendre et détruit, ne l’oublions pas ; les arbres crament, la peau idem ; à ces altérations violentes, maintenant installées, faire répondre le musical.