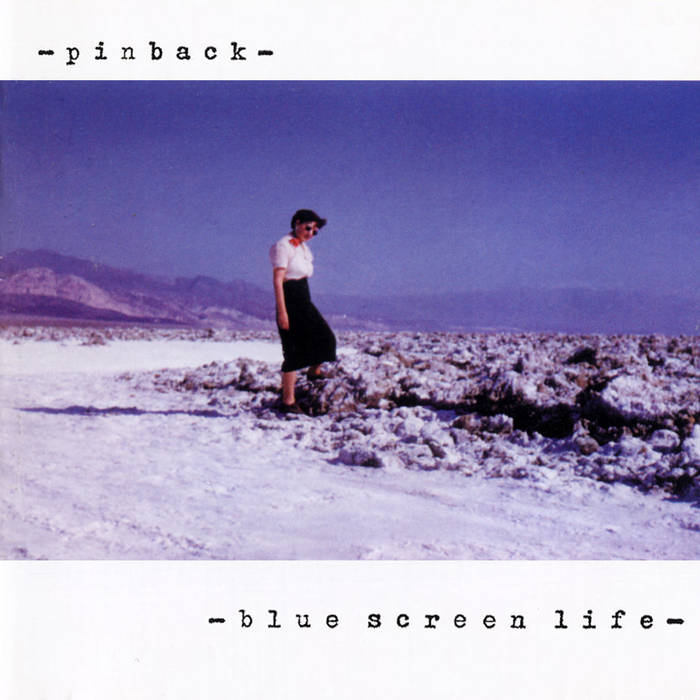C’est jeudi dernier que je suis retourné au Lieu documentaire à Strasbourg – avec émotion, puisque j’y avais effectué un long emploi jeune il y a déjà de nombreuses années, sous l’égide de son directeur de l’époque, Georges Heck, et que j’avais plus souvent qu’à mon tour posé mes fesses dans la minuscule mais chaleureuse salle de projection de cet endroit situé à quelques pas de la gare. Je suis allé voir un film de Jean-Louis Comolli, cinéaste, écrivain, ancien rédac’ chef des Cahiers du cinéma, passionné de musique (il a co-écrit le fameux Free Jazz Black Power) récemment disparu : On ne va pas se quitter comme ça, titre parfait pour rendre hommage à cet homme qui venait nous rendre visite souvent à l’invitation du directeur du Lieu à l’époque, pour parler images, politique, politique des images et images de la politique. Toujours élégamment vêtu d’un long manteau de laine sombre et d’un chapeau (Panama ?), Jean-Louis Comolli se distinguait par sa présence discrète, par son calme apparent qui cachait un bouillonnement perpétuel au service d’une réflexion sans doute bien pointue – elle m’échappait d’ailleurs en partie – sur le cinéma et au-delà. J’aimais la douceur de sa voix et le rythme de sa parole, la passion et la somme d’informations qu’elle charriait inlassablement.
C’est par ce petit film réalisé en 1980 pour une télévision alors bien aventureuse, d’avant-garde, osons le mot, que j’ai compris une partie du génie (naissant) de Jean-Louis. C’est aussi et surtout parce qu’il répond à une question centrale : comment filmer la musique ? À une époque où le moindre montage tiède d’archives sur lequel un journaliste plus ou moins enflammé pose sa triste voix off fait figure royale de documentaire, il y a de quoi se la poser. Voir On ne va pas se quitter comme ça, c’est déjà y répondre et bien y répondre. Miraculeusement apparu sur les réseaux après le décès de Jean-Louis Comolli et avant de trouver sa voie vers la salle du Lieu documentaire comme il se doit, ce film, conservé comme d’autres merveilles par l’INA, évoque la vie d’un des derniers bals musettes de Paris au tout début des années 1980. Le Tourbillon a fermé, le Boléro aussi, il reste la Boule Rouge, repère de passionnés et passionnées d’un certain âge de cha-cha-cha, paso doble, valses, slows joués en direct par un groupe en costume gris : accordéon, bien sûr, orgue Elka, batterie mais aussi flûte traversière ou trompette. Et puis Simone Real, figure centrale, chanteuse à la gloire passée (« j’ai fait une tournée de réclame pour Pathé Marconi avec Charles Trenet ») prend la scène pour chanter la mélancolie et la nostalgie d’une époque qui change.
Fin d’époque ou revival : comme de jeunes gens qui essaieraient de recréer la magie des Byrds dans une cave de Bordeaux, Simone Real rejoue les partitions des chanteuses parisiennes du milieu du XXe – Piaf, bien sûr et on imagine Fréhel, Damia… – et de sa carrière déjà lointaine (son dernier disque remonte déjà à 1966). Mais on s’en fout, à la limite, car ce qui se joue devant la caméra de Comolli dépasse très vite le cadre purement musical ; ou plutôt, il montre les vies que la musique berce, soigne, accompagne. Celle de Simone, hantée par les fantômes de ses idoles mais aussi par sa relation avec sa petite fille ; magnifiques moments où le documentaire se double d’une fiction, avec des scènes écrites qui jettent un trouble fabuleux sur la perception de cet objet télévisé. Celles des danseuses et des danseurs qui investissent le parquet – préalablement recouvert de sciure de bois – de la Boule Rouge. Ils échappent à leur âge apparent en tournoyant de façon aérienne entre les murs en miroir au son du groupe. Derniers bals musette pour amoureux imaginaires : les dames d’un certain âge rentrent dans le café, s’installent avec leur Vittel-menthe. Puis les hommes, endimanchés, entrent à leur tour sous les commentaires, les « oh », les « ah », des femmes installées et spectatrices de cette parade enjouée de costumes sombres. Parce que la danse n’est que le début, espèrent certains, d’une histoire, ou d’une aventure, tout simplement.
Magnifiques de tension, la caméra au plus près des visages et des corps qui se touchent, se meuvent avec prestance. Des scènes évidemment sublimées par les musiques jouées à l’épure par des gars à chevalière et gourmette, regards perdus on ne sait où (Emile Decotty et son orchestre). Ça ne rigole pas vraiment. Simone mène ce bal des vauriens et le film vaut tout. Premier coup de maître pour Comolli, ce film réussit à évoquer beaucoup de choses : trajectoires de vie et rencontres, avec des figures féminines au premier plan qui racontent beaucoup de leur condition, tout en restant avant tout musical, au plus près des corps des danseurs et des musiciens. On est dans une approche âpre de la réalité, reconstruite mais sans fard. La vie comme une danse qui ne veut jamais s’arrêter, mais qui voit le temps passer et détruire irrémédiablement : les échanges entre les générations (petite fille, filles) sont des très beaux moments. Le bal musette qui trouvera bientôt refuge dans la télé de Pascal Sevran la décennie suivante : Simone Real devenant plus ou moins habituée des plateaux doucereux et pastel de la Chance aux chansons. Une autre époque, mais on allait pas se quitter comme ça, n’est-ce pas.