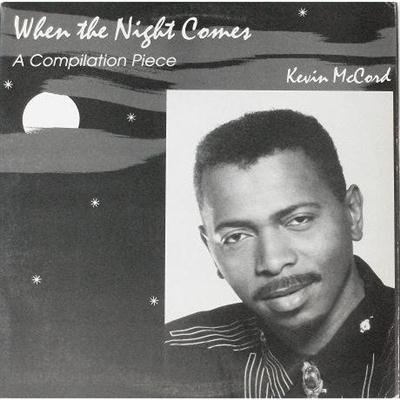Je me souviens d’un voyage au Pérou, en 2018, au lac Titicaca, à Taquile, une petite île de 2000 habitants, à 4000 mètres d’altitude. En général, faute d’infrastructures, les touristes qui la visitent n’y restent qu’une paire d’heures, avant de repartir en bateau vers la ville de Puno, sur la rive du lac. Passer la nuit là-bas, logé chez l’habitant, est une bonne occasion d’avoir une « expérience » plus calme de l’île, pour profiter de son atmosphère et de son folklore singulier (tous les hommes y portent par exemple un bonnet dont la couleur vous renseigne sur leur statut marital), et, avouons-le, d’essayer de vivre le fantasme touristique 2.0 de l’authenticité. Après le départ des tour-opérateurs en début d’après-midi, je me retrouve seul parmi les résident·es insulaires. Un cadre idéal pour sillonner en toute tranquillité les cinq kilomètres sur lesquels s’étend cette langue de terre, et faire l’expérience auditive du silence lacustre péruvien, qui n’avait a priori pour seuls adversaires que le vent, quelques troupeaux et des habitant·es généralement taiseux·es.
À l’approche de la première extrémité de l’île, du « gros son », un truc genre rave Goa dans mon souvenir, s’échappe d’une maison à quelques dizaines de mètres. Une fois arrivé au bout du bout, sur une petite plage, cerise sur ce gâteau d’authenticité, je comprends que je ne suis pas le seul touriste : deux autres Français sont déjà là depuis quelques jours – sans lien avec la musique entendue, à ma connaissance. Si mon court séjour n’en a pas souffert, il est toujours plutôt comique de voir vos fantasmes de voyage écornés par ces petits dérapages du réel. On se croit au bout du monde, et on se découvre plus modestement sur un bout de monde.
J’ai d’abord cru que l’anecdote s’arrêterait là, mais non. Trois ans plus tard, me voici de passage à Annonay, dans le nord de l’Ardèche, territoire que j’associe pour le coup davantage au gros son et à l’art de la rave-party rurale décentralisée. Un tout autre tableau. Je me retrouve là-bas à fouiller sans espoir un bac à disques flingué du magasin Activ’ emploi, sorte d’Emmaüs local. Alors que je suis à deux doigts de baisser les bras, je dégote un disque du label Ocora de 1985 que je n’avais jamais vu, Pérou. Taquile, île du ciel. Musiques Quechua du lac Titicaca. Bon sang, qui a mondialisé qui et quoi ? Mes désirs contrariés recevaient, avec quelques années de retard, la monnaie de leur pièce ; avec Ocora, en matière d’authenticité, on est rarement déçu du voyage.
Tout ça pour vous parler, non pas de trance Goa, non pas d’un disque Ocora, mais d’un autre disque péruvien, sorti en 2022, plus précisément une compilation rétrospective publiée par le fantastique label Buh Records (lui aussi péruvien) : Territorio del eco. Experimentalismos y visiones de lo Ancestral en el Perú (1975-1989). Ou littéralement : « Territoire de l’écho. Expérimentations et visions de l’Ancestral au Pérou ». Un album dont la découverte en ligne m’avait d’emblée interpellé, avant même d’écouter quoi que ce soit, tant ce titre m’intriguait ; j’ai vite brûlé d’écouter ce que ces « visions de l’Ancestral au Pérou » pesaient à côté de mes désillusions touristiques d’antan et de cette étonnante découverte discographique en Ardèche (qui malheureusement n’est dispo sur aucune plateforme, comme à peu près tout le catalogue Ocora, non-réédité depuis environ vingt ans).
On ne peut pas réduire la critique intime d’un album à une chasse aux coïncidences, mais ça m’amuse de relever que le premier morceau de la compile est une pièce d’Omar Aramayo, poète et compositeur précisément originaire de Puno, ville située à 30 km de l’île de Taquile. Je note aussi que l’anthologie Ocora a été enregistrée entre 1979 et 1984, soit en plein dans la période qui concerne celle de Buh Records. Deux disques sortis à plusieurs décennies d’écart donc, mais avec des enregistrements de la même période, et surtout, deux propositions tout à fait différentes pour nous renseigner sur ce que pouvait être la musique péruvienne de l’époque. Le label français s’attelle à la noble tâche de documenter certaines traditions suffisamment vivaces pour être enregistrées in situ ; le label péruvien offre quant à lui une perspective toute autre. Sur la compilation, la tradition n’apparaît pas comme un présent potentiellement précaire, exigeant par là même d’être sauvegardée ; elle s’y présente davantage comme une toile de fond, un passé vivant, qu’il faut interroger. Ce que nous entendons n’est ni la recherche d’authenticité ni son refus : ce sont des voies dont l’exploration amorce un dépassement.
Dans son histoire du label Ocora publié dans le numéro 4 d’Audimat et dont une bonne partie est encore lisible sur le site de Vice, Étienne Menu soulignait justement une chose qui fait écho à ce que je ressens en écoutant les deux compilations : « Avant d’écouter un enregistrement Ocora, le mélomane occidental se trouve animé par tout un monde de fantasmes et tient vraiment à ce que l’écoute le concrétise – comme ça, d’un seul coup. Il attend plus ou moins un miracle, mais ça ne va pas du tout se passer comme prévu. […] Le problème vient du rapport de l’enregistrement à ce qui est enregistré : il se dégage peu à peu quelque chose d’opaque, d’inhospitalier. C’est une forme non-séduisante d’exotisme. » C’est vrai. Et justement, sur ce disque de Buh, là où le miracle s’accomplit, c’est que le monde de fantasmes de l’auditeur « occidental » (i.e. moi) rencontre celui des musicien·nes présents sur le disque. Un miracle somme toute assez banal, mais troublant dans l’optique de cette rétrospective ethnomusicologico-chimérique.
Ici, on a surtout affaire à des enregistrements inédits ou à des trucs auto-édités de l’époque, ou encore à des captations live – des objets qui n’étaient pas forcément destinés à sortir des frontières péruviennes pour atterrir sur les étals d’un grand marché sonore pittoresque et mondialisé. Mais ces enregistrements disparates réalisés sur une période de quinze ans forment tout de même un tout harmonieux et énigmatiquement homogène. Ainsi que l’explique Luis Alvarado (auteur des notes de pochette et patron de Buh) : « Ces réinterprétations du folklore ont établi un territoire commun, une manière d’envisager l’expérimentation comme une expérience connectée à une vision ancestrale. Le territoire de l’écho fut cet espace de convergence entre un imaginaire mythique et l’aspiration à une musique nouvelle. »
Et donc, j’insiste, le résultat est séduisant même si, pour éviter tout malentendu, on reste dans la musique expérimentale (n’espérez pas vous faire hameçonner par des couplets-refrains dopaminés). Dès la première composition d’Omar Aramayo, on est plongé dans un climat de douce oscillation entre divers bruits électroniques et une flûte indigène dont le léger écho vient comme nous télescoper dans une vallée andine inconnue mais hospitalière. Sur « Jungle », on entend d’obsédants tambours se conjuguer parfaitement à la voix d’outre-monde de Corina Bartra, pendant qu’opère la magie onirique d’une batterie d’effets aussi timide que stupéfiante. Sur « Bosques girando al ritmo del sol », c’est comme si le minimalisme pianistique états-unien rencontrait subitement une âme sœur chez la zampoña (sorte de flûte de pan originaire de la cordillère des Andes), et que nous assistions en direct à ce coup de foudre non-humain. Si les morceaux opèrent comme des dilatateurs de réalité, ils ne recourent pas pour autant à un psychédélisme éculé pour créer cette sensation. Les musiciens ne sont pas là pour nous pentatoniquer les oreilles de solos de guitare acid-rock (Manongo Mujica a pourtant fait partie du groupe de rock péruvien Los Mad’s avant de s’épanouir en solo), mais ils parviennent à établir une connexion très claire avec l’auditeur, même béotien. Plus claire que ne pourrait le faire un disque d’Ocora comme celui sur l’île de Taquile.
Mon propos n’est pas du tout de remettre en cause la démarche d’Ocora ; j’essaye surtout d’interroger la véracité d’autres démarches. Là où « l’enregistré-sur-le-vif » du label fondé par Charles Duvelle (qui n’est pas plus le réel que cette compilation) échoue parfois à combler un besoin de relief auquel nos oreilles se sont par trop habituées, la virtualité des « visions » de ces autres musiciens contemporains a quelque chose de plus vivant, ou en tout cas de vivifiant. C’est précisément ce qui me fascine dans ce disque, cette ligne de crête ambiguë entre le réel et la fiction, le fait d’envisager le terrain de l’expérimentation comme un endroit de l’ethnomusicologie – une ethnomusicologie de l’imaginaire ancré, réalisée par celles et ceux qui imaginent et créent.
Finalement, tout se passe comme si ce disque de fiction venait convoquer ce qui s’était en partie dérobé à mes oreilles au Pérou, ce pays qui m’apparaissait alors pourtant d’une manière on ne peut plus réelle. L’expérience du silence que je peux faire sur ce disque – par exemple sur « Invocación » par Manongo Mujica – vient, non pas surpasser, mais plutôt concurrencer ma précédente expérience du silence de Taquile.
Avec ces visions de l’ancestral, la question n’est plus de savoir si nous écoutons bien d’authentiques rituels, ou des reconstitutions sonores érudites plus ou moins brillantes, ou plus ou moins fumeuses. Il s’agit plutôt de comprendre comment ces enregistrements simili-authentiques réussissent à atteindre un tel degré de justesse, presque troublant ; comment ces musicien·nes péruvien·nes, qui étaient grosso modo des urbain·es éduqué·es à la modernité (si j’en crois les notes de pochette), sont parvenu·es à révéler quelque chose de ces vérités « ancestrales » qui, dans le cas du Pérou, renvoient notamment à des réalités pré-hispaniques.
Au bout du compte, en musique comme au cinéma, le réel n’a pas l’apanage du documentaire (d’ailleurs, les meilleurs documentaires sont souvent ceux qui savent interroger leur propre part de fiction). Bien évidemment, l’acte de documentation revêt sa part de beauté, qu’on parle d’une documentation personnelle (voyage touristique) ou professionnelle (recherche scientifique). Mais il faut aussi reconnaître ce que cela peut coûter en perte d’imagination, voire parfois de désillusions (de voir ou d’entendre : « Ah ben du coup c’est comme ça. Rideau. » ; qu’avons-nous vu ? entendu ?).
Ces poètes et poétesses du son ont donc appris à se faire voyant·es. Lourde tâche qu’iels complètent en partie, qui plus est en enchantant des oreilles étrangères. C’est par de tels travaux que les musicien·nes réalisent l’une de leurs fonctions, celle de révélateur·rices discret·es disposé·es à nous conduire vers le petit trou de la serrure de la porte des grands mystères esthétiques. S’ils n’ont peut-être pas la clé pour l’ouvrir, iels savent au moins voir dans le noir pour guider notre oreille vers un endroit dont nous n’avions pas connaissance, comme pour nous dire : « Écoute dans ce trou ce que je viens de voir. » D’ailleurs, cette drôle d’image sur la pochette ressemble à une serrure, même si je ne crois pas que c’en soit une. Profitez donc du cadeau qu’est cette compilation, un peu plus chère qu’une place de cinéma, mais carrément moins qu’un billet pour Lima.