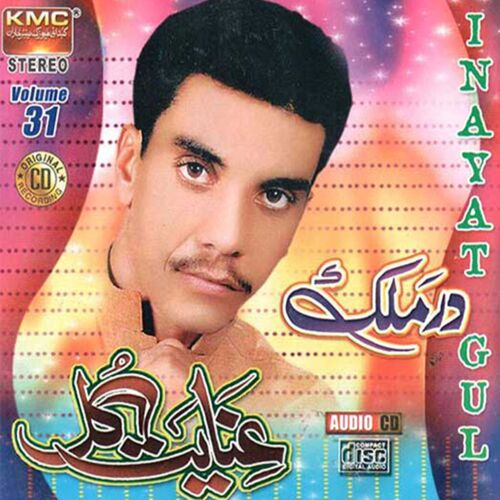Voici une très longue suite de courts morceaux, qui s’apprécient souvent mieux sans qu’on leur prête trop d’attention, écoutés à volume modéré sur des enceintes d’ordinateurs plutôt qu’en plongeant dedans au casque. Comme s’ils nous suggéraient de ne pas trop les regarder en face, de ne pas chercher à les considérer comme des pièces lisibles et affirmatives, qu’ils nous murmuraient qu’ils s’épanouiront davantage en laissant l’environnement du quotidien et ses aléas les modeler. Telles ces images du passé qui ressurgissent avec un éclat sans pareil lorsqu’on ne les convoque précisément pas, ces plages vous font basculer par surprise vers des moment autrefois vécus, des moments aux contours d’une netteté troublante, pas du tout patinés, pas du tout vintage – un espace de mémoire plein de vie et de fraîcheur, commandé par cette pulsion de la mémoire involontaire, par cette énergie de la réminiscence, ce reminiscent drive qui est le nom même du projet en question.
C’est le troisième épisode de notre série sur le musicien français Jay Alansky : après avoir parlé de son premier album, pop et chanté, sorti sous son propre nom en 1980, puis de ses récents albums électroniques composés sur iPad sous le pseudo de Bronzino, nous allons écouter son alias « ambient-pop » (terme choisi faute de mieux puisque la notion de genre est ici particulièrement hors-sujet) A Reminiscent Drive, sous lequel il avait édité chez F Communications deux albums et plusieurs EP dans les années 1990. Comme il a récemment publié plus d’une centaine de morceaux inédits d’ARD sur son Bandcamp, je lui ai posé quelques questions auxquelles il a répondu.
Replaçons déjà les choses dans leur contexte : de la fin des années 1970 au début des années 1990, Jay Alansky a passé le plus clair de son temps dans des gros studios parisiens, à la fois en tant qu’artiste solo et en tant que songwriter et producteur pour Lio, Plastic Bertrand, Jil Caplan, Les Innocents et des tas de chanteurs et chanteuses moins célèbres. Fan de Brian Wilson ou de Todd Rundgren, il s’était plongé dans les possibilités permises par les avancées technologiques de l’époque, avait pris l’habitude de bosser sur des consoles 24 et 48 pistes, et s’en était donné à cœur joie. Mais au bout de toutes ces années d’exploration en cabine, Jay finit par en avoir assez et veut se lancer dans autre chose. Déjà friand de kraut-rock ou d’early ambient, il découvre avec enthousiasme Maurizio, la deep house, Warp ou la techno de Detroit et se rend compte qu’en France émerge une vraie scène électronique. Il suspend donc sa carrière de chanteur et de songwriter-producteur pop pour se mettre à travailler chez lui en s’équipant modestement : un 8-pistes Tascam, un clavier avec expandeur, une boîte à rythmes, une guitare et une basse. Il fonctionne sans ordinateur, comme il me l’explique : « Tout est joué à la main, c’est une musique spontanée comme un geste direct, mais aussi, paradoxalement, sophistiquée, avec beaucoup de détails partout, pointilliste et complètement intérieure aussi. » C’est là que résidait la singularité de l’œuvre d’A Reminiscent Drive : une musique d’apparence machinique mais élaborée manuellement, dont les couleurs a priori associées aux sonorités trip-hop/ambient/downtempo s’en détachaient vite par leur grain lo-fi, ce son peu épais, pas du tout multicouches, et dont les atmosphères rappelaient plutôt certains essais instrumentaux de la décennie précédente, dans ses styles para-indie ou para-jazz – ça m’a fait penser de loin à Quine & Maher, à L’Ensemble rayé, à Durutti Column, à Maurice Deebank, et à d’autres occurrences de cette esthétique informelle qui n’abusait pas des grands moyens.
Cette économie de production, qu’il dit « inspirée des reduction mixes des Beatles », Jay Alansky la revendique encore aujourd’hui : « Je faisais un premier mixage que j’enregistrais sur un lecteur DAT (ça donnait un master 1) et puis je recopiais ce mix stéréo sur le huit pistes, ce qui libérait six pistes ; après je pouvais recommencer l’opération en sachant que le son se détériorait un peu à chaque fois que je revenais sur le Tascam, ce qui pouvait être très intéressant parfois d’ailleurs. En compactant les huit pistes enregistrées en seulement deux, je pouvais rajouter des trucs sur les pistes restantes, ce qui voulait aussi dire prendre des décisions artistiques drastiques tout le temps et ne pas pouvoir revenir en arrière, soit le contraire du travail sur computer où on peut tout conserver et changer à l’infini. Ces grosses restrictions techniques étaient pour moi très fructueuses et excitantes car il me fallait trouver des tricks pour arriver à ce que je voulais, des moyens de contourner ces limites. »
Alors qu’il aurait pu élargir encore le spectre des possibilités proposées par les studios hauts de gamme, chercher l’expansion, la dilatation, Jay a donc préféré rétracter les cadres de sa créativité à une époque pourtant maximaliste. Sur le premier album de A Reminiscent Drive, Mercy Street, ça a donné des choses qui rompaient non seulement avec le son électronique très propre de l’époque (et qu’on entendait beaucoup chez F Comm), mais aussi avec les formats longs de l’ambient ou de la techno d’alors : les plages tournent, comme des pop songs, autour de deux minutes trente et trois minutes. « Avant ARD, j’écrivais des chansons rock’n’roll, pop », commente Jay. « Il y avait cette notion de concision et j’ai adopté le même principe pour ARD, ce qui a plu à F Comm je crois – ceci dit, parfois j’ai regretté de ne pas avoir un peu plus fait durer les morceaux. »
Quand il qualifie de « fructueuses » et « excitantes » les contraintes techniques qu’il s’est imposées, Alansky n’exagère pas : pendant ces années passées en home-studio, il enregistrait à tour de bras, et ce qui a été retenu par le label d’Éric Morand et Laurent Garnier ne représentait qu’une petite fraction de ce qu’il leur envoyait. Ces 132 pistes restées dans ses archives depuis vingt ans, il les a redécouvertes récemment et s’est dit que ça vaudrait la peine de les publier. « En fait, en les réécoutant, je me suis aperçu que je me souvenais de très peu de morceaux. Ça a donc été comme une descente dans ma propre tête, un truc très freudo-proustien (haha), comme si je plongeais dans mon inconscient : je percevais les morceaux comme des rêves. » Jay précise au passage un détail crucial : « La démarche n’est pas nostalgique du tout, je suis dans le présent, je plonge dans le passé et je me projette vers l’avenir, tout ça en même temps : finalement ce qui me guide c’est précisément A Reminiscent Drive, une sorte d’énergie réminiscente. » À l’écoute, on perçoit de fait quelque chose d’actif et constructif ; ça démarre du passé et de l’idée de disparition, mais ça sonne comme tendu vers le présent et la réapparition.
Alansky décrit aussi sa manière de travailler comme un self-discovery process et suggère qu’il découvre des choses de lui-même en fabriquant cette musique, souvent envisagée comme un scrapbook, un collage d’éléments musicaux mais aussi de nombreux bouts de dialogues ou de discours. Ayant toujours éprouvé « la sensation de ressentir trop de choses », il conçoit sa pratique de composition et d’enregistrement comme un moyen de faire sortir ces choses de lui-même, soit de les exprimer au sens propre – et sans doute aussi de se sortir de lui-même. Un geste qu’il considère comme toujours plus ou moins inconscient, du moins illisible à l’origine, comme s’il recevait ces sons et ses mélodies d’une entité extérieure à lui-même, si l’on en croit ses dires : « À cette période je m’intéressais beaucoup à la notion de channelling dans le monde spirituel et j’ai toujours eu l’impression que la musique passait par moi, que je la captais, que je la channellais en quelque sorte. Je n’arrive jamais vraiment à me remémorer comment je travaille, c’est mystérieux, ça se déploie très organiquement. »
Sachant tout cela, j’ai écouté et réécouté Mercy Street, mais donc surtout les 132 inédits d’ARD, répartis en quatre volumes sur Bandcamp. Plusieurs choses me fascinent dans cette musique et son agencement. La première chose, c’est que c’est très rare pour moi de pouvoir rester six heures à écouter le même musicien, et a fortiori le même projet de cet artiste : normalement je me lasse, j’ai envie d’autre chose, ce qui me séduisait au départ m’écœure, bref, je m’impatiente et je passe à autre chose. Ici, pas du tout, et c’est sans doute parce que ces morceaux me séduisent moins par ce qu’ils « montrent » activement, à savoir leur couleurs et leurs formes, que par la pure sensibilité qui les nourrit en toile de fond, cet espèce de champ magnétique qui les fait résonner, qu’on dirait à l’écoute et à l’affût du temps, du sentiment même du temps.
Ces 132 morceaux se coulent merveilleusement bien les uns dans les autres et comme je le disais plus haut me semblent particulièrement s’activer en faisant un peu autre chose pendant qu’ils sont diffusés. Aucun trop-plein des émotions, des volumes à taille humaine, une cadence sans hâte qui respecte les rythmes du quotidien : on est pas loin d’une musique de soin, ou du moins de bien-être, qui ne sombrerait pas dans le niais ou le béat. Ce n’est pas de la nostalgie, pas vraiment de la mélancolie non plus, mais bien la réminiscence avec tout ce qu’elle peut avoir en elle de puissant et d’épiphanique.
On reconnaît objectivement des beats house ou jungle ici, des guitares folk ou psyché là, des atmosphères ambient ou post-punk au détour de telle ou telle compo, mais ça n’empêche que cet éclectisme de genres n’est pas central dans l’expérience ; en fait on l’oublie très vite une fois immergé dans le flux. Ce qui fait tenir ensemble cette centaine de plages c’est, paradoxalement ou non, leur aspect fragmentaire : elles passent comme des diapos, des flashes, chacune à sa façon tente de saisir ce surgissement de la mémoire involontaire, cette saillie de vécu saturé d’aura, plus exacte et plus juste que les souvenirs factuels qui résument si mal ce qui rend la vie vivable et « mémorable » au sens littéral.
C’est là que la dimension rétractée du reduction mix sert si bien le propos d’Alansky : plutôt que de se développer selon différentes dimensions audio, les morceaux sont en général obsédés par un seul motif et une seule texture. La vibration est exposée dès le début, parfois floue ou diffuse, parfois plus marquée, mais toujours plus ou moins tronquée, potentiellement arrachée à un monde plus vaste, mais porteuse de l’espoir de restituer celui-ci, ne serait-ce qu’un instant. Il m’a semblé au fil des écoutes que le déroulé des titres suivait un mouvement semblable à celui de la mémoire lorsqu’elle capte sans la demander une image très brève qu’elle essaie obstinément (et en général sans succès) de fertiliser, de faire apparaître telle une photo dans son bain révélateur.
Je me suis fait une autre remarque en me repassant ces plages, c’est qu’elles sont l’œuvre d’un musicien qui a lui-même déjà énormément enregistré de chansons dans sa carrière, qui a également beaucoup écouté la musique des autres depuis son enfance et dont la mémoire est donc forcément un peu hantée par des fantômes sonores. Cette suite de titres ressemble donc parfois à une série de field recordings de sa vie intérieure, des innombrables états de son âme. Ces motifs esseulés de piano, de guitare ou de synthé, ces voix déformées qui flottent, ces lignes de basse tantôt martiales tantôt groovy : tous ces éléments semblent eux-mêmes être les acteurs du théâtre des réminiscences de Jay Alansky.
Ces énergies venues du passé qui nourrissent le projet ARD prennent donc autant leur source dans la vie réelle (lieux, gens, images) que dans des phrases musicales éparses, lesquelles s’incorporent donc elles-mêmes au cours de la vie : d’une certaine manière, beaucoup de morceaux testent le pouvoir même de réminiscence propre à la musique, leur terrain d’expérimentation est la mémoire sonore. C’est un musicien-auditeur qui cherche à travers sa propre expérience de musicien-auditeur à réactiver la vie d’une sensation passée, une sensation dont il n’avait pas forcément conscience en la vivant mais qu’il met dans la lumière grâce à la musique. Ce ne sont pas des remakes de chansons qui l’auraient marqué dans le passé et qu’il voudrait ressusciter aujourd’hui, mais des sensations fugaces mêlées de bribes de musique qu’il essaie d’articuler, alors qu’elles n’ont donc jamais existé sous cette forme combinée – ce qui laisse presque entendre que le réel, éprouvé tel quel, qui fournit l’apparente matière première de la réminiscence, n’est sans doute que le début du processus de la révélation, lequel n’a pas pour vocation à faire littéralement revivre le moment originel brut, mais plutôt à éclairer l’obscur chemin qui nous sépare de lui.
Ces fragments qu’on entend tout au long des 132 titres s’apparentent parfois à des fétiches qu’Alansky active (ou secoue, frotte, malaxe) par l’enregistrement et par son procédé de réduction – on pourrait faire une métaphore culinaire et dire qu’il fait réduire la matière des souvenirs diffus, ou aussi bien suggérer une métaphore plus chimique en évoquant l’idée de « précipité », car tous ces inédits cherchent bien à précipiter, de manière certes sereine voire carrément zen, les composants du souvenir pour aboutir au flash ultime – au temps retrouvé.
Je me permets de supposer tout ça parce qu’en discutant avec Jay Alansky j’ai pu me rendre compte qu’il était toujours un auditeur avide de nouveaux disques et de nouvelles formes. On sent que sa quête musicale du bonheur esthétique ne cessera jamais, qu’il a comme toutes et tous les mélomanes dignes de ce nom un rapport fétichiste non pas à l’objet-disque, mais à l’illusion de perfection et de joie inaltérée qu’on éprouve en découvrant ou redécouvrant un beau morceau. Cette course sans fin vers un au-delà du fétiche sonore, il la mène en sachant qu’elle ne s’achèvera jamais par une chanson ou un album qui condensera tout ce qui nous attire dans la pop, et qu’elle nous emmènera toujours vers de nouvelles déclinaisons du même désir intransitif, du même hologramme de finitude. En sortant aujourd’hui ces 132 essais intuitifs à l’extrême, qui cherchent tout le contraire de la perfection, Jay invente en creux l’idée d’une pop imparfaite, dénuée de périmètre strict, sans chant pour la guider. Non pas une méta-musique, mais musique de la musique, en quelque sorte, qui s’attelle, au contraire des tubes qu’il a jadis écrits, à restituer comme elle veut et comme elle peut l’enchantement archaïque de la musique enregistrée.
![Musique Journal - A Reminiscent Drive ou le field recording de la vie intérieure [Jay Alansky, épisode 3]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2023/04/musique-journal-cover-one-1024x1024.jpeg)
![Musique Journal - A Reminiscent Drive ou le field recording de la vie intérieure [Jay Alansky, épisode 3]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2023/04/musique-journal-cover-two-1024x1024.jpg)
![Musique Journal - A Reminiscent Drive ou le field recording de la vie intérieure [Jay Alansky, épisode 3]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2023/04/musique-journal-cover-three-1024x1024.jpg)
![Musique Journal - A Reminiscent Drive ou le field recording de la vie intérieure [Jay Alansky, épisode 3]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2023/04/musique-journal-cover-four-1024x1024.jpg)