Jusqu’au début de cette année, je n’avais jamais entendu parler de Tom Wilson, producteur, manager et directeur artistique afro-américain né en 1931 et mort à 47 ans d’un arrêt cardiaque au terme d’une carrière très riche, mais très méconnue malgré l’importance et la singularité de ses accomplissements.
Tom Wilson naît au Texas, État encore ségrégué à l’époque où il y grandit, puis fait ses études à Harvard, université qui certes acceptait les étudiants noirs mais qui en comptait alors, au milieu des années 1950, moins d’un pour cent sur son effectif total. Fan de jazz, il lance une fois diplômé son propre label, Transition, qui édite des albums de Sun Ra, Cecil Taylor, Donald Byrd ou Paul Chambers. Brillant dans son travail, il est recruté en tant qu’A&R chez United Artists, qu’il quitte peu après pour aller chez Savoy, puis rejoint Columbia en 1963. C’est là que son parcours va prendre un sacré tournant, hors du jazz.
À l’époque, l’une des principales signatures du label est Bob Dylan, qui doit finir l’album The Freewheelin Bob Dylan mais qui ne s’entend plus avec son producteur John Hammond. Tom Wilson se retrouve donc à devoir gérer les sessions studio de celui qui est en train de basculer de la folk acoustique au folk-rock électrique et se découvre une vraie complicité avec lui, au point de produire ses trois albums suivants, ainsi que son tube « Like A Rolling Stone » sur Highway 61 Revisited.
Durant ces mêmes années, le producteur entend se produire dans un club de Greenwich Village un duo folk appelé Kane & Garr auquel il propose d’enregistrer un album en utilisant leurs vrais noms, Paul Simon et Art Garfunkel. Le disque sort milieu 1964 sur Columbia mais ne marche pas si bien que ça, jusqu’à ce que plusieurs mois plus tard (l’histoire est connue des aficionados du tandem) des programmateurs de radios étudiantes de Floride se mettent à jouer « The Sound of Silence » et fassent de la chanson, dans une version minimale à deux voix et une guitare acoustique, un mini-tube sur quelques campus beatniks de la péninsule. Wilson s’en aperçoit et, dans l’idée de toucher les grosses stations nationales, décide sans prévenir Simon & Garfunkel (qui se sont séparés à la suite du flop de leur LP) de faire faire un overdub de l’enregistrement de départ afin de donner plus de matière à l’ensemble : sont ainsi ajoutés une guitare électrique, une basse, une batterie, et beaucoup d’écho. C’est une méthode qu’il avait déjà employée avec Dylan sur Bringing All Back Home, et d’ailleurs il reprend les mêmes musiciens pour gonfler la chanson du binôme new-yorkais. Le single ressort dans cette version ni plus ni moins remixée et devient l’énorme carton que l’on sait, imposant à ses auteurs de se reformer et accessoirement de devenir des hérauts du mouvement hippie.
Surfant sur ce succès, en 1966 Tom Wilson change une fois encore d’employeur en rejoignant les rangs de Verve, label jazz racheté quelques années plus tôt par la MGM, où l’expérience de ses premières années va se combiner à son talent pour traiter avec les artistes rock que la maison aimerait désormais travailler. Pas n’importe quels artistes, en l’occurrence, puisqu’il va produire entre autres (attention je vous préviens ça envoie) Freak Out et Absolutely Free de Frank Zappa & The Mothers of Invention, Soft Machine de Soft Machine, plusieurs albums de Hugh Masekela, de Dion, ainsi que des Animals et d’Eric Burdon, et puis ni plus ni moins que les deux premiers disques du Velvet, sans oublier Chelsea Girl de Nico. Le mec n’a pas chômé, on peut le dire, et les quelques articles que l’on trouve à son sujet (sur ce site très bien fait quoique rudimentaire) ont l’air de dire que Tom était aussi fort en studio qu’en business et en relations humaines.
Et c’est donc tout naturellement que Wilson décide début 1968 de se mettre de nouveau à son propre compte en montant sa structure, la Tom Wilson Organization, qui va s’occuper à la fois d’enregistrer et de manager de jeunes groupes. Le désormais trentenaire a raison d’avoir confiance en lui, mais les choses ne vont hélas pas tourner comme il l’entend. Parmi la douzaine d’artistes qu’il développe, un seul se fait vraiment remarquer à l’époque, Fraternity of Man, dont le morceau « Don’t Bogart That Joint » figure sur la B.O. d’Easy Rider. Mais rien de plus rentable ni de plus célèbre ne sortira de cette expérience.
Ce n’est évidemment pas une raison pour se dispenser d’écouter les nombreux disques que Tom Wilson a enregistrés entre la fin des sixties et le début des seventies : pas mal de choses typiques de ces années, du folk, du psyché, du blues-rock, et aussi du rythm’n’blues, en général joué par des blancs. Le disque à mon sens le plus marquant de cette période, c’est Detroit 1984, signé par un groupe dont on ne sait rien, Albino Gorilla. Un album dense et théâtral qui consiste en une série de reprises psyché de standards Motown, sans doute un projet piloté de A à Z par Wilson, façon démiurge.
Dans les dernières années de sa vie, le producteur collaborera avec des artistes afro-américains comme Gil-Scott Heron ou Professor Longhair, pianiste et chanteur blues emblématique de la Nouvelle Orléans. On apprend surtout, en lisant les articles archivés sur le site, qu’il avait commencé à composer, aux côtés de son confrère arrangeur Larry Fallon, une sorte d’opéra soul intitulé Mind Flyers of Gondwana, consacré à l’idée de l’Atlantide noire et au destin des esclaves africains ayant vécu le Middle Passage. Il est dit qu’étaient pressentis au chant Gladys Knight, Minnie Riperton, Gil Scott Heron, Labelle, et même Bob Marley. Pour l’adaptation au cinéma, Fallon et Wilson songeaient à demander à Stanley Kubrick. Ça aurait sans doute été beau et on peut fantasmer fort là-dessus.
C’est bien triste que ce producteur touché par la grâce soit mort si jeune et c’est aussi bien triste de constater qu’il n’a pas confirmé les énormes succès de ses débuts sur le marché de la pop et du rock. Surtout que bon nombre de morceaux que j’ai choisi de vous faire écouter dans cette playlist sont très excitants. Ce qui est tout aussi triste, mais qui peut sans doute s’arranger si on s’active un peu, c’est de voir que la mémoire de ce producteur majeur des sixties n’a pas été tellement entretenue. Du premier Velvet, l’histoire a retenu le nom de Warhol même si on sait bien que ce gros malin ne touchait pas une bille en studio ; heureusement, John Cale et Lou Reed ont affirmé en interview que Tom Wilson avait entièrement dirigé les sessions. De son côté, Dylan a dit en 2017 que Tom lui avait montré la voie en recrutant sur The Freewheelin des musiciens très en phase avec lui, comme le batteur Bobby Gregg et le pianiste Paul Griffin (qui jouerait quinze ans plus tard avec Steely Dan), alors qu’il s’était jusqu’alors heurté à pas mal de session men bas-du-front.
Peut-être que le fait d’avoir été un producteur noir qui s’est fait un nom en produisant de la musique faite par des Blancs ne l’a pas forcément aidé. Peut-être que Wilson est mort à un moment où il n’avait pas fait de hit depuis longtemps, qui plus est à une période où son background jazz puis psyché n’intéressait plus trop les modes musicales, qu’elles soient disco, new-wave ou hip-hop. Peut-être que son nom trop banal a généré une confusion avec Tom Moulton ou Tony Wilson. Mais quand même, il n’empêche que la fièvre archiviste de ces dernières décennies a parfois exhumé des gens aux parcours nettement plus obscurs que le sien. Et puis sa façon d’avoir accompagné à la fois des rockers et des gens versés dans le groove aurait dû marquer les esprits. En fin de compte on ne sait pas bien ce qui s’est passé, et il nous reste juste à donner de l’exposition de nouveau à ce producteur crucial mais invisibilisé.
La playlist réunit des morceaux qui oscillent entre le son heavy psych caractéristique de cette ère (celui des groupes Fear Itself, Click, Ill Wind, Fraternity of Man et Road, dont faisait partie le bassiste de Jimi Hendrix) et une esthétique plus afro-américaine (avec Gotham, Earthquire, Albino Gorilla, Vernon Burch et Professor Longhair). Les diggers reconnaitront aussi la voix du mystérieux Japonais Harumi, dont l’album est un petit graal pour certains. Il y a une curiosité aussi, plus ancienne : un bout de B.O. (ou de musique inspirée par ?) d’un épisode de Batman & Robin, où l’orgue est joué par Sun Ra.
Je vous invite avec insistance à parcourir les textes mis en ligne sur producertomwilson.com, notamment cette superbe cover-story réalisé par le New York Times Magazine (dont il avait fait la couv, au passage) au moment où Tom lançait sa propre agence de groupes. Bonne lecture et bonne écoute !
PS : pour celles et ceux qui veulent creuser encore plus profond, voici les liens d’albums complets de certains des artistes du giron de Wilson :



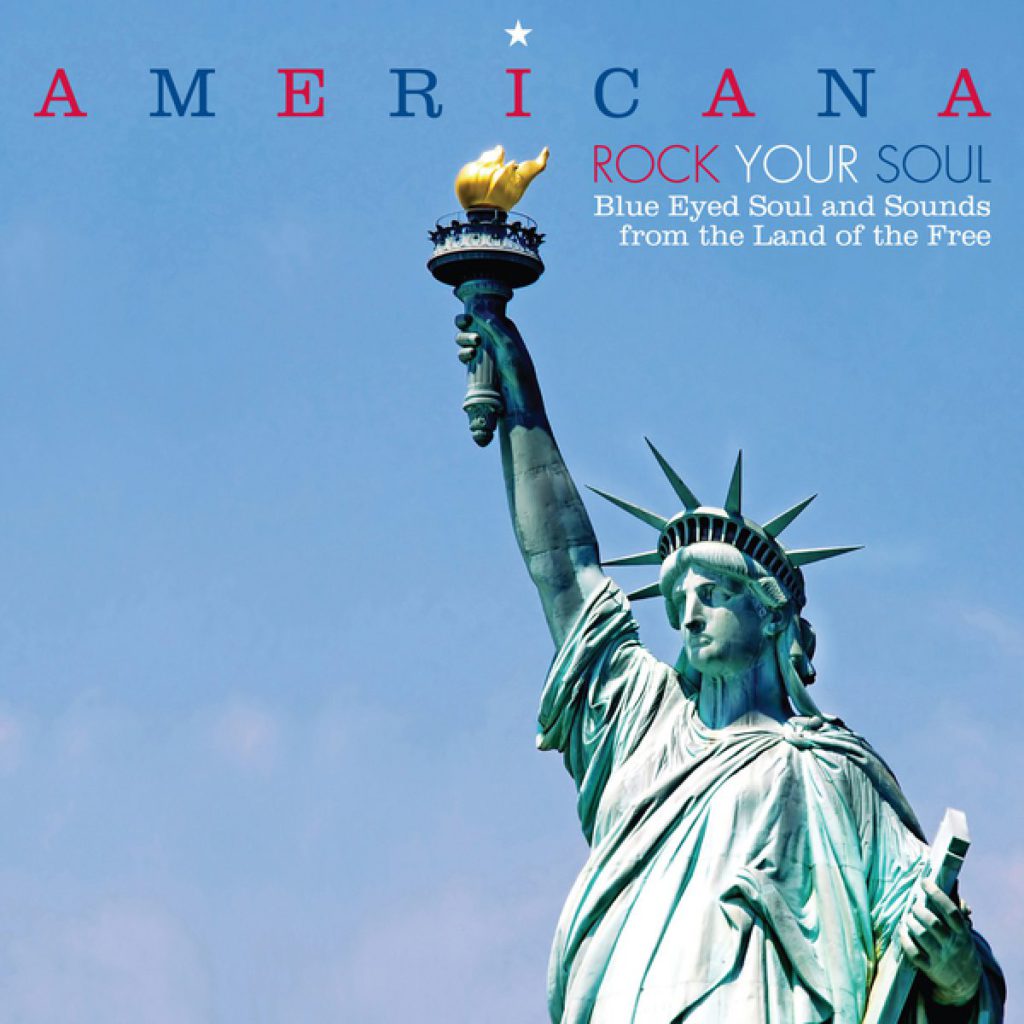

Un commentaire
C’est vrai que c’est incompréhensible qu’il ai été ainsi invisibilisé. Son opéra sur l’Atlantide noire ne peut que faire penser à l’imaginaire développé par Drexciya 20 ans plus tard.