Par je ne sais quel sortilège, une vieille et vague connaissance est passée faire un coucou la semaine dernière. Et pas un petit coucou cordial, du genre porte entrouverte, « on ne va pas s’attarder mais on pensait justement à toi, avec la petite famille », non. On est plutôt sur une visite carrément inattendue, avec option pied dans la porte et sourire ambigu, boucan et débordements inclus. Un invité impromptu, qui n’a jamais eu le temps pour les formalités, que ce soit il y a quinze ans ou aujourd’hui… Et le nom de cet invité, c’est : le logobi.
Pour celles et ceux ne sachant pas de quoi il retourne ici, et pourquoi tant de cérémonial : inventé selon la légende par le bandit ivoirien Sahiri Gnédré Lazare dit John Pololo au mi-temps des années 1980, le logobi est une version loubarde (loin de moi l’idée de faire l’ancien mais les gangsters du cru se catégorisent ainsi) du coupé-décalé où, dans des enchaînements techniques, les danseurs racontent leur méfaits, les miment et se glorifient avec virtuosité. Pourtant, ce n’est pas au logobi abidjanais originel, celui des mastards squattant les haltères, que je me suis trouvé confronté au lycée, mais à son actualisation très libre – laquelle me laissa alors, il faut l’avouer, plus que perplexe.
Avant que ne se clôture la première décennie du nouveau millénaire, le parvis de l’établissement secondaire Christophe Colomb de Sucy-en-Brie était en effet le théâtre d’un bien étrange ballet. La fameuse tecktonik se trouve alors à l’apex de sa puissance, et cette ville au bout du RER A n’est pas épargnée, sans pour autant se trouver submergée. Si certaines figures du quartier se sont laissées séduire par ce package danse/musique/coiffure/accoutrement, il faut avouer que la plupart des adeptes de l’urbanité restent à première vue hermétiques voir hostiles à la tendance, tout comme les rockeur·euses et les babloches, d’ailleurs. Nous avons toustes beau lui avoir craché dessus sans vergogne, il est pourtant indéniable que la tecktonik fut un choc esthétique qui déblaya tout sur son passage. Les vêtements se sont rapprochés du corps, les coiffures se sont structurées ; la danse redevient une possibilité pour les gadjos en place, les sonorités électroniques outrancières s’infiltrent partout.
Dans cette agonie de la tecktonik, aux alentours de 2009, il est clair qu’un paradigme nouveau a émergé. L’anthem de Costuleta, « Tchiriri », a tout cassé un an plus tôt : la proximité avec le kuduro est indéniable, et les agité·es sont prêt·es pour le logobi nouvelle génération. Les inquisiteur·ices appliqué·es se trémoussent maintenant sur des instrus toutes aussi pompières et compressées, alignant les gestes de bras cryptiques et rapides, les genoux frémissant et fléchis vers l’intérieur, le sexe ou la cage thoracique comme centre de gravité, au choix. Même si certain·es sont passé·es d’une danse à l’autre, la tecktonik et le logobi ne rassemblaient pas vraiment les mêmes audiences. La première était surtout « un truc de blancs » – effectivement, même si cela est beaucoup plus nuancé dans les faits, je ne vois pas comment mieux caractériser ce mélange de jumpstyle, de house et d’electroclash, désolé –, alors que le logobi a en grande majorité été adopté par des jeunes issu·es de l’immigration, et surtout celleux ayant des origines en Afrique subsaharienne. Le succès dépasse la seule communauté ivoirienne et les Congolais·es notamment se font pratiquant·es exalté·es, confirmant ce qui était déjà évident : toutes les personnes stylées dansent le logobi. Les seules têtes blondes sont ici celles, décolorées, de mes élégant·es zazas.
Passage de décennie. La banlieue sud de Paris, et notamment le Val-de-Marne, est un épicentre du phénomène. Autour de nous, les adeptes s’agitent déjà depuis plusieurs années en secret quand s’abat l’effroyable courroux du « Logobitombo » et des tubes douteux de Logobi GT – originaires de Champigny-sur-Marne. Ces vulgarisations pour les masses d’un arcane ésotérique, nous laissent de marbre, moi et mes ami·e·s baby rockeur·euses indés à tendance fluokids ignares. Il n’empêche que les loustics, hier impassibles et inamovibles, se la donnent à fond, en mode offensif·ves et soigné·es. À l’époque, le nec plus ultra est chic, street et ergonomique : sacoche Louis Vuitton du marché, jean GStar, sweat American Apparel, casquette Nike et sneakers Superdry lacées lâchement.
Le logobi, avec sa réputation sulfureuse, se trouve donc électroniquement transfiguré. Des jeunes s’unissent autour d’un même amour de la danse, les équipes se multiplient et s’agrègent selon des affinités qui se croisent – une même aire culturelle, un même continent ou un même pays d’origine, un même classe sociale, un même quartier, une même couleur de peau, un même groupe de potes… Pour l’œil extérieur (souvent blanc), il y a transformation, aussi : l’ethos du Maghreb n’est plus le seul permettant d’obtenir ses gallons de la street. Lae français·e afrodescendant·e, jeune, noir·e (et donc dangereux·se), s’affirme et s’affiche, avec son monde et sa génération, s’extirpe dans le même temps des girons états-uniens et caribéens. Pas de rap ou de reggae ici, la revendication principale est celle de l’expérience jouissive d’un corps apprivoisé, en même temps que l’espace.
Étrangement, je n’ai presque aucun souvenir de ce sur quoi les danseur·euses s’affairaient. Dans mon esprit, le son du logobi, cela se résumait à l’impossible tube de Moussier Tombola précédemment cité. Pourtant des ami·e·s dansaient, blastant à fond des tournes sur-compressées sur leur portable. Rien ne me reste de celles-ci. Comme si la partie musicale du logobi avait glissé sur ma conscience, mirage insaisissable, béance étrange. Sûrement n’étais-je tout simplement pas prêt, ni assez ouvert pour comprendre ou apprécier cette musique pour elle même, sans la danser. Et il faut avouer que la place périphérique laissée aux producteur·ices, ce qui est une situation plutôt commune avec les musiques de danse, n’aide pas à forcément garder en mémoire : le but, c’est surtout de contenter ces danseur·euses qui feront jouer à l’infini les sons sur leur portable, si ceux-ci leur conviennent. Et aujourd’hui, des figures de Snapchat ou Tiktok agissent aussi en tant que prescriptrices, orientant l’air de rien leurs audiences vers les morceaux les plus bouillants en les utilisant comme habillages sonores – comme Zepeck, ce pitre qui a dû faire se pisser dessus plus d’un prof.
C’est en tombant sur un batch d’instrumentaux démoniaques réalisés entre 2020-2021 (l’engouement pour cette forme connaît des hauts et des bas ; on est plutôt dans le creux de la vague là, mais elle conserve une place dans l’imaginaire de plusieurs générations, sans être devenue ringarde), tous dédiés à des personnages de l’univers Mario et composés par un certain Benben93 que tout a enfin fait sens. Le logobi nouveau est notre juke, notre kuduro, notre hardcore. Tout cela à la fois. Une forme musico-chorégraphique électronique combative et festive, fruit d’un vécu diasporique à la fois fantasmé et bien réel, d’une histoire où les bas-fonds d’Abidjan dialoguent avec le Métropolis de Rungis. Je sais que comparer ne sert pas à grand-chose mais tout de même, ça me réconforte pas mal de pouvoir aligner ces deux espace-temps dans la même phrase !
Ces morceaux courts m’en ont aussi appris un peu plus sur le pourquoi mon amnésie : si je n’ai pu garder un souvenir marquant de ces tracks, c’est que bien qu’ils cherchent à tous se démarquer, ils restent tout de même tous très similaires. Obstinés, enlevés, jonchés de quelques breaks et d’une foule de bruitages inattendus, ils se consolident autour de cette clave caractéristique, le plus souvent jouée au charley, de kicks qui écrasent le temps et la matière, de synthés hypnotiques qui parlent du futur.
Dans la playlist, en plus des quatre morceaux ambiance Nintendo, je vous ai mis ce clip du groupe de logobi VLT NGT-4, où les images rivalisent de classe avec le son. C’est un peu artisanal, ça devait saisir la rétine à l’époque, puis ça a dû paraître rincé pendant une bonne dizaine d’années et maintenant, je trouve qu’il y a un retour en grâce, l’œuvre s’est bonifiée. Tout le monde est bien apprêté et bien à fond, la caméra qui ne cesse de bouger et le détourage, les synthés, les bruits de flingue et les détonations… Mathias vous parlait récemment d’indie sleaze, je sais pas si j’ai complètement compris l’histoire mais il y a quelque chose d’un peu similaire qui se joue là dedans à mon sens, sans que j’arrive vraiment à mettre le doigt dessus. Enfin, les dernières composantes de ce cadeau empoisonné pour vos pieds, signés par un certain Zoopal City (ou Moncef Abdel-kader ?), pas bien vieux à l’époque de l’upload il me semble, il y a dix ou quinze ans, illustre une autre problématique de cette musique : on ne sait jamais bien qui est l’auteur, à quel point le sampling n’en devient pas du plagiat, si les edits sont simplement des assemblages à la truelle ou le boulot d’un petit prince de Fruity Loops. Milieu de truand, on vous dit ! En tout cas, je vous laisse juger sur pièce et partir en twist sur, au choix : le carrément incendiaire « Logobie instru Mafia VLT », le très trance « Logobie instru Fou-fou » ou le carrément UK hardcore « Logobi Zoko one », mon préféré.
J’espère en tout cas n’avoir pas trop dit de bêtises, et j’attends de pied ferme les commentaires des professionnel·les outré·es ! Novice du logobi l’ayant pourtant pas mal fréquenté malgré moi, c’est avec plaisir que je vous livre donc ces souvenirs, traces d’une époque lointaine où, dans mon Val-de-Marne, je me frottais pour la première fois à une altérité qui parlait de moi, sans que je ne la comprenne vraiment, alors entièrement couvert d’un masque blanc démesuré et assez peu saillant. Et sinon les collègues m’ont également partagé cette compile, sortie au cœur même de la vague logobi, en 2011, sur le label de Jess & Crabbe ! Délire !




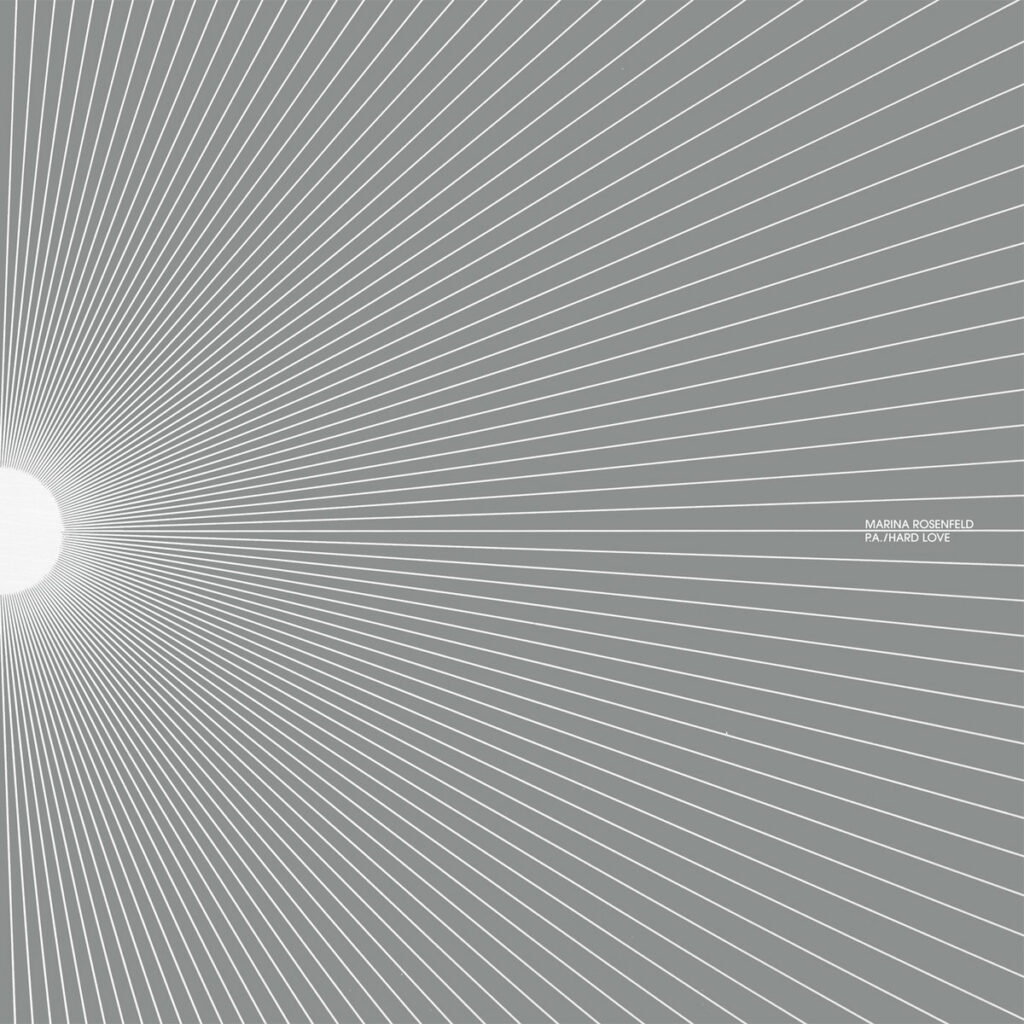
2 commentaires
Parmi les nostalgiques du Logobi, il y a DJ Rikka du label Delusion, qui propose une version trance maximale du Gater Le Koin de Logobi GT, ça se trouve sur Bandcamp bien sur, sous le nom de GLK Trancenation Pulse
Salut David, merci pour le tuyau !
Je l’ai trouvé sur soundcloud perso,
https://soundcloud.com/itmightberikka/glk-for-trancenation
évidemment, le mélange épicé et subversif est totalement validé