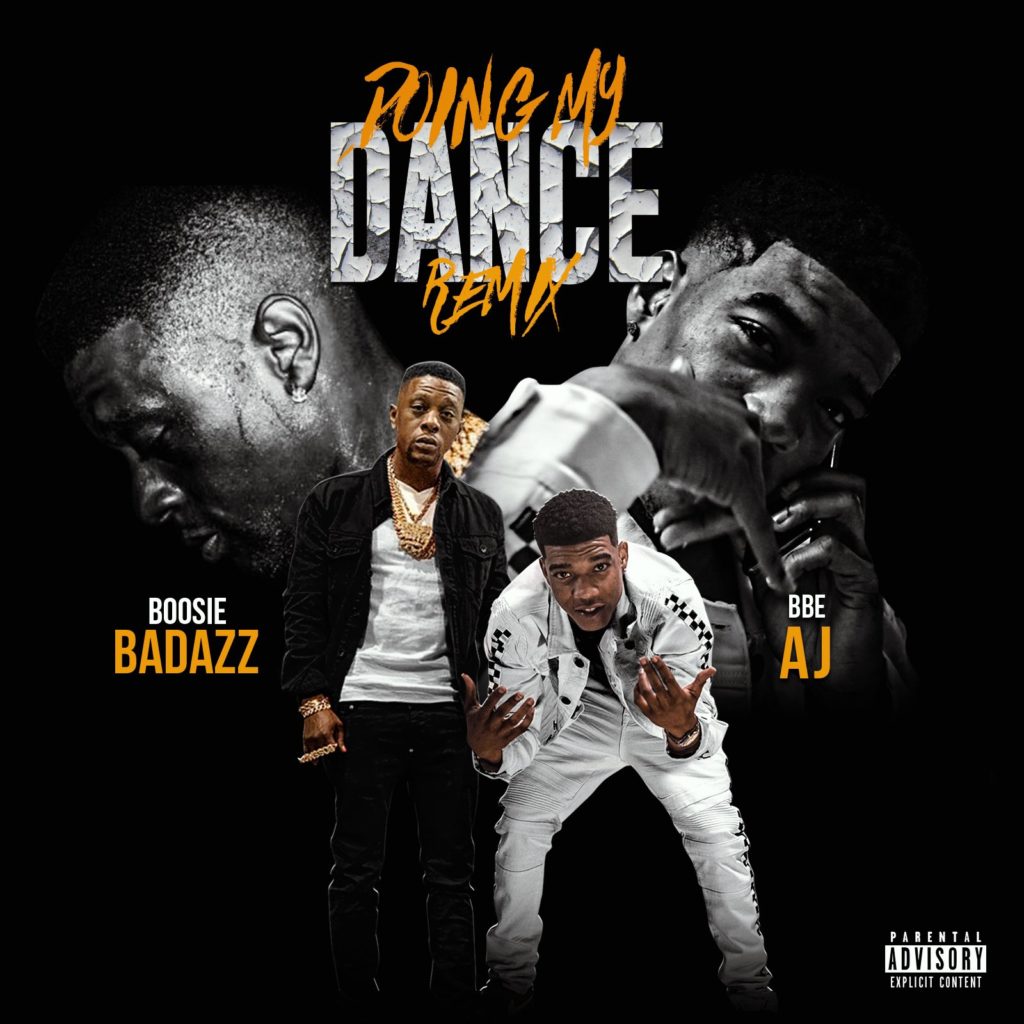Yé, coucou, salut, bonne année, la santé et les louanges de rigueur, j’espère que vous vous êtes toustes bien reposé·es ! Chez MJ ça nous a fait du bien cette petite mise en retrait, enfin je parle pour moi en tout cas, je me sens dans une belle présence et prêt à repartir dans le tunnel sans lâcher la complexité. Et si on peut mettre un peu la marchandise à distance (ce qui ne vous dispense pas de vous abonner hein) et appréhender le musical comme, au risque de passer pour un holiste de bas étage, une pratique commune à notre espèce nous liant par les viscères, je serais vraiment refait. 2024 fut rude, pour ce qui arrive on verra comment se passent les choses. L’espérance est permise mais ça reste compliqué de slalomer, restons lucides. Pour me donner un peu de courage dans cette lutte existentielle qu’est la vie, je vais donc commencer l’année comme je l’ai fini, par un air de ma très chère île dont je sais si peu et vers laquelle je reste irrésistiblement attiré. Là encore, viscéralement.
Nous sommes en 2025, et cela m’a frappé : la dernière fois que je suis rendu en Guadeloupe, en chair et en os, c’était il y a vingt ans. Pourtant j’en parle comme si c’était hier, sur Musique Journal ou à mes ami·es, je donne des conseils aux voyageur·euses mais le fait est que je ne connais plus du tout cette terre. Comme le retour se fait pressant, à chaque nouveau décès d’un·e proche qui l’est surtout par les liens du sang et que je n’aurais pas pu (re)voir avant le trépas, il s’alourdit, aussi. Ma mère entretient un lien complexe avec sa famille et donc avec cette île où elle a tout de même vécu. Cela se transmet, se perpétue, se complexifie et s’étiole ; plus que restaurer ou créer un lien, il faut en fait le reconnaître déjà, puis le sentir, le légitimer. Car même si je l’ai longtemps ignoré, honteux de ne pas appartenir et de délaisser, je suis une cellule de l’hydre diasporique caribéenne. Et pour cela, qu’importe la difficulté, la musique est une bonne amorce.
En 2002, Kadans a péyi-la, le premier album du groupe Soft, sort une première fois, mais sans succès notable. Trois ans plus tard, il ressort et là, en Grande-Terre comme en Basse-Terre, l’hégémonie est totale. Alors que je suis en vacances, impossible de passer à côté, les morceaux passent à la radio, il y a des publicités dans les supermarchés (pensée pour le Cora de Baie-Mahault). Mon père a évidemment acheté le CD : dans la voiture de location puis à la maison quand nous rentrons en métropole, ces chansons dont le succès a dépassé les seules Antilles françaises m’accompagnent. Elles deviennent l’incarnation du « péyi », sa dernière actualisation. Et comme souvent avec les musiques guadeloupéennes, j’ai un doute, ou plutôt une incompréhension esthétique fondamentale, que traduisent tout aussi souvent les visuels. Même si aujourd’hui je ne peux pas m’empêcher de lui trouver un certain charme, la pochette de cet album me laissait totalement perplexe, si ce n’est carrément outré. Avec ces morceaux, c’est pareil. Je ne sais pas trop où me situer, c’est quand même fort en fructose, je suis attiré comme un colibri, profondément touché alors que je ne saisis que des bribes de sens. Ça semble facile et se donne de la même façon, c’est beau mais un peu pompier. Comme dit le poète, c’est trop : excès de suavité, de rondeur des sons, des sentiments mis en branle. Trop de tout, et ce qui contenu suinte.
Pourtant, cette flamboyance smooth n’est pas qu’une vitrine vide. C’était justement cela qui m’attirait à l’époque sans que je ne puisse le formaliser : cette façon d’être entier dans sa sensualité, de ne plus être l’autre. D’être juste entier, peut-être. Le tube de l’album qui tournait à bloc, « Krim kont la Gwadloup », me laissait déjà entrevoir le potentiel révolutionnaire du style créole et jazzy cher à Soft. À l’époque, la chanson me semblait taillée pour les centres commerciaux, dans le mauvais sens du terme. Aujourd’hui, je comprend que c’est ce pouvoir de dissémination et de réappropriation à sens unique qui fait sa force. Fred Deshayes, chanteur-guitariste de facto leader du groupe (et accessoirement maître de conférences en droit public à l’Université de Pointe-à-Pitre, comme quoi), même s’il n’est pas Gramsci, n’en reste pas moins engagé avec une certaine fougue ; et si la grande distribution l’a adopté, lui n’a jamais cédé, imposant son rythme, fidèle à son idéal d’indépendance. Parce qu’il en appelle aux sentiments, son organe est le compagnon rêvé d’un soulèvement. La brillance de sa voix agile attrape, ses inflexions douces-amères transmettent les textes tranchants. Il n’y aurait presque pas besoin de traduction.
Pourtant, c’est une autre chanson qui m’accompagne depuis, « Kadans a péyi la » (la cadence du pays, en français), un slow mélancolique et sophistiqué, sorte de lamentation sombre et doublée d’une affirmation identitaire véhémente. Cette ambivalence toute caribéenne entre douceur lustrée too much et douleur essentielle, se trouve parfaitement incarnée dans ce morceau.
Les paroles, traduites par l’auteur lui-même et disponibles sur son site perso, permettent de saisir le caractère ontologique de ce désespoir révolté, mais aussi de faire le lien entre ce que dit Fred Deshayes et la manière dont il le chante. Le vocaliste ne dit rien d’incroyable, mais sa façon d’ourler sa prose, d’induire plutôt que dire, et surtout de sinuer en touchant sweet spot après sweet spot dans une structure harmonique identifiée et implacable, donne un élan fou, qui nous porte au seuil d’un potentiel insurrectionnel inassouvi – comme tant d’autres chansons du capitalisme aural : tout de suite je pense à « All Along the Watchtower » ou à « Jeune et con » par exemple (on je juge pas, merci !). Quand il enchaîne par exemple, soutenu par les chœurs de ses collègues :
« Soufwans a péyi-la
Sé li ka chayé mwen
Sé sa ka brilé mwen
Sé li k’ay menné nou pli wo, pli wo »
La souffrance du pays
C’est ce qui m’entraîne
C’est ce qui me brûle
C’est ce qui nous portera plus haut, plus haut
Je trouve ça simplement parfait, sur tous les plans. Je suis pris, un souffle m’entraîne, je suis prêt à transpercer ma condition, je vois la lumière ! Dans la langue secrète, c’est la crue vérité du colonialisme qui est montrée aux peuples lui étant soumis, de Gourbeyre à Ménilmontant :
« Yo enmé nati-la
Yo pa enmé pèp-la
An vérité yo pa’a santi kadans a péyi-la »
Ils aiment le paysage
Mais ils n’aiment pas le peuple
En vérité ils ne sentent pas la cadence du pays
Le jeu tout en retenue de Philippe Sadikalay, Didier Juste, Joël Larochelle et Fred Deshayes participe bien évidemment de cette délicatesse radicale. La guitare acoustique et la basse sont un même corps ; le ka est joué du bout des doigts et tisse avec le bouladjel, dans le calme. Ailleurs, le son des vagues serait juste d’un kitsch impossible mais ici, il sonne juste, logique. Il n’y a pas de place pour le second degré et la dérision, ça vibre à 200% avec la réalité. Comme ce nom grandiloquent, tellement abusé et générique qu’il me laissait présager le pire, pauvre de moi, qui avait oublié que rien n’est plus radieux et brillant qu’un·e Antillais·e qui se décide enfin à partager ce qui se loge en son for intérieur.