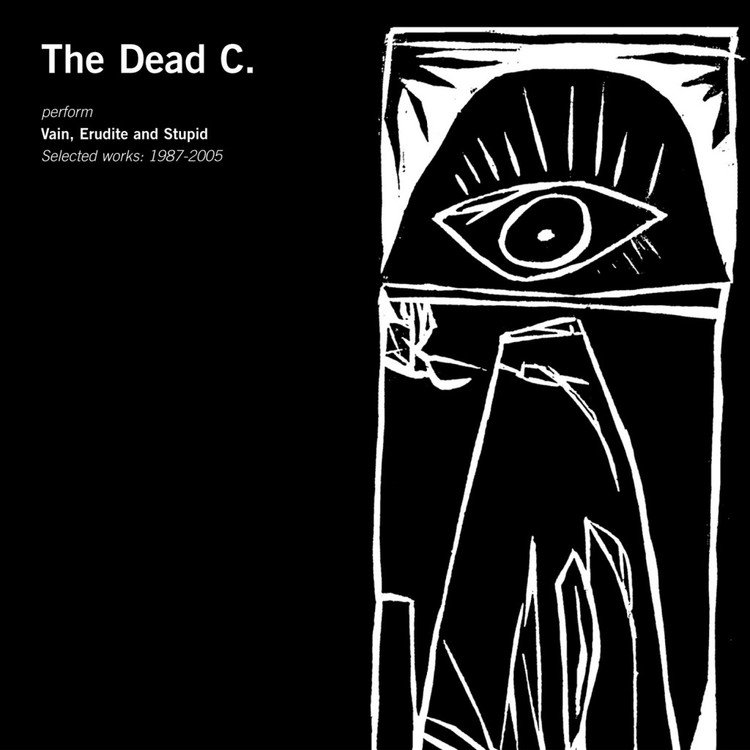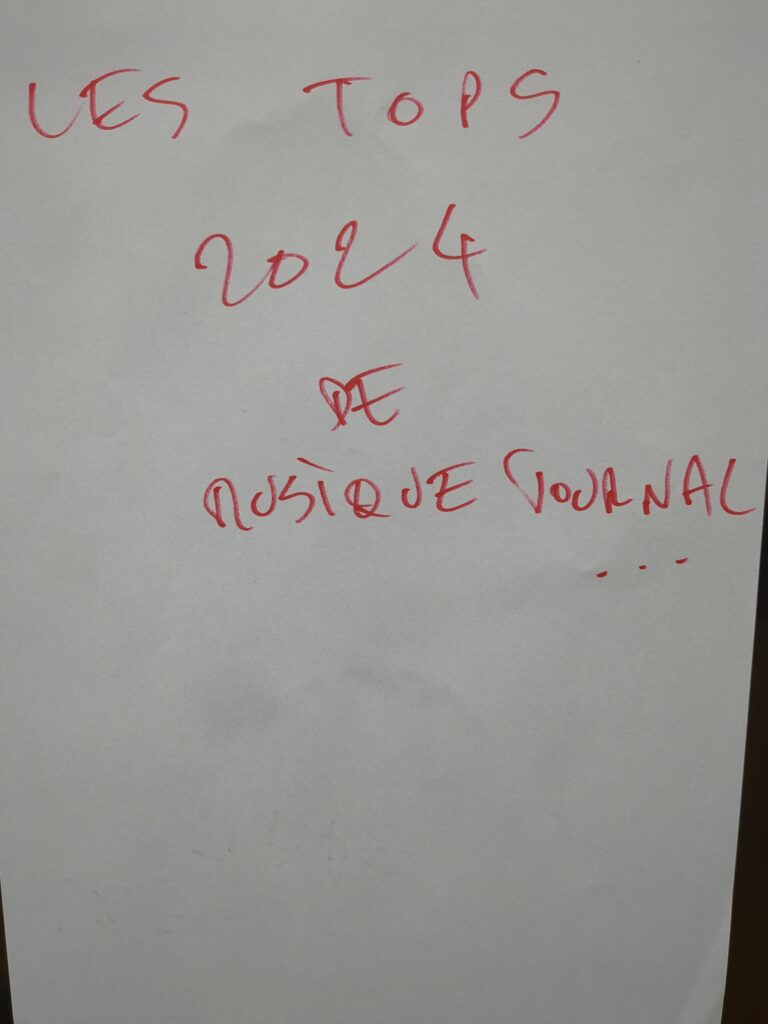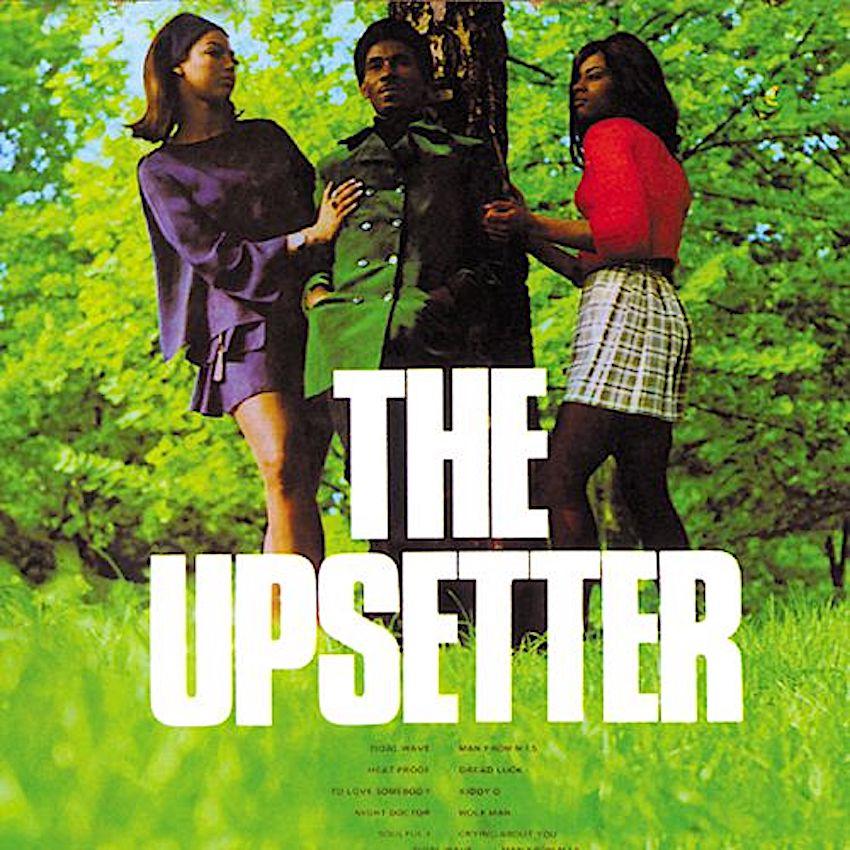Mathias parlait l’autre jour de grindcore et j’ai eu envie de théoriser un peu, et librement, sur un des ancêtres du grind : le punk hardcore. De théoriser plus précisément sur ce qui me semble être le caractère hyper théorique du punk hardcore. Je me rappelle avoir écouté Complete Discography de Minor Threat quand j’avais treize ou quatorze ans et avoir déjà trouvé ça limite abstrait. Je sentais bien la rage sans but et les émotions fortes, ça me parlait, mais par rapport au punk des Ramones ou des Sex Pistols, ça me donnait l’impression d’aller trop vite pour qu’on puisse continuer à parler de chansons et à parler d’expression, et à ressentir quelque chose d’un minimum mémorable. Comme si le projet visait à démonter l’idée même de compromis qui définit la marchandise pop : affirmer sa ou ses singularités, mais dans un cadre déjà connu. Là, en enchaînant les déflagrations d’une minute sur les vertus de la vie straight edge et la culpabilité d’être blanc, on n’entendait pas vraiment de moments qui sortaient plus du lot que d’autres. La ressemblance extrême des titres entre eux semblait indiquer une volonté de neutralité esthétique pour mieux faire passer le message militant, sans lyrisme, et la vitesse à laquelle ils se déroulaient empêchait visiblement de pouvoir fétichiser un instant parmi d’autres, et donc d’esthétiser d’une façon ou d’une autre la forme et d’oublier le fond. Sauf qu’avec le temps cette lecture m’a paru bien insuffisante, sinon hors sujet. Voire, j’en suis venu à me dire qu’elle comprenait complètement le contraire de ce qu’il y avait à comprendre.
Déjà parce que le punk hardcore – et ses descendants le trashcore ou le power-violence – n’est pas toujours politique et qu’on ne comprend même pas toujours les paroles, qui peuvent être hurlées ou grognées sans souci de délivrer un signifié particulier. Mais surtout parce que ce que j’avais pris pour de la neutralisation militante des formes – en faveur d’une mise en avant du fond – s’apparente en fait, quand j’écoute des groupes comme ceux que j’ai mis dans la playlist ci-dessus, à une espèce de standardisation satirique. Et même peut-être à une satire de la satire de cette standardisation, la satire et la subversion n’échappant elle-même pas à la standardisation. Ce que je veux dire, c’est que lorsqu’on fait l’expérience – sur disque et non sur scène, certes – de ces tracks qui donnent l’impression simultanée de se dépêcher de terminer et d’atteindre néanmoins en un temps record le dernier stade de la catharsis par la musique populaire à guitares, on se demande bien s’il y a vraiment quelque chose à expérimenter ou si on a pas affaire à un geste purement théorique, voire purement conceptuel.
Si vous écoutez tout à la suite, j’espère sans avoir trop de besoin de zapper, vous sentirez peut-être comme moi que le déroulé concret des chansons produit, en tant que processus, une confirmation l’intuition d’Adorno lorsqu’il écrit que le morceau de musique populaire (qu’il appelait aussi « légère », dans les années 1930 et 1940) est d’une certaine façon déjà écouté avant même d’avoir commencé. Ce qui me fait donc penser qu’il y a dans ces titres hardcore la volonté de pousser jusqu’à l’absurde les recettes toujours plus restreignantes qui régissent la production musicale de masse. Jusqu’à l’absurde, c’est-à-dire jusqu’à leur propre destruction : c’est une démonstration par l’exemple de l’inanité des principes qui dirigent la fabrication pop. Ou plutôt une mise en application à l’extrême de la standardisation des émotions et des énergies : si on pousse à fond la croyance en l’industrialisation/marchandisation du rock, ça donne ça, on arrive dans la matrice, où il n’y a plus que la bave aux lèvres et l’essoufflement, sans le moindre ornement pour entretenir l’illusion de beauté. C’est une manière de ridiculiser la croyance et de proposer une œuvre qui se pose en anti-œuvre, ou en méta-œuvre, ou en critique radicalement autonome d’elle-même jusqu’à ne plus pouvoir être éprouvée ni en tant qu’œuvre ni en tant que critique – on ne sait pas trop.
Idéalement il faudrait demander leur avis à des spécialistes de l’art conceptuel : voient-ils une analogie entre le geste musical hardcore et le geste plastique de Duchamp ou de Kosuth ? Est-ce que le hardcore associe au passage la performance à son inspiration art conceptuel ? Et surtout est-ce qu’on peut lui conférer des propriétés aussi théoriques et réflexives dans la mesure où il ne les a jamais, à ma connaissance, revendiquées ? Peut-on parler d’une construction théorique immanente à l’expérience elle-même, et non élaborée explicitement, où le travail artistique impliquerait en lui-même sa propre critique sans la formuler par des discours ? La musique consommée peut-elle se transformer en sa propre critique radicale ? J’ai envie de penser que oui, et d’être optimiste voire plein d’espoir au milieu de tout ce bruit qui se mêle à toutes ces idées, de voir un peu de lumière et d’espoir scintiller dans l’ombre de cette cabine matricielle faite de blast beats, de changement d’accords bas-du-front et de voix toujours plus égarées.
Ma théorie ce serait donc qu’au contraire du postpunk, qui lui affirmait en puissance et en acte sa remise en question de la forme punk classique jugé encore trop fidèle à l’idiome marchand du rock, le punk hardcore a surjoué la colère et le jusqu’au-boutisme juvénile, se servant d’eux comme d’une ruse pour mieux se cacher derrière eux et mieux nous guider droit dans l’impasse esthétique : peu importe à quel point on s’énerve et à quel point on dépense sa négativité, au fond de tout ça on reste enfermé, on n’en sort jamais, on termine toujours dans la banalité la plus sinistre. On comprend que tout effort esthétique est vain, qu’il vaut mieux suivre bêtement le chemin que d’essayer d’en prendre un quelconque contrepied pour le déjouer. On ne combat la stupidité administrée qu’avec ce qui nous reste de stupidité naturelle, en quelque sorte.
Le hardcore organise sa stupidité en réduisant au maximum l’espace où pourraient se développer des mélodies, une expression vocale, une dramaturgie rythmique ou harmonique. C’est un geste à la fois radical et défaitiste. Il y a bien des riffs, de l’intensité, quelques pauvres variations, mais tout ça se bouscule tant que ça se rapproche de l’inintelligible, tout est trop serré, il y a trop de précipitation pour laisser passer tout un tas d’émotions. Et ces éléments prennent vie de façon si mécanique qu’ils approchent, je le disais plus haut, l’abstraction la plus sévère. Un riff hardcore n’a plus l’effet d’un gros riff classique et fétichisé : il n’exprime plus la moindre matière, il devient purement formel, pure data. Les réflexes de l’audition rock ne marchent donc plus pareil, et ce qui m’est apparu comme flagrant, surtout, c’est qu’au-delà de l’idée qu’on peut se faire du hardcore comme d’un défouloir sans règles pour jeunes Américains issus des classes populaires et moyennes, il y a dans les gestes de cette musique un truc bizarrement puritain, du moins très règlementé, avec des tabous. Lorsqu’on enchaîne les morceaux, on distingue une ligne de plus en plus étroite, une espèce de crête, sans mauvais jeu de mots. Cette crête est tellement étriquée qu’on dirait que les musiciens mettent toute leur énergie à jouer cette musique identique et finalement hyper stable, quoique frénétique, pour être sûr de ne pas glisser vers la pente de la non-musique ou disons de la non-pop, vers une zone qui ne serait plus que du bruit (la noise est d’une certaine manière la cousine délurée du hardcore), ou du moins plus qu’une suite d’informations sonores brutes dénuées de tout lien, qui ne joueraient plus le jeu de l’illusion marchande. On sent que ça les fait froidement kiffer de frôler l’effondrement de toute proposition pop, de s’amuser au bord du précipice comme ça, en faisant les choix les plus idiots, comme doubler au chant les accords de guitare ou la ligne de basse, imposer des breaks de batterie de la façon la plus impulsive possible, et bien sûr écourter les chansons autant que faire se peut.
Vu de l’extérieur, et je me situe très à l’extérieur de ces scènes, cette musique qui force le trait de ses propres recettes, de ses schémas, de ses zones érogènes, peut donc être perçue comme une critique active et constructive, quoique désespérée, de la façon dont nous consommons les marchandises culturelles, et en particulier celles censées être animées par un esprit de révolte. J’ai conscience que beaucoup de hardcoreux·ses ne seront pas de mon avis et que ma théorie se place à l’opposé de décennies de pratiques cathartiques DIY qui se sont tenues dans des squats, des punk houses ou des salles autogérées. Je sais aussi que mon désir de théoriser le punk hardcore n’est pas du tout punk hardcore, si je puis dire, et que je m’expose au risque de passer pour un binoclard qui délire tout seul. Mais j’assume mon désir et mon délire de binoclard car je sens que quarante ans plus tard, cette musique en général pressée sur disque pour avoir un prétexte à être jouée sur scène, a bel et bien muté et que son existence relève aujourd’hui d’un phénomène dont j’ai envie de commenter le pouvoir subversif insoupçonné car ambivalent et peu réifiable. La conversation est ouverte.
PS : je précise que j’ai découvert plusieurs des groupes présents dans la playlist ci-dessus grâce à la liste des 50 albums préférés de Kurt Cobain. Les fans de Nirvana connaissent sans doute ce top, moins connu que la NWW list car il contient une bonne partie de disques très connus (Raw Power, Surfer Rosa, Daydream Nation, Dry, Entertainment, Colossal Youth, Green, etc) mais ce nerd de Cobain a quand même laissé une grosse place à des disques plus obscurs, qui l’étaient d’autant plus lorsqu’il a rédigé ce classement au début des années 1990. Allez la voir si vous l’avez jamais vue, c’est instructif sur l’esthétique kurtienne (on s’aperçoit entre autres de l’influence majeure sur lui du chanteur de Fang, tristement connu pour avoir étranglé sa petite amie), et c’est aussi une mine de bons disques que vous n’aviez peut-être comme moi jamais écoutés jusque là.