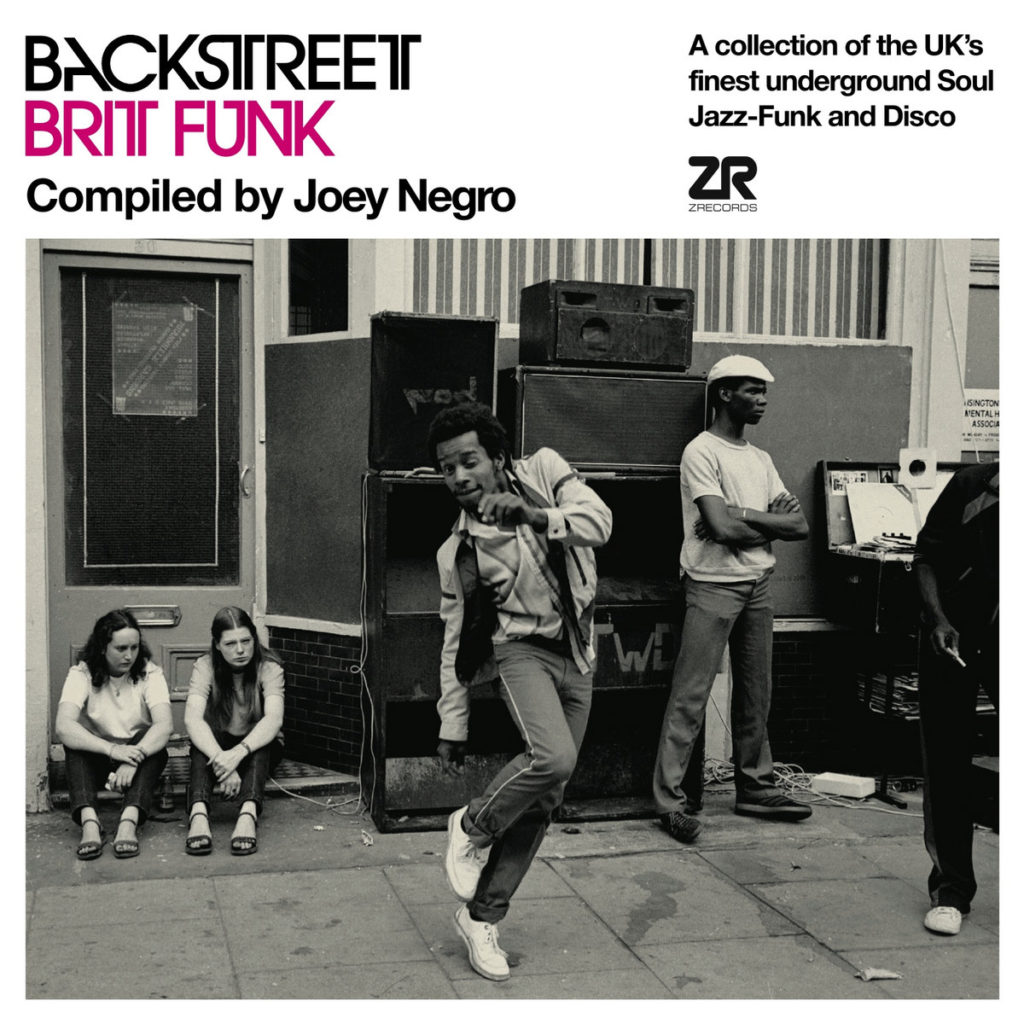“Je me demandais si le rôle de ces pays dans l’histoire des hommes ne serait pas de rendre possible, pour la première fois, certaines symbioses de culture” écrit le narrateur du deuxième roman d’Alejo Carpentier, Le Partage des eaux (1953), livre magistral faisant le récit du voyage d’un musicologue new-yorkais dans la jungle amazonienne à travers sa quête d’instruments indigènes oubliés. Je ne suis pas musicologue, je n’y connais même pas grand-chose en musique, et il me semble que c’est devenu un lieu commun spécifique au journaliste musical de dire qu’il travaille sur un objet qui lui échappe. Ça aide à mieux dormir la nuit peut-être. Moi j’écoute et j’écris, et j’espère ne pas dire trop d’âneries depuis mon point de vue : homme, blanc, occidental (mais jeune, tout de même). Gros héritage lorsqu’on veut écrire sur l’Amérique latine (et sur un tas d’autres sujets, remarque). Il y a plus d’un an j’avais déjà rédigé ici quelques articles sur la musique d’Amérique latine car je me trouvais justement sur place. Je voulais allier travail et plaisir. Après je suis rentré, donc j’ai arrêté la série. Je souhaite aujourd’hui la reprendre depuis Paris car, après tout, c’est un peu difficile de voyager autrement. Faut faire avec ce qu’on a.
Aujourd’hui je voudrais vous proposer de découvrir un album de jazz fusion composé par une artiste brésilienne, Simone Sou. Ce premier album au nom quasi éponyme, Sim One Sou (2001), est sorti sur le label brésilien Circus Produções et a été co-produit avec le groupe SOMOS. J’ai découvert Simone Sou alors que je cherchais de la musique produite en Amazonie pour un podcast édité par Rinse France. Je me souviens avoir naïvement tapé “Amazonia” dans la barre de recherche de Discogs (technique de digger imparable ou honteuse, vous me direz) et cet album était apparu comme un miracle, entre Philip Glass et Teddy Lasry. J’avais déjà quitté l’Amazonie à ce moment-là et je me demandais bien ce que je pourrais faire d’un si joli album, si ce n’est l’écouter, le réécouter, en faire une obsession, et décider finalement d’écrire quelque chose ici, un an et quelques mois plus tard.
Que peut dire l’oreille lorsqu’elle épouse un métamorphe ? L’oreille se tait, l’oreille écoute : l’oreille tente de percevoir quelque chose. L’oreille s’essaie à construire son propre monde, ou plutôt à s’y fondre : la musique de Simone Sou est justement cette tentative d’irruption dans l’oreille selon la forme que l’oreille souhaite habiter à ce moment précis où elle écoute. C’est un surgissement inespéré. Ici, en fait, l’oreille n’écoute pas : elle fait face, fière et parfois fébrile. Lorsque mon oreille se frotte à la musique de Simone Sou, c’est pour laisser parler une farandole d’impressions : il m’arrive de ressentir l’infinie tristesse des espaces vierges de l’Amazonie lorsque j’écoute le morceau « Amazônia », il m’arrive de sentir cette joie volcanique me déborder lorsque j’écoute « Mulher Que Come Terra », il m’arrive même d’avoir un peu envie de mourir lorsque j’écoute « Choro Seco », et il m’arrive enfin de vouloir me dissoudre entièrement lorsque j’écoute « Pra Inspirar Seu Toque ». Une farandole d’émotions qu’encadre la vie, la mort, et tout le reste de ces états que l’être humain a jugé important de connaître.
Mais le plus étrange, c’est que chacun des morceaux de l’album peut invoquer en moi ces états aussi disparates que la joie, la tristesse ou la mélancolie : oui, chaque sentiment est déjà potentiellement contenu dans chaque morceau. Curieux retournement qu’opère ici la musique de Simone Sou et c’est pourquoi j’aime cette idée de musique métamorphe : c’est une musique qui laisse le choix de ce qu’elle veut vouloir dire. C’est une musique qui n’impose rien, qui laisse la liberté à l’auditeur de prendre ce qu’il y a à prendre. Dehors il fait un temps nuageux, je n’ai encore vu personne de la journée et je me demande si ce sera le cas demain : l’ensemble de l’album me paraît d’une mélancolie extrême. Et demain je serai à une fête et nous boirons du vin entre copains·ines. Je mettrai « Maraca » et si le morceau me paraît aujourd’hui si dépressif, je sais qu’il me fera voyager plus tard vers la lumière. La musique de Simone Sou est métamorphe. Elle n’impose rien, se fond en nous, emplit l’espace : nous transforme.
Je me souviens avoir envoyé l’album à une amie qui travaillait sur un insoluble problème philosophique et qui m’avoua ne pas avoir réussi à travailler avec cet album dans les oreilles. J’en déduis qu’il y a en effet une limite à cette magie de la métamorphose. Car Simone Sou demande une oreille attentive malgré tout, une oreille qui, si elle ne l’était pas, se laisserait déborder par les éléments tissés par l’album. Chaque morceau est en effet bâti sur la surprise : l’oreille ne peut jamais s’habituer à quoi que ce soit, il y a peu de répétition, les ambiances s’enchaînent et ne se ressemblent pas, les rythmes et les motifs se succèdent au sein d’un même morceau. « Mulher Que Come Terra », par exemple, insuffle une tension primordiale : la percussion construit son architecture à la mesure d’un tambour qui grossit, une flûte et une corde dialoguent subtilement, les sonorités s’emmêlent, se fondent, se brisent, une basse terrible survient, la voix de l’artiste apparaît, le rythme change ; l’oreille, alors, se laisse déborder par ce qui la dépasse. C’est pourquoi cette musique, qui n’est pas une musique intellectuelle (même si construite autour du jazz), demande tout de même une certaine attention : ce n’est pas une musique à glisser en fond, c’est une musique qui fonde un monde.
Il y a un peu de Weather Report ici et certains morceaux sont un clin d’œil à Popol Vuh, mais si je devais coller une référence principale (et locale) à ce qu’invente Simone Sou avec son album, c’est Egberto Gismonti qu’il faudrait invoquer. Dans l’usage des percussions, le dialogue acoustique/électronique, la structure métamorphique des morceaux, la narration au sein même de l’album, cette idée d’univers en soi (c’est le cas de toute œuvre), cette utilisation débridée des synthétiseurs et des instruments traditionnels, cette complexité qui n’oublie jamais l’auditeur, cette synthèse passé-présent-futur, tout ceci ramène inévitablement au génial guitariste/pianiste à qui l’on doit plusieurs dizaines d’albums, dont Trem Caipira, Sonho 70 ou Retratos. Des monuments que Simone Sou, originaire de São Paulo, batteuse de son état, ne devait sans doute pas ignorer en composant ce premier album, qui est par ailleurs un petit tour de force en termes de collaboration (une vingtaine de contributeur·trice·s sont nommé·e·s).
Plus récemment, j’ai découvert deux petits bijoux de la musique électronique brésilienne que Simone Sou ne renierait peut-être pas : Perguntas et Respostas de Vamos Desistir, signés sur le label 40%Foda/Maneirissimo basé à Rio de Janeiro. Deux albums qui se suivent, plus axés sur les musiques électroniques que le disque de Simone Sou, mais qui s’inscrivent l’un dans l’autre et qui me permettent de réactualiser un concept que j’avais esquissé dans un autre article : celui de disque-frontière. Je crois que le terme de frontière était malaisé, et je préfère désormais parler de disque-traversant. La frontière est toujours poreuse, elle marque un ici et un là, comme si rien ne pouvait dialoguer au milieu, comme si tout était déjà tracé, comme si rien ne pouvait se contaminer, comme si la relation n’était pas possible en-dehors d’une opposition. L’album de Simone Sou (et avant lui la musique d’Egberto Gismonti), au contraire, permet aux mondes tissés par la musique de se traverser, de s’entre-contaminer : l’un permet l’autre, et l’autre opère un retour en arrière, inlassablement. Rien n’est jamais fixe. Tout bouge. Et le futur n’est pas encore arrivé qu’il était en fait déjà là.
Lorsque j’écoute Simone Sou et cet album de jazz fusion qu’elle nous livre, je ne peux m’empêcher de penser aussi à la magie qu’opéra en moi il y a quelques années In A Silent Way de Miles Davis, cette manière de mélanger l’imprédictibilité du jazz, ses structures bâtardes, sa sauvagerie aussi, à tout ce qui alors venait du rock en termes d’orchestration électronique, ces musiques étranges que les auditeurs de l’époque découvraient et ne pourraient plus jamais oublier, tant la révolution était énorme, tant elle laissera des traces partout, tout le temps. Avec l’album de Simone Sou je crois qu’il y a une part de cet héritage fusion qui demeure et qui permet de conjurer les forces qui sans cesse poussent à l’uniformité des choses, des êtres, des mondes. Oui, Simone Sou est une sorcière qui chante la Terre et son disque est une traversée d’univers.