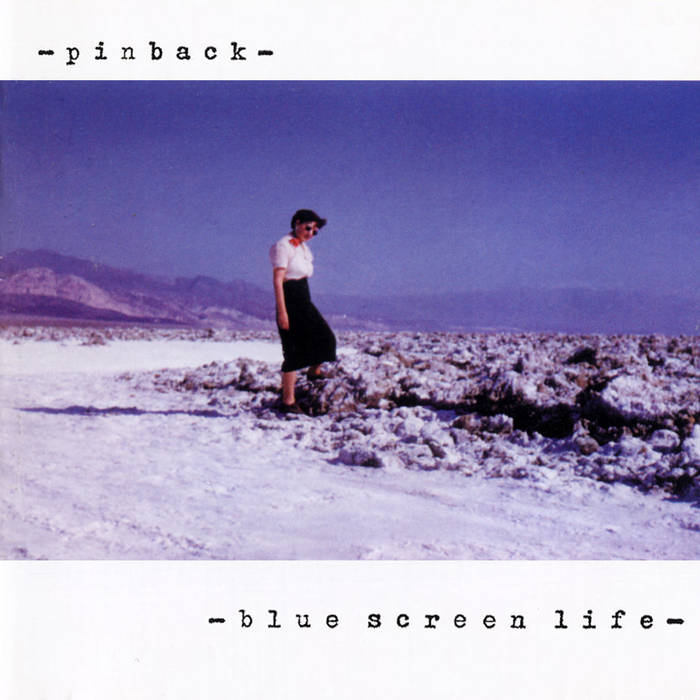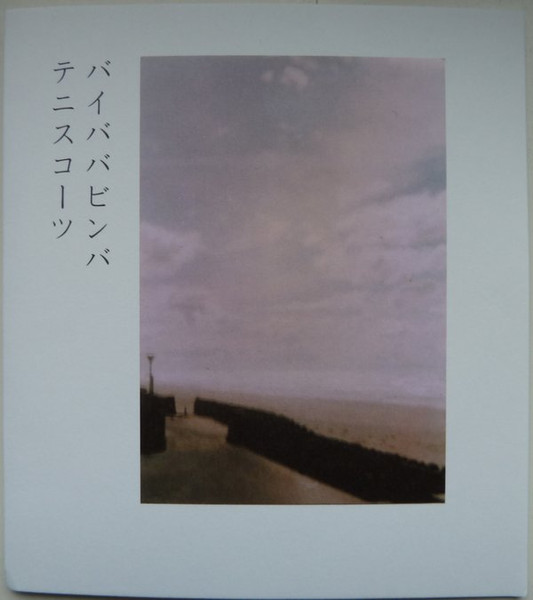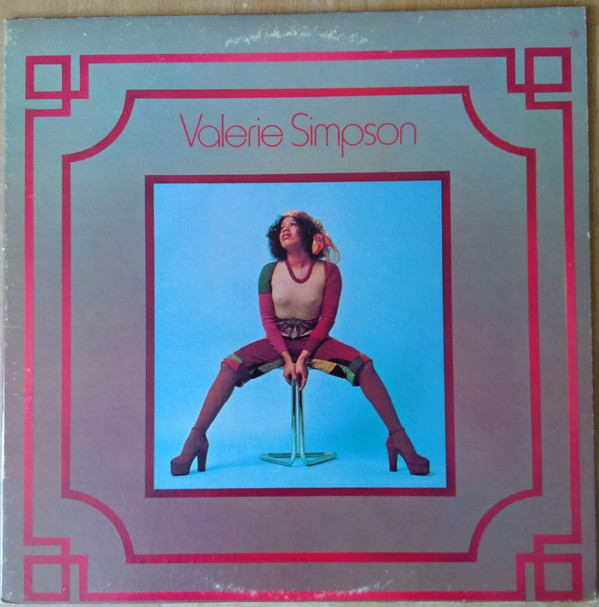Selon l’expression consacrée – mon pote Jacques, encore lui –, je suis, à l’instant même où ces lignes s’écrivent, babycore. Corps et âme. Je vis bébé, je ris bébé, je mange bébé, je (ne) dors (pas) bébé. Quand d’autres clament incarner la musique, ce à quoi il est quand même difficile d’objecter quoi que ce soit, je me trouve pour ma part dans une zone inédite et étrange, super-sélect car exclusive aux primo-parents, où toute action se trouve polarisée par une déité en construction, dont on tente, en retour, de percer les secrets à chaque instants. Je suis babycore, comme je pourrais être hardcore : un mode de vie, ça c’est sûr, mais aussi un écosystème sonore bien particulier, où la vocalité est centrale (pleurs, gazouillis, borborygmes), non seulement pour l’organisme littéralement incroyable et impossible à quitter des yeux, mais aussi pour ses géniteur·ices. Cela ne sert à rien de lutter : des onomatopées et des mélopées nous sortent d’on ne sait où, la voix prend des inflexions dont on se pensait incapable. Autant de tentatives de dialoguer avec un hybride aussi énigmatique qu’adorable.
Cette voix omnipotente et omniprésente, tour à tour tonitruante ou presque imperceptible, pleine de matières, reconfigure le musical – le sonore même. Ce que l’on entend bascule et entre dans le champ de la poésie potentielle ; tout s’enchante. Les contours de chaque item peuvent être contemplés, tous semblent détenir un secret ; ce qui fut est réaligné, une kyrielle advient. De là à dire que tout·e mioche est une fusion parfaite entre Henri Chopin et un Pokémon il n’y a qu’un pas, que je n’hésite pas à franchir.
La lallation, l’harmonie des sphères et le langage entrent en collusion et forment une gigantesque et terrifiante mélodie ; toutes les émotions du monde m’habitent et m’augmentent, se nourrissent d’un manque de sommeil considérable et persistant. À cet état altéré, ce psychédélisme d’amour et de douceur, Mouthpiece fait un écho troublant.
Cette split cassette éditée par le label bruxellois Région Karstique réunit deux musicien·nes dont j’aime beaucoup les travaux, j’ai envie de dire des habitué·es de MJ mais je ne pense pas avoir tant que ça parler d’elleux, mais bref brisons ce suspense inacceptable : il s’agit de Rebecca (Bonté) et d’Amédée (de Murcia). Chacun de son côté, la paire a travaillé l’émission buccale médiée par un instrumentarium électronique. L’oral, l’aural, l’émulé et l’organique s’y fondent, forcément. C’est ce qui attire toujours dans les pièces à base de voix : l’indéfini, la contrefaçon, voire « contrefiction » oserais-je, d’une présence intangible mais capturée, celle d’un·e humain·e qui s’incarne en disant. Alors oui, le sampler comprime la rude élasticité de la syllabe – même quand celle-ci est le produit d’un ersatz vocaloïde –, on croit d’abord que le canevas rythmique va enfermer mais en fait non, le sens déborde et le fait exploser ; on hallucine, on soupçonne, et la poésie advient.
« Short story long, » et « Striatum » sont deux pièces longues et obstinées, et c’est ce qui m’attire d’abord chez elles. Sur chacune, les musicien·nes font ce qu’iels savent faire, ce qui est quand même commode et plaisant : ascèse anguleuse du sample pour madame Bonté, virtuosité fluide entraînant une disparition du dispositif chez monsieur de Murcia. Deux trames d’une quinzaine de minutes, ou les deux faces d’une cassette, où se déroule une même litanie qui trouble l’esprit à force de redire l’analogue de bien des façons. La bouche y est toujours au centre mais dans des optiques complémentaires : Rebecca concasse les syntagmes synthétiques pour en extraire un sirop signifiant épais et impur, Amédée joue sur le flou cystotome, égrène un chapelet de questions : est-ce la voix, la machine, se trouve-t-on à l’intersection des deux ?
Mais allons-y dans l’ordre, et « Short story long, » d’abord : le titre à la forme exquise, avec cette virgule conclusive parfaite qui dit justement une conclusion impossible, un épilogue sans fin ; mais surtout ces quinze minutes et trente-six secondes acharnées (je le redis) où des parcelles de mots, de bout en bout machiniques, donnent l’impression de phrases élusives. Il n’y a rien, ou plutôt presque rien, si je peux citer une sommité dans la pièce de Rebecca, et c’est logiquement dans ce dépouillement qu’advient la grâce. À force d’artefacts low-tech computarisés, on capte le fantôme dans la coquille (c’est la fête des refs, là !). Les traînes rêches d’un souffle issu de circuits et non de poumons, des cliquetis de coupures à la fois nettes et imprécises, tout cela porte les traces du vivant organique, par défaut. C’est à partir de cinq minutes que mon esprit dévisse personnellement, le hors-piste devient indéniable ; les hauteurs varient, les vitesses et densités des canevas aussi, et le sentiment d’extase glossolalique prend de l’ampleur. J’entends alors le bébé dans la machine : c’est la voix qui s’extrait d’elle-même pour devenir autre chose, la musique pourrait-on simplement dire.
Le mot est absent chez Amédée, mais c’est pour le mieux. Les rebonds sont somaticaesques, les cordes sont peut-être vocales mais surtout d’élasthanne ; tout est voix, rien ne l’est, le formant n’est qu’une matière compositionnelle se transformant là en nappe fantomatique, là en basse profonde et percussive, là en motif ostinatique. L’enchevêtrement de ces objets labiaux, brefs et lustrés, dont la nature n’est jamais totalement arrêtée, tourne la tête. On voudrait danser : pourtant la sensualité presque obscène de cette musique salivaire simulée m’empêche. La vie se loge dans l’artificialité revêche du sample chez Rebecca et c’est le contraire pour son compère, où la chaleur désincarne : les voix, en cohorte, sont chaudes mais blanches, on entend le devenir-chair de la machine qui tend vers le vivant, jusqu’au malaise – un autre bébé dans la machine, virtualité qui point.
Nous sommes dimanche, et voici encore un article avec des références pouponnesques – je ne peux pas faire autrement en même temps, babycore oblige, rappelez-vous, et de toutes façons décoincez-vous mes quadras mélomanes pointu·es, les lardons c’est la next tendance, surtout si la nation le veut ! Je retourne donc changer une couche de ce pas, bien utile pour franchir l’étroit ruisseau séparant un néologisme où le langage et la musique se décomposent dans la tendresse et une musique de bouche synthétique.