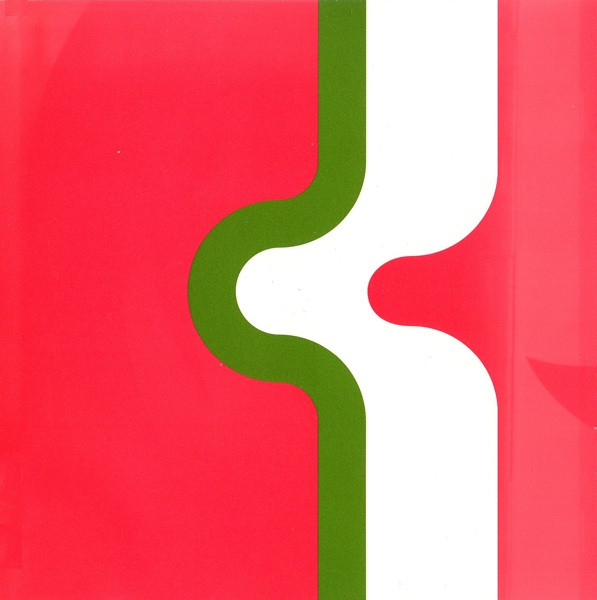Le terme « computer music » sonne sans doute comme un pléonasme aujourd’hui, mais il a un moment désigné une forme de création centrée sur la mobilisation de l’outil informatique à une époque où celui-ci était encore peu démocratisé, soit des années 1950 à 1980. Si on peut mentionner les travaux de certains pionnier·res, comme Laurie Spiegel ou Jean-Claude Risset, la musique électronique sur ordinateur s’est d’abord cantonnée aux départements spécialisés d’universités américaines ou d’institutions comme l’IRCAM, qui étaient alors les seuls à disposer des moyens de financer ces coûteux appareils computationnels.
Puis vers la fin des années 1990, l’apparition du PowerBook d’Apple, capable de faire tourner des logiciels de traitement du signal sophistiqués dans un format miniature, a permis à cette computer music de s’échapper de son giron savant. Des musicien·nes plus jeunes et plus ancré·es dans le rock indé ou la techno, et bien souvent dépourvus de formation musicale ou académique, ont ainsi pu aisément avoir accès à ces outils. Le plus célèbre exemple de cette révolution, c’est le virage Max MSP pris dès 1998 par Autechre à partir de LP5, mais il faut aussi citer le travail des labels Mego à Vienne, Mille Plateaux à Francfort, Sonig à Cologne, ou encore Schematic à Miami.
Émancipée de la tutelle de la musique électronique institutionnelle, mais pas non plus affiliée à une IDM souvent trop mignonne et formatée, cette computer music du tournant du millénaire a également existé à Paris. Une scène hélas méconnue aujourd’hui, certes modeste à l’époque, mais qui tout de même eut le mérite de tirer son épingle du jeu, en dépit d’une French Touch toujours en place bien que déjà déclinante, et de la déferlante néo-80, incarnée entre autres par le Pulp.

À l’heure où Macron a l’air de juger pertinent de réclamer l’intégration de la French Touch au patrimoine de l’UNESCO (Brigitte et lui auraient-ils été des habitué·es des soirées Respect, voire du fumoir du Palace époque Pedro Winter ?), j’ai de mon côté trouvé plus intéressant de revenir sur ce moment oublié de l’histoire pop française où la computer music s’est faite radicale et improvisée. Car il me semble qu’en proposant des compositions génératives insolentes et parfois tout à fait hasardeuses, ces artistes non-sachants-bricolants réinventaient l’attitude punk. Cet underground esthétique fut pionnier en France du glitch, un mot et une pratique depuis ressurgis et recodés ça et là, jusqu’à devenir presque mainstream aujourd’hui, dans la musique ou ailleurs. Ces artistes s’appelaient Discom, Dat Politics, gel: aka Dorine_Muraille, Portradium ou O. Lamm (alias Olivier Lamm, déjà critique musical en parallèle de son travail artistique), et leur musique était éditée sur des labels comme Deco ou Active Supension. Formé de deux membres de Sister Iodine, Lionel Fernandez et Erik Minkinnen, Discom était sans doute l’entité la plus active de cette micro-scène, organisant de nombreux concerts et soirées, outre leur activité musicale proprement dite.
Pour en savoir plus, j’ai donc invité Lionel Fernandez à répondre à quelques questions pour mieux nous éclairer sur ce moment charnière, quoique méconnu de la musique française récente.
Musique Journal : Discom est un projet né à la fin des années 1990, à la suite de Sister Iodine, trio no-wave qu’Erik Minkinnen et toi formiez avec Nico Mazet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce glissement du noise rock abrasif à la computer music élégiaque et conceptuelle ? On a l’impression que deux mondes se tournent le dos et se chevauchent en même temps.
Lionel Fernandez : Ça a d’abord été une histoire circonstancielle dans la vie du groupe puisque Nicolas Mazet, le batteur de Sister Iodine, est parti s’installer à New York, en 1997.
On était un peu en crise d’inspiration, la musique électronique balayait tout sur son passage et on s’est retrouvés tous les deux à Paris, Erik et moi, on a eu besoin de se lancer dans un nouveau projet pour se revitaliser.
Quand on a commencé Discom, on était pour nous absolument dans la continuité de ce qu’on cherchait à faire avec Sister Iodine. C’était les mêmes intentions esthétiques. No wave.
Un ami avisé qui nous a d’abord découverts via Discom me disait que Sister Iodine lui faisait penser à du « Discom, dans une version analogique/électrique vicieuse ». Comme lui, je vois ça avec assez d’évidence.
Les intentions étaient les mêmes, mêmes goûts pour les tensions et les ambiances trouées, la même attention portée à la matière brute, dans la fraîcheur et l’excitation d’explorer ça avec un nouvel instrument.
On a recommencé à jouer avec Sister Iodine en trio en 2002, quand Nicolas est revenu de New York. On a vraiment breaké quatre ans, ensuite on a mené les deux projets de front.
On connait le rôle qu’on eu les logiciels Max MSP ou PureData dans la fabrique de la computer music de l’époque, notamment chez Autechre. L’environnement modulaire virtuel créé par Miller Puckette à l’IRCAM a considérablement marqué la musique expérimentale assistée par ordinateur. Est-ce que vous utilisiez vous-même ces logiciels ? Comment tu décrirais votre attitude vis-à-vis de cet outil de création sonore – l’ordinateur – si différent de vos outils de l’époque Sister Iodine ?
Je suis toujours dubitatif face à la fixation sur l’outil.
Je pense que ça m’intéresse moi parce que je fais de la musique mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant au fond.
En fait, pour nous, le sujet c’était : qu’est-ce qu’on fait avec un ordinateur ?
Comment on peut explorer, détourner, maltraiter ce nouvel instrument ?
On avait récupéré quelques patchs de Super Collider [alternative open source à MaxMSP, ndlr] des Farmers Manual qui tournaient beaucoup dans toute l’écurie Mego. Les Farmers Manual étaient les geeks de la bande, les laborantins qui programmaient pour tout le monde, ils ont par exemple été pour beaucoup dans la mutation d’Autechre fin nineties via l’entremise de Russell Haswell. Nous, c’est Peter Rehberg/Pita [fondateur de Mego, décédé en 2021, ndlr] qui nous avaient filé ces patchs. C’était beaucoup Super Collider et Max, puis Erik s’est vraiment plongé dans Max et fabriquait lui-même des patchs, donc on s’est mis à avoir nos propres outils.
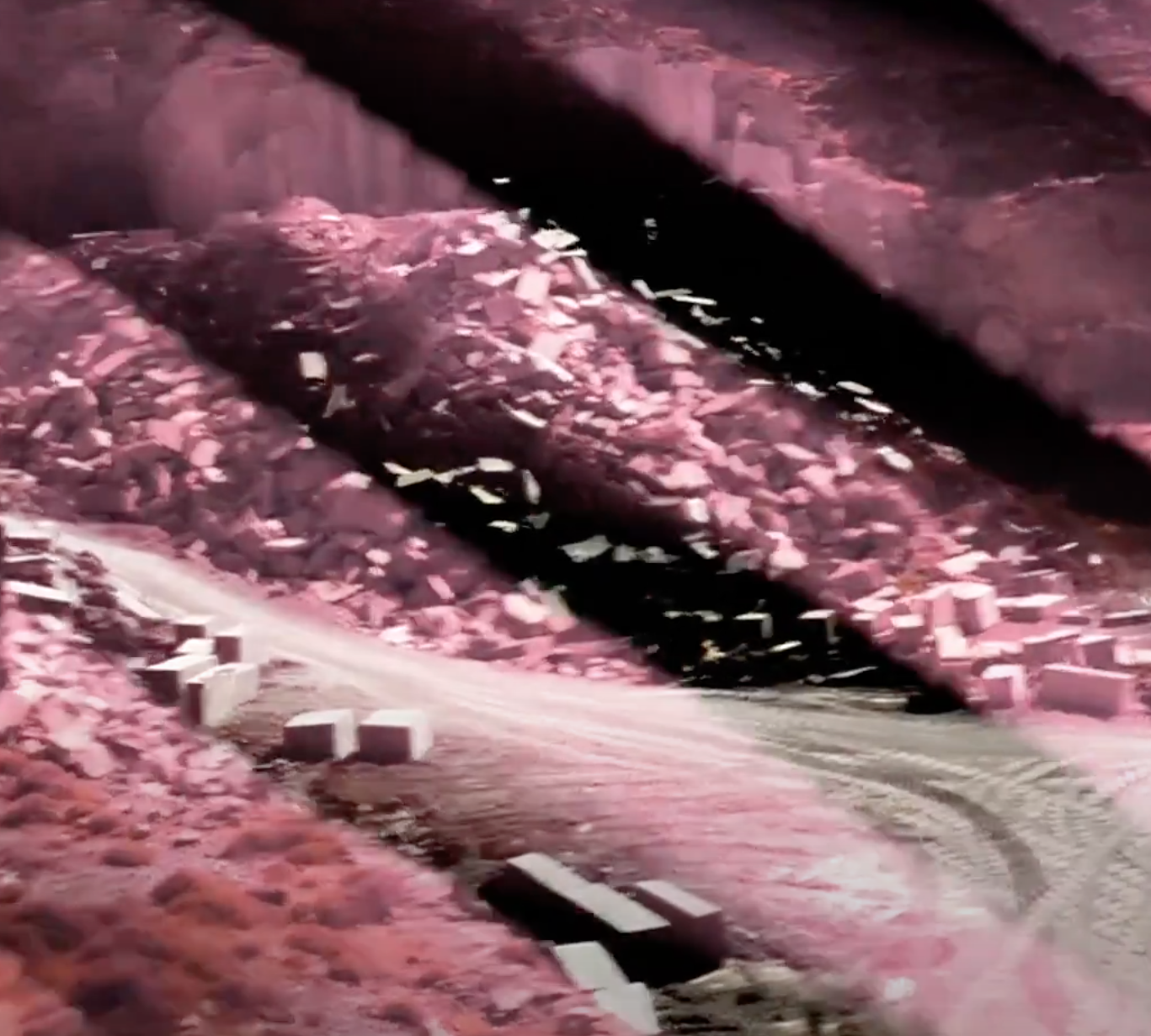
Si tu soulignes une certaine continuité no-wave entre Sister et Discom, il y a néanmoins une vraie rupture entre les deux projets en termes de présence scénique et de rapport au corps : bouger sa souris et ses yeux, c’est autre chose que de jouer de la guitare comme tu le fais.
Pour nous, à l’époque de Discom, il y avait une radicalité totalement punk dans cette « non-expression ».
Je sortais personnellement de tournées épuisantes avec Bastärd, un groupe rock dans lequel je jouais de la basse, et je ressentais une forme de lassitude quant à la théâtralité du rock. Pas tant dans la manière d’être sur scène que le rapport à la maitrise, la maitrise du jeu, des instruments, des compositions, une manière de faire le show, quoi, sans aucune mise en danger, un truc qui m’éteignait et ne me suffisait plus, et qui étouffait toutes les déviances et dérapages, toutes ces sensations border dont on a besoin (avec Erik) pour être stimulés sur scène.
La computer music est le lieu possible de deux types d’expérimentations qui se superposent : on peut à la fois composer et improviser, le plus souvent en même temps, avec plusieurs sources sonores. Avec un patch que l’on démultiplie, on peut arriver aux mêmes genres de résultats avec des micro-orchestres virtuels préassemblés sur ordinateur. Quelles sont alors les limites du rôle de compositeur-ices ?
Ce qui nous intéressait justement avec la computer music, en tout cas cette forme là, extrême, radicale, c’était de se détacher du geste compositionnel.
Utiliser ou créer des patchs, installer un dispositif ou la musique se déroulerait d’elle-même, c’était ça qui nous excitait.
Perso, à cette époque je trouvais le geste de composition pompeux, voire problématique (lol). En créant des dispositifs, qu’on orientait par nos choix esthétiques (sons/textures/matières/algorithme des patchs) mais où ensuite la musique se développait par elle-même en rebonds, accidents, surprises, de manière aléatoire, on s’est réexcités, on a retrouvé une joie d’être sur scène, pour un temps. Et ça nous faisait des vacances.
La politique du glitch, du parasitage sonore, se retrouve partout dans ta musique, avec Sister, Discom, ou en solo. Le glitch incarne avec beaucoup d’immédiateté une forme de regard critique sur les objets technologiques audio. Or cette critique semble avoir disparu du champ de la création contemporaine : pourquoi, à ton avis ?
Le glitch a été avalé par le mainstream, il est aujourd’hui partout, clips, pubs, jeux vidéo, design sonore etc… Autrefois c’est vrai que ça a pu être une signature, faire entendre un CD qui saute était « choquant », aujourd’hui dans l’époque (saturée d’appareils, de réseaux, d’applis, de bugs) ça ne déstabilise plus personne, le glitch est devenu une évidence du quotidien, un effet de style, un code graphique ou un code sonore, « branché ». Perso je n’ai jamais trop utilisé et aimé ce terme, personne ne le disait vraiment dans la scène d’ailleurs, je trouve que ça renvoie à un tic, en effet, que ça l’esthétise, et que ça le vide de sa supposée charge critique.

À l’époque, avec Sylvie Astié, Erik Minkkinen et Isabelle Piechaczyk, tu organisais les soirées büro, qui ont marqué les esprits. C’est là qu’on a pu voir à Paris les premiers live se résumant à un musicien-ne derrière son laptop. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la réception de ces spectacles ? Est-ce que tu as certains lives mémorables en tête ?
Dans un premier temps ces concerts ont relativement fasciné les gens par leur épure, et la radicalité du (non-)dispositif.
Bien sûr, il y avait aussi un effet repoussoir chez certains qui moquaient allègrement ces gens, qui soi disant faisaient leurs mails pendant qu’ils étaient sur scène. En gros.
Nous, on allait déjà voir les concerts d’enceintes au GRM, à l’époque gratuits le dimanche après-midi dans l’auditorium Olivier Messiaen de la Maison de la Radio, on adorait la musique concrète donc on était rompu à la non-spectacularité du concert. Mais le premier concert büro, pour y revenir, en mai 1998, a vraiment marqué les gens. C’était Fenn’O’Berg et Farmers Manual, il y avait 500 spectateurs et personne n’avait jamais vu ça. Peter Rehberg m’a dit plus tard que François Bayle était là (pour l’anecdote), et je dois dire qu’à l’époque, pas grand-monde n’avait encore d’ordinateur portable chez soi, Internet à peine, donc tous ces Powerbooks sur scène c’était assez fascinant.
Par la suite, il y eu beaucoup de concerts büro marquants, Russel Haswell au Purple Institute, Panasonic (a l’époque il y avait encore le A) au Garage, Tony Conrad au Garage encore, Microstoria au Goethe Institut, Merzbow au Point FMR, une soirée Mego avec Pita, Fennesz et General Magic, je crois dans un dancing, L’Evasion, où ils avaient littéralement fumé la sono, ou encore, dans un autre genre, DJ Assault au petit matin dans un PMU de Strasbourg St Denis etc. etc.
Néanmoins si je devais en retenir un, c’est des années plus tard, un concert qui n’était pas un événèment büro mais qui aurait complètement pu (dû !), qui fut une forme de catharsis de la chose. C’est un concert de Florian Hecker à Pompidou (avec Fennesz et Bill Orcutt), à l’orée des années 2010. Hecker était installé à la console en haut de la salle, sur scène deux immenses enceintes, seules. Le concert était corrosif comme l’est la musique de Hecker, sans être très fort de volume, mais les textures sont tranchantes et certaines de ses fréquences travaillent une sorte de psycho-acoustique dérangeante qui peuvent te pénétrer dans le corps, et alors sous l’impulsion de Richard Pinhas (sic), des gens commencent à se plaindre à voix haute, le sommant de jouer « moins fort ! », puis très vite, ça dégénère et ça hurle au « fasciste ! », « nazi ! » etc. Les gens captivés se rebellent timidement, essaient de les faire taire, mais l’ambiance est devenue délétère, un mec descend sur scène et commence à faire des doigts à la salle, puis il est rapidement suivi par un autre enragé qui renverse les deux enceintes et commence à les défoncer. La sécu déboule, saute sur le gars sur scène, le concert est plié. La police arrive.
On venait de vivre notre petit moment stravinskien (ou schoenbergien). Épique. [Et par ailleurs chroniqué ici dans L’Obs, accessoirement par le futur rédacteur en chef de Konbini, comme quoi, ndlr]
On l’a débriefé toute la nuit dans un bar à côté de Beaubourg avec Pita, Hecker, et quelques autres… On en revenait pas de ce qu’on venait de vivre, on était choqués, mais aussi, la nuit faisant, je dois dire qu’on en a beaucoup ri.

Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont vous faisiez partie du paysage de la nuit parisienne au tournant des 2000 ?
On avait notre réseau, et un fief, le Zorba où on était tout le temps, on traînait beaucoup avec des gens de l’art contemporain, et avec le réseau du graphzine punk, il y avait quelques ponts avec des crews plus branchés de la musique et de la nuit, mais on a jamais trop aimé les clubs ou les « vraies salles », c’est pas là ou on s’amusait, on a toujours cherché à organiser nos concerts ou nos soirées dans des lieux qui n’en étaient pas. On avait néanmoins une résidence au Pulp, qui était pour le coup le club « branché » de l’époque, tous les premiers mercredis de chaque mois, ça s’appelait le büroclub, où on jouait nous, nos amis, ou quelques vedettes du show-business (DMX Krew, Thomas Brinkmann, Cylob, Chicks On Speed etc). Ça a duré deux ans, les filles du Pulp n’ont jamais trop compris ce qu’on faisait mais pour nous ça a été très fun.
Comparativement, et malgré une scène dévouée et une communauté digitale bien ancrée, ce moment radical computer music à la française n’a pas laissé beaucoup de traces, il est peu mis en avant. Comment peux-tu l’expliquer ?
Pour recontextualiser, à l’époque, cette scène a existé en France de manière vraiment fragile et confidentielle hein, écrasée par la culture club, la French touch, puis l’électroclash etc. etc.
Tout ça prenait toute la place.
Après, avec le temps, je pense que si elle n’a pas laissé assez de traces c’est aussi parce qu’il n’y a pas assez eu de disques marquants, importants. Tout simplement.
Je parle à l’échelle de « l’histoire de la musique » disons. A part peut-être les disques de gel: alias Dorine_Muraille qui sont encore aujourd’hui des beaux ovnis, qui ont toujours fière allure.
Pour ce qui est de la MAO, c’est un outil, pas une esthétique, dans les années 1990 faire de la musique avec des patches Max ou Super Collider était déjà un « geste artistique », aujourd’hui toute cette esthétique du déraillement a été complètement absorbé par d’autres genres, la trap, la hyperpop, la techno.
***
En 2026, Lionel Fernandez sortira le premier album de son nouveau projet solo LACQ, à paraitre sur Nashazphone, et sur le même label sera également édité le prochain Sister Iodine. On pourra aussi l’entendre sur un disque enregistré au GRM avec Jérôme Noetinger.