J’eus espéré qu’Internet ait immortalisé la date, mais que nenni. Le sujet de ma recherche s’y prêtait pourtant, mais il faudra donc rester flou quant au jour, voire, à l’année à laquelle se déroule cette scène, mais je la situerais autour de 1997 ou 1998. Dans une banlieue qui me semble assez lointaine pour devoir s’y rendre en voiture, avec mon pote Christian, peut-être aussi Vlad et peut-être même ma meuf… Le contexte est tellement vague : nous nous rendons dans une salle, il me semble une MJC, tels des croisés, des pèlerins touchant enfin au but, un événement messianique dont seul Christian avait déjà été témoin : un concert d’Autechre.
A l’époque, le duo britannique est depuis quelques années pionnier d’un nouveau genre de musique électronique abstraite, qualifiée tantôt d’électronica, tantôt d’IDM – pour intelligent dance music, on connaît le débat – et représentée majoritairement par le label Warp, qui émerge conjointement. Fabriquée à partir de quelques synthés et samplers et pilotée par le logiciel Cubase, la musique d’Autechre présentait des paysages synthétiques inédits. Une digestion de la techno par une mise à nue alchimique de son matériau et de sa fabrication afin d’en tirer une essence renouvelée. Il ne s’agissait pas de transformer la merde en or, mais plutôt d’intellectualiser une démarche initialement viscérale, en parlant à la partie sensible du cerveau plutôt qu’aux tripes. Et dans leur recherche d’atmosphère sonore et spectrale, Autechre avait réussi à se forger une réputation de showmen austères, mais résolument futuristes. Autant dire que l’épiphanie devait être au rendez-vous.
Las, d’épiphanie, il n’y eut point. Je ne l’aurais pas admis alors – je n’ai pas le souvenir de m’être extasié pour autant – mais ce que je venais de voir en sortant de cette MJC, c’était un concert de merde. Deux mecs chiants plantés derrière leur PowerBook G3 posés sur une table, en train de jouer des morceaux à n’écouter qu’en étant assis contre un mur au fond de la salle dans une obscurité convenue. Pourtant, à l’époque, ça devait à peu près ressembler à ce que j’attendais de la musique.
Passé du métal à la fusion au début des années 90, puis à l’indé et au hardcore au milieu de la décennie (cheminement parfaitement traditionnel pour quelqu’un né avant l’élection de Mitterrand), je commençais à m’intéresser à la musique électronique après avoir découvert par quelle magie John Carpenter composait ses BO : le synthétiseur. C’est en déambulant dans les rayonnages de chez Gibert, boulevard St Michel, en 1996, que j’entendais un jour un son moitié tribal, moitié alien, moitié keusse qui m’interrogeait assez pour que j’achète instantanément le disque dont il était issu. Un titre issu d’une époque où l’on osait encore mettre un arobase dans le nom de son groupe.
Ce disque, c’était L@N, sur le label allemand A-Musik, qui possédait l’une des pochettes les plus énigmatiquement laides que j’aie croisées. Il m’a fallu plusieurs années pour comprendre que le visuel épelait le nom L@N – un nom dont je n’avais déjà pas spontanément saisi la prononciation, n’étant pas encore à l’époque tout à fait rompu aux termes les plus techniques d’un World Wide Web encore balbutiant. A l’occasion de cet article, j’ai réécouté l’album, que je n’avais pas entendu depuis quelque chose comme 18 ans et il tient la route. Ses séquences polyrythmiques en stéréo, ces sonorités électroniques ultra allemandes ressemblent encore à quelque chose que je pourrais aimer, mais c’est désormais chose rare, et je n’imaginerais même pas me dire « Tiens, je vais écouter L@N », parce qu’aujourd’hui, à l’exception de deux ou trois artistes, non seulement je n’écoute plus d’electronica, mais je trouve que c’est une musique de merde.
Comment en suis-je arrivé là ? Probablement un parcours dans le labyrinthe pléthorique des références qui sortaient alors, guidé par mon ami Christian et par la fascination de Vlad pour les programmations alambiqués, la poursuite d’une curiosité qui me faisait me désintéresser des sonorités électriques, qui a fini par se transformer par une légère mais persistante fatigue. Et aujourd’hui, après une longue absence sur mes enceintes et dans ma vie – une absence d’ailleurs passée inaperçue –, je me suis dit que cette musique ne me manquait pas, et qu’en plus, il ne me viendrait vraiment pas à l’idée d’en réécouter.
C’est qu’à partir de 1997, l’année qui a marqué l’explosion « des » musiques électroniques poussée par les sorties conjointes de Homework des Daft Punk et de Dig Your Own Hole, le deuxième album des Chemical Brothers (à trois mois d’écart), les labels qui travaillaient sur de la musique électronique un peu sophstiquée, répondant rétrochronologiquement et à leur manière à Detroit, Chicago, Berlin et Londres, peuvent enfin s’en donner à cœur joie. Si les Daft et les Chemical – et dans leur sillon Massive Attack, Prodigy et Fatboy Slim – cartonnent, eux aussi réussiront bien à vendre quelques galettes obscures à des curieux et des belles-mères perdues.
Parmi ces labels, Warp Records, qui cultive son écurie à Sheffield depuis 1989 et a déjà bien assis Aphex Twin et leurs poulains les plus prodigieux, Autechre, dans les discothèques de ceux qui ne se contenteront jamais. Après des débuts ancrés dans le son “bleep” et la culture rave, le label affichera vite des ambitions artistiques moins orientées sur la danse. Avec Autechre, c’est Aphex Twin qui mènera cette première vague electronica chez Warp, ainsi qu’en parallèle sur son label Rephlex, où il développera l’aspect primitif d’une techno acid mutante mais jouissive. Son mojo, la « braindance » – un sous-courant débilos qui montrera assez rapidement ces limites elle aussi – aura au moins permis de faire émerger l’un des rares artistes de cette époque que j’écoute encore aujourd’hui avec autant de plaisir et de fascination, Ceephax Acid Crew, le frère talentueux du plus réputé mais bien plus relou Squarepusher, chancre de la drill‘n’bass.
À partir de 1999, pendant qu’Aphex surfait sur le succès international de son titre “Windowlicker” – qui aura mis un terme à son succès et à l’intérêt qu’on avait pu porter à son clipper, le génial Chris Cunningham, c’est une histoire sur laquelle il serait bon de revenir un autre jour – Warp Records, eux, s’engageait sur la pente glissante de l’aseptisation un brin élitiste et exclusive. Malgré des signatures plus accessibles qu’Autechre, mais pas forcément fascinantes, l’aspect le plus pop de cette culture électronique post-club était laissé à d’autres. Le meilleur souvenir qu’il me reste de cette époque et de ce genre, c’est l’album Time Tourist, de B12, un hommage marqué à la techno futuriste de Juan Atkins (avant qu’il devienne chiant lui aussi).
Time Tourist réunit un peu ce qui pouvait se faire de mieux à l’époque, à commencer par sa pochette signée The Designers Republic (putain, ce nom d’agence de co-working créatif ultra foireuse… comment avoir été dupe ?), siglé d’une typo issu de Wipe Out du plus bel effet, mais surtout, d’une illustration de Trevor Webb magnifique, évoquant aussi bien 2000AD que les merveilles spatiales et pachydermiques de Chris Foss. Le voyage rétro-futuriste qu’il propose tient plutôt bien la route aujourd’hui. Bien mieux que la grande majorité de ses contemporains et des titres imprononçables d’Autechre. Peut-être parce qu’ils ne cherchaient pas à faire suffoquer leurs machines, Michael Golding et Steve Rutter semblent aujourd’hui bien moins dupes de la tendance qui poussait la plupart des artistes à rivaliser de triplettes glitch et d’abstraction granulaire. La peste qui finit par alimenter la plupart des albums d’artistes qui voulaient se revendiquer du « genre ».
Dès la fin des années 90, l’Electronica était devenue la musique qu’on écoutait à l’institut Goeth, Paris 75016. On y accueillait Oval (allemands) ou Murcof (mexicain). S’y mêlait alors un public tantôt chiant, tantôt super chiant, amateur de post-rock et autres musiques ésotériques et sérieuses du début du 21ème siècle. C’était l’ère de Four Tet (aussi baptisé 00110100 01010100, soit 4T en code, mais dans mon langage, va te faire foutre) et de sa « folktronica ». Mais si je devais dater le début de la fin de l’electronica, je la situerais autour du moment où elle a traversé l’Atlantique par le biais de labels comme Schematic ou Beta Bodega Coalition, qui l’ont abordé de différentes manières.
Certes, il serait salaud pour toute une scène US apparue au milieu des années 90 à la convergence de l’indie pop et de l’electronica de jeter l’ensemble de ses membres avec l’eau du bain. Un groupe comme Flowchart a signé un album assez unique à ce jour, Cumulus Mood Twang, qui mêle allègrement séquentialisme à la Steve Reich et ambiance psyché disco imprégnée de soft electronica, et se laisse très volontiers écouter.
C’est beaucoup moins le cas d’un groupe comme Phoenecia. Sans regarder la chronologie sur Wikipedia, je dirais que Phoenecia a dû commencer à s’activer à la fin des années 90 pour se faire un nom global au début des années 2000. Renseignements pris, c’est à peu près ça : les deux membres de Phoenecia débutent en 1995 sous le nom Space Oddity, avant de signer chez Warp sous le nom de Phoenecia et de monter le label Schematic quelques années plus tard.
A posteriori, je dirais que Josh Kay et Romulo Del Castillo se sont inspirés des ambitions les plus chiantes d’Autechre en cherchant à en faire un truc encore plus chiant, froid et hermétique. Il faut dire que du G3, on était passés au G4 et que Max/MSP, le logiciel développé par l’Ircam, avait remplacé Cubase sur bon nombre de bécanes de musiciens devenus entre temps « sound designers », ainsi qu’un tas d’autres titres tout aussi pédants. Début 2000, Autechre était donc déjà de l’histoire un peu ancienne, des darons en quelque sorte, et Phoenecia, la jeune pousse dont le label, Schematic, ressemblait en tout point à un héritier de Warp piloté des Etats-Unis.
Je me rappelle avoir acheté Brownout, leur premier album sorti en 2000 après quelques singles, l’avoir écouté une fois, et m’être dit : « il est bien possible que dans quelques années, cet album ne te parle plus du tout ». La vérité, c’est qu’il ne me parlait déjà pas.
Mais le pire était à venir. L’électronica était en passe de devenir un genre musical à l’ambition aussi inédite qu’unique : cramer son processeur. Les gros nerds qui se branlaient sur Cubase à une époque commençaient à rivaliser de virtuosité pour savoir jusqu’où ils pouvaient pousser leur laptop. Ça donnait des séquences ultra complexes, des traitements sonores sur 8 couches, de la synthèse granulaire à gogo (« hyper gourmande en ressources ! ») et ça donnait surtout des morceaux parfaitement inaudibles parce qu’à 800% onanistes. J’ai jamais saqué les musiciens virtuoses, il n’y avait donc aucune raison que j’accorde quelque crédit à Richard Devine ni à tout ce qui allait suivre.
C’est probablement à cause de tous ces mecs que je n’ai jamais accroché à la trap, parce que dès que j’entends une triple croche de charley, ça me file de l’urticaire. Après Devine, j’ai dit stop. J’avais eu un bon crush sur le label très roots Beta Bodega Coalition, mais j’ai fini par me mépriser un peu trop en achetant un énième album sorti chez eux, qui contenait du Otto von Schirach, le roi du breakcore déglingo. J’ai été un temps ultra fan du label Mass Transit, de Miami, parce qu’il me semblait qu’ils revenaient à des compo sommaires et efficaces, mais après ce bref regain d’espoir, l’explosion de l’electroclash début 2000 a fini par me faire ranger mes disques electronica pour ne plus jamais les sortir.
Sans même m’en rendre compte, j’étais passé à autre chose. J’écoutais de la musique électronique pionnière des années 50 et 60, qui n’avait pas besoin d’un A à la fin de son adjectif qualificatif. Des trucs qui me rappelaient le groupe signé chez Warp pour qui je conserve encore de l’estime, quitte à passer pour un blaireau aux yeux de l’élite : Boards of Canada, les grands absents de cette chronologie, et pour cause, je gardais le meilleur pour la fin. En se tenant toujours en marge de ce que leurs voisins programmaient – je crois qu’il n’y a pas une triple croche à 140 BPM chez Boards of Canada – Michael Sandison et Marcus Eoin ont signé une musique naturellement cataloguée electronica (de par son label et son travail sonore relativement original à l’époque des premières sorties) qui avait l’avantage d’être intemporelle et qui a encore celui d’être parfaitement audible aujourd’hui.
Parce que donc, en 2019, quand je repense à ma « période électronica », sans avoir honte, j’ai quand même le sentiment d’avoir un peu perdu mon temps. De m’être échoué sur un rivage musical astringent, dont les sirènes avaient pour nom élitisme, hermétisme et exclusivité. Je ne suis plus tellement en contact avec Christian aujourd’hui, mais j’aimerais lui demander s’il écoute encore Autechre ou Gescom, et sinon, ce qu’il en pense. J’ai du mal à imaginer qu’on puisse encore prendre cette musique vraiment au sérieux. J’ai du mal à imaginer qu’on ne se soit pas dit un jour, dans une version inversée de l’épiphanie que j’attendais en allant voir Rob Brown et Sean Booth jouer dans cette banlieue lointaine : mais putain, c’est ultra chiant en fait. Du mal à imaginer qu’on puisse encore écouter un disque de Richard Devine sans se dire que ça n’a rien à foutre sur une platine ou sur une playlist. C’est avec un peu de dégoût mais surtout beaucoup d’ennui que j’ai fini par me détourner à tout jamais de l’électronica. Vlad, lui, s’est mis au banjo il y a quelques années.
Au milieu des années 90, lorsque que j’avais encore un peu d’estime pour le rock, je me souviens avoir méprisé des mecs comme Iggy Pop et Henry Rollins (j’avais pourtant idolâtré le second) qui chiaient sur la musique électronique et la techno, à part Kraftwerk, les seuls à trouver grâce à leurs yeux de gros cons. Mais en 2019, en pleine rédemption, j’en viens à me demander si l’électronica n’était en effet pas, au fond, une vraie musique de merde. Je ne sais pas si c’est une théorie réac, ne serait-ce qu’a posteriori, voire si je suis moi-même devenu un gros con, mais en tout cas, là tout de suite, je pense que l’idée tient plus debout qu’un morceau de Richard Devine.








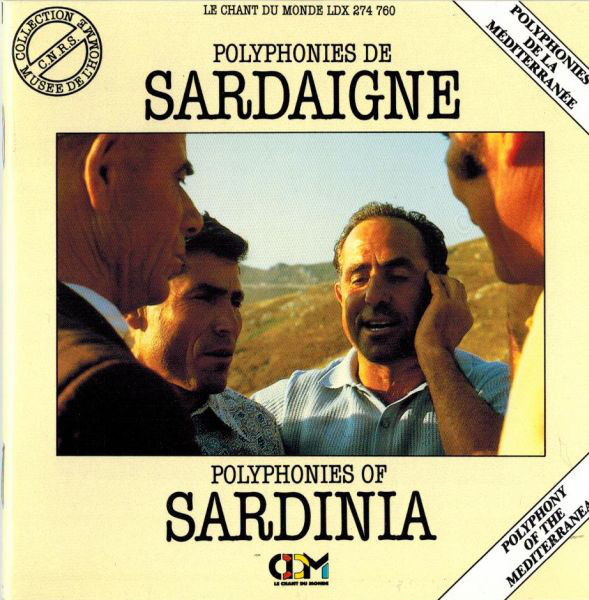

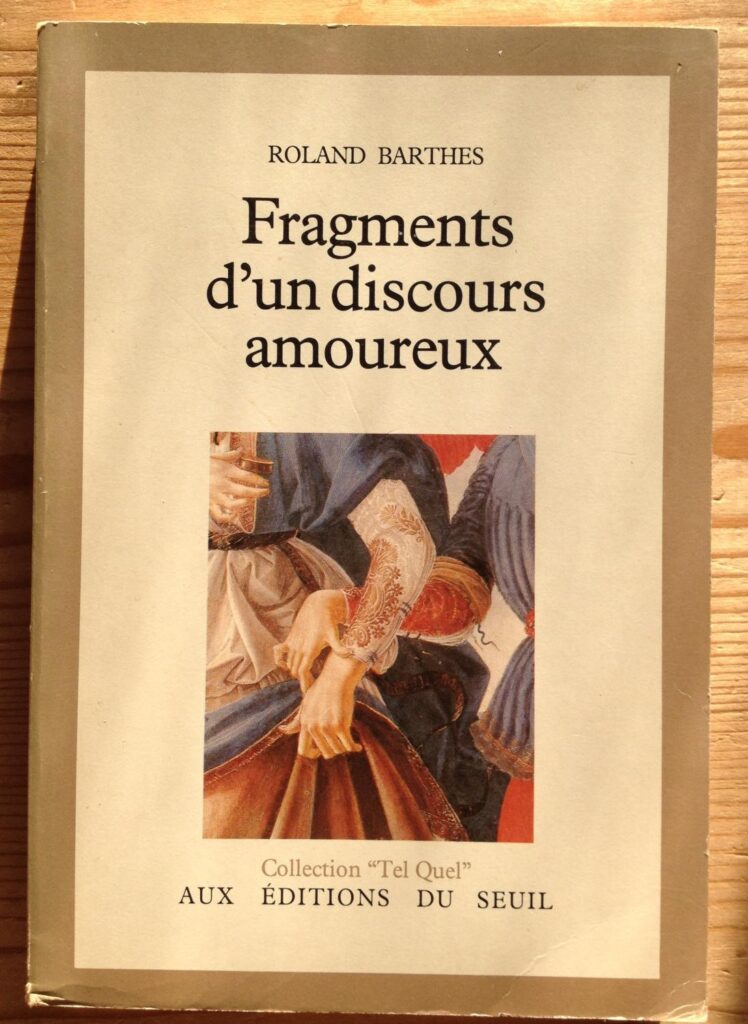
13 commentaires
Faut pas jeter l’aphex avec l’eau du twin.
Dur. Mais à défaut de Richard D quid de Richard DJ qui n’est que survolé ?
« Je me rappelle avoir acheté Brownout, leur premier album sorti en 2000 après quelques singles, l’avoir écouté une fois, et m’être dit : « il est bien possible que dans quelques années, cet album ne te parle plus du tout ». La vérité, c’est qu’il ne me parlait déjà pas. »
Je pourrais remplacer Brownout par des dizaines de noms piochés dans des genres, écoles, répertoires, styles, époques différents que je ne pourrais que me reconnaître dans cette phrase (la vôtre au demeurant). Combien de fois m’être fait « avoir » par (au choix) une écoute rapide, un papier éloquent dans une revue quelconque, un avis définitif jeté au passage par telle ou telle connaissance, etc. Et de se retrouver avec sur les bras, dans les oreilles, sur les étagères avec un album qui « ne me parlait déjà pas » au moment de son acquisition (alors dans des milliers d’années, n’en parlons pas, toutes ces perspectives de trans-humanisme n’y pouvant mais.).
Pour ceux qui restent orphelins d’une certaine excitation que pouvait, malgré tout, provoquer l’« electronica », le retour à l’electro avec d’un côté Drexciya et de l’autre la scène actuelle (plus particulièrement représentée par les labels Brokntoys et Central Processing Unit) permet de renouer avec une musique exigeante, rythmée et imaginative.
Chouette article, merci.
De « la musique de merde », je ne sais pas mais s’infliger les seconds couteaux de l’IDM en sacrifiant la discographie prodigieuse d’Autechre (le coffret NTS de l’an dernier est fabuleux), c’est clairement perdre son temps.
C’est un peu le lot de toute personne qui a écouté des musiques hors formats (free jazz, noise, musique contemporaine…) ou peut être même n’importe quelle musique, que de se retrouver tout seul des années plus tard et de se retourner en se demandant comment il en était arrivé là (l’electroclash ça sonne comment en 2019 ?). Et tout ceux qui dans les années 90 ont fait le voyage de la techno jusqu’à mego (et peut-être plus loin) se sont forcement posé la question (et ont fait un gros tri dans leur discothèque). C’est dommage de terminer sur Boards of Canada qui est quand même la version la plus soft possible de l’IDM de part les sonorités et le format (sans que ça soit une critique de ma part), alors que le questionnement sur le problème de la virtuosité technique et technologique inhérent au genre était plus intéressante et qu’elle circule depuis les débuts du synthétiseur dans la musique populaire. Et la tarte à la crème d’assimiler public chiant / musique chiante (vive le cool…), on pouvait s’en passer.
je serais curieux de savoir sur quel genre vous avez jeté votre dévolu, futur révolu (?) en 2019.
Je ne défendrais pas l’IDM, je suis d’accord qu’une impasse existe … mais je trouve cet article tellement moche, agressif et vulgaire, il dissimule mal son inconsistance sous une couche de pseudo-radicalité putassière, on dirait la logorrhée d’un critique de comptoir qui bave pour dissiper leur propre médiocrité.
Thomas (Ester) Brinkmann, le « grand » oublié ?
Dommage d’entacher une opinion intéressante par tant de suffisance.
Donc, si j’ai bien compris, tu avoues avoir des goûts de chiottes en electro et t’être fait du mal pendant des années en écoutant des bons trucs.
Hmmm… Je t’aimes toujours Virgile. Mais ce concert d’Autechre en 1998, c’était sans Powerbook, un de leur dernier concert full analo, avec des boîtes à rythmes des synthés, des séquenceurs, etc.
Le projet de futurisme de l’IDM s’est n peu terminé avec Gantz Graff et Brownout, comment aller pus loin? Ça à permis à la dance music de reprendre le chemin de la pertinence.