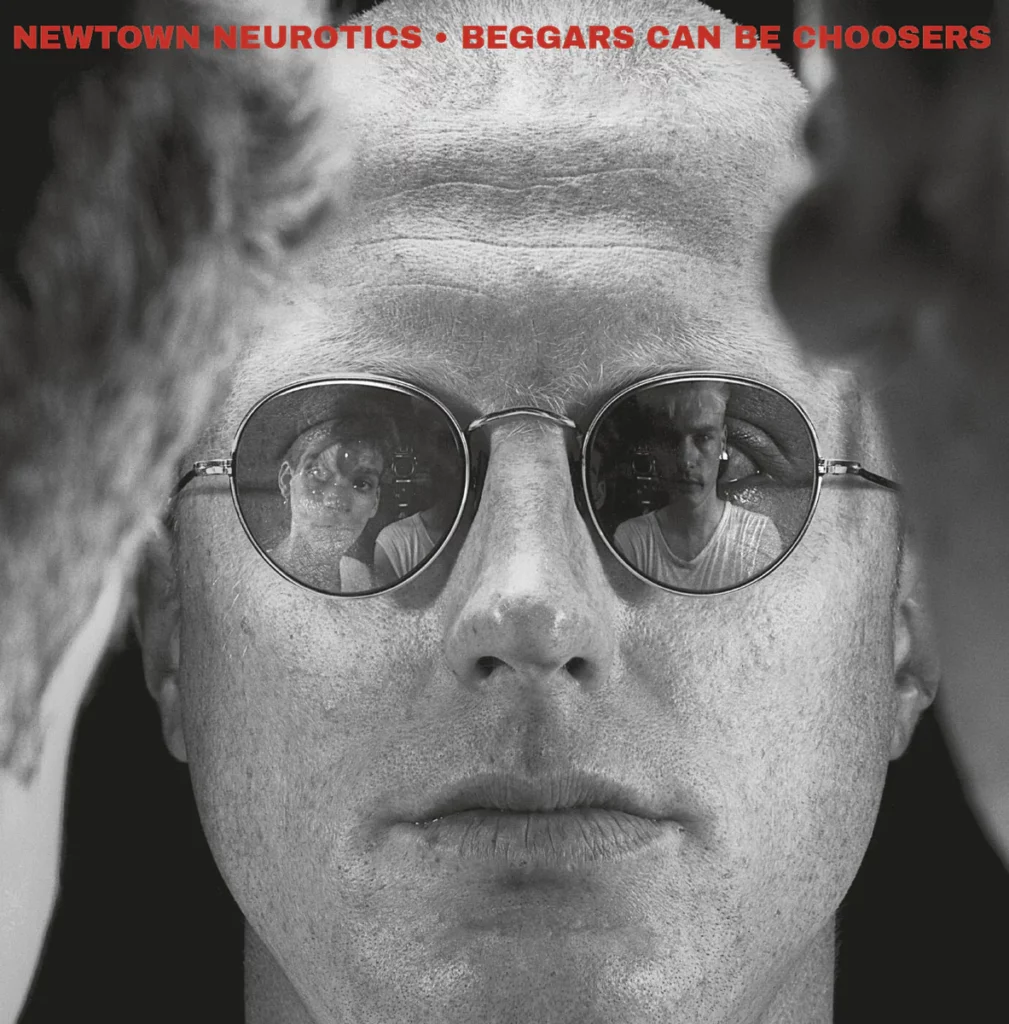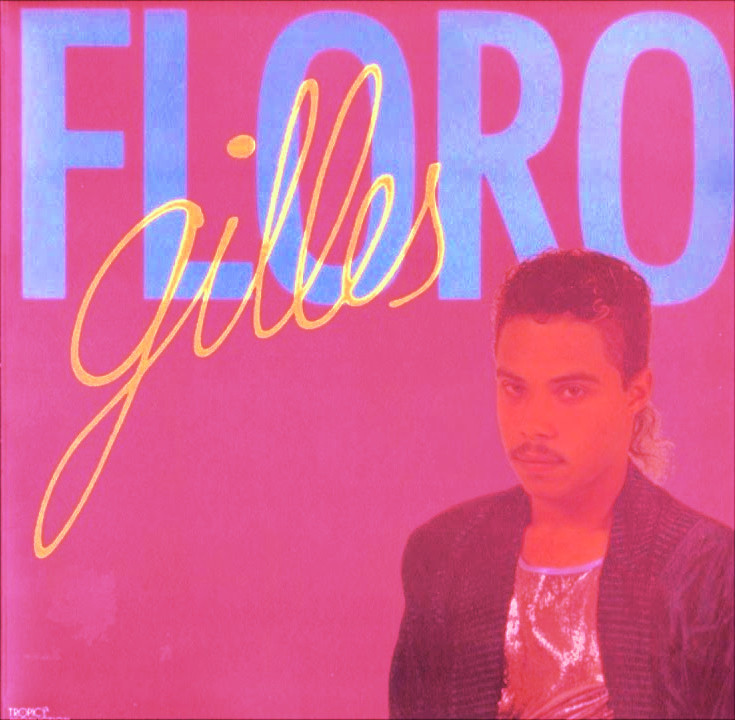Depuis bientôt trente ans, le Gallois Luke Vibert est reconnu par pas mal de monde comme l’un des artistes électroniques les plus formidables du Royaume-Uni. Malgré le passage du temps, il a su garder quelque chose de très juvénile et très frais dans sa façon de faire de la musique. Vous le connaissez peut-être surtout parce qu’au cours des années 2000 il a, sous différents pseudos (Amen Andrews, Kerrier District, The Ace of Clubs, etc…), cherché à revisiter le breakbeat, la jungle, l’acid-house, l’electro ou la (nu-)disco, toujours avec à peu près le même talent, le même élan et la même singularité déconneuse, et édité des disques à la fois chez Ninja Tune et Rephlex, Mo’Wax et Warp. Ami d’Aphex Twin, il a façonné à lui tout seul une passerelle entre la scène des gens groovy et bien dans leur peau, façon Gilles Peterson/Nova, et les zones les plus autistes, creepy, limite outsider, de la scène IDM, soit des groupuscules qui bien souvent proposent de la musique moins prévisible et plus authentiquement psychédélique.
Et surtout, si je voudrais parler de lui aujourd’hui, c’est qu’avant de se diversifier ainsi, Vibert a été été un vrai génie d’un genre qui, lui, se créait à l’époque même où il le pratiquait : c’est le trip-hop, ou l’abstract-hip-hop, voire le downtempo, bref, ce courant musical adepte de plages instrumentales basées sur des rythmiques rap de type boom-bap, et des plages qui dans le cas de Vibert étaient littéralement habitées, hantées de samples et de parasites qui offrent à ses morceaux une vocation hallucinatoire avec laquelle on ne peut que difficilement négocier. C’est de la musique de gros stoner, mais de stoner pas du tout orienté chill, on est au contraire toujours plus ou moins au bord des ténèbres – et j’avais d’ailleurs écrit dans ma jeunesse un article à son sujet qui s’appelait « Spliff et Idéal », merci aux Fleurs du mal au programme du bac français 1996 (et de pas mal d’autres années je pense). Le disque le plus cité de Luke période trip-hop est généralement Big Soup, sorti sous son propre nom en 1997 chez Mo’Wax, mais personnellement j’ai beaucoup plus écouté Throbbing Pouch, publié deux ans plus tôt sous le nom de Wagon Christ, et qui selon moi jouit d’une aura moins pro et d’une sorte de climat sans pression, que l’on ne sent plus du tout chez son successeur, plus exposé et sans doute un minimum supervisé par James Lavelle, le patron de Mo’Wax.
Ce qu’ont en commun les deux albums, en revanche, c’est une obsession pour la dénaturation vertueuse des samples, et notamment des samples de library – une fixation que l’on retrouvera par la suite dans la majorité de la vaste discographie de Vibert. Luke éditera d’ailleurs plusieurs anthologies de morceaux extraits de catalogues européens de library chez Lo Recordings et enregistrera même, sur ce même label, un disque avec l’une de ses idoles, le Français Jean-Jacques Perrey. Cette couleur vintage aigrelette, Vibert la mélange à d’autres genres de samples, en général venus de disques afro-américains, et ça donne une fusion de tonalités et d’ambiances qu’aucun autre artiste à ma connaissance n’a jamais réussi à accomplir. Ce n’est pas juste un exploit technique, c’est carrément une porte secrète qui s’ouvre dans les morceaux de Throbbing Pouch : une porte qui mène vers un monde caché où le groove le plus fat, limite le plus indécent, est arrosé de petits geysers d’électronique délirante. La plupart des titres sont construits comme des suites de péripéties audio, des récits sonores quasi picaresques, mais sans se présenter de façon pontifiante et jamais trop conscients d’eux-mêmes. Je ne suis pas trop partisan du discours genre « pour comprendre cette musique il faut être sous [choisir drogue] », mais là, de fait, pour l’avoir beaucoup écouté sous weed, je peux vous dire que c’est un disque qui se marie extrêmement bien à l’hyper-attention auditive permise par le cannabis, aux éventuelles phases synesthésiques où l’on ne sait pas si l’on entend des sons ou plutôt des matières en mue, entre le solide, le liquide, le gazeux, voire le moelleux, le spongieux, le caoutchouteux, le velouté, le visqueux, le touffu, le moussu, le pâteux, que sais-je – Throbbing Pouch veut dire « poche qui vibre », ce qui peut évoquer le fœtus dans le ventre maternel, ou pourquoi pas le cœur, mais aussi un objet extra-humain qui existerait comme ça, autonome et vibrionnant, une sorte de bouillotte qui s’animerait soudain. Tout le disque est une aventure haptique autant que sonore, où chaque nouvelle séquence peut faire surgir de nouveaux êtres, comme dans un carrousel que l’on ne pourra jamais arrêter.
Outre ces expériences de laborantin en régression, occupé à manipuler du Playdoh et à arranger sa dinette, genre « j’ai 6 ans et je fais la cuisine pour ma maman avec tout ce que je trouve dans ma maison, y compris des choses non comestibles », Vibert réussit grâce à son travail sur les samples à nous faire traverser une enfilade de couloirs d’émotions et d’expressions. C’est une collection d’ambiances parfois très cinéma, tantôt carrément oniriques, qui semblent exhumées d’un inconscient pop et collectif (et très anglo-saxon), qui ont cette capacité à créer un effet de déjà-vu ou de déjà-rêvé, et qui prennent une profondeur unique lorsque Vibert les place en contraste avec ses arrangements synthétiques. Je pense par exemple à la ligne de basse quasi deep house d’un des derniers tracks du disque, « Yeah » (initialement sorti sur le EP At Atmos mais ajouté à la réédition de Throbbing Pouch), à la snare irréelle et pas du tout « organique » de « Down Under », ou encore à la vibe déformée et déformante d’un des « tubes » du LP, « Pull My Strings ».
C’est dans l’ensemble un disque d’une richesse presque infinie mais qui pourtant réussit à faire son job de disque de trip-hop normal, c’est-à-dire qu’il peut très bien s’écouter en musique de fond, pendant que vous buvez un verre avec des gens, ou pendant que vous êtes en train de bosser, ou de conduire ou de marcher : Throbbing Pouch a le don de pouvoir se faire discret si on le souhaite, mais si on le déclenche vraiment, il va lentement déferler comme une puissante, invisible et voluptueuse onde de bonheur intransitif. Et son approche souvent « décalée » et comique de la production le distingue beaucoup, comme le souligne cette notice de Fact écrite par Laurent Fintoni, du trip-hop qui se prenait au sérieux, façon Shadow ou Krush (que néanmoins j’adore). Plus exactement, ce n’est pas que Vibert fasse du trip-hop rigolo, second degré, « qui se prend pas au sérieux » : c’est plutôt qu’il assume que le potentiel psyché de cette forme musicale puisse l’orienter vers des choses qui relèvent de la fantaisie absolue, de l’absurde et du loufoque, d’une grammaire non-maîtrisée car relevant de langages informes et archaïques, de l’esthétique du collage qui, on le sait, tient autant de la subversion politique que du regard halluciné de l’enfant (il y a d’ailleurs un texte sur le regard enfantin chez Baudelaire, probablement écrit par un critique connu genre Gérard Genette ou Georges Poulet, mais je ne retrouve plus la référence, là, si ça vous dit quelque chose faites signe merci). Et ce côté enfant fou, pour le coup nettement plus Rephlex que Mo’Wax, est ce qui va continuer d’animer presque toute la carrière de Vibert, même s’il s’est toujours concrètement tenu hors de la braindance ou de l’expérimentation freak. Un entre-deux qui fait de lui un mec hors catégorie, c’est certain, un artiste joyeusement enfermé en lui-même, affairé avec ses propres lubies et intuitions, mais quand même amateur de bien des plaisirs qu’il importe de l’extérieur, comme une version britannique et stoner de Des Esseintes, le personnage de dandy ermite du fameux roman À rebours de Huysmans – celles et ceux qui ne connaissent pas ce livre, je vous encourage à le lire, d’ailleurs je me demande s’il n’a pas résonné particulièrement pendant le confinement. Sur des titres comme « Scrapes » ou « EZ Listener », on assiste ainsi à une sorte de contemplation-manipulation en direct de saveurs et de teintes, de parfums, de pierres précieuses, à la fois fétichisées et détournées de leurs présence et fonction premières. C’est tellement beau et tellement unique, je ne m’en remets toujours pas.
Pour finir je voudrais m’étonner (un peu à moitié, j’avoue) du fait que Vibert n’ait jamais produit de rappeur, puisque qu’en dépit de l’aspect psyché de ses instrus, ces derniers pourraient quand même souvent accueillir sans mal des couplets. On sent qu’en parallèle de la library, il a bien sûr rincé les beats du golden age new-yorkais, et je trouve que ce goût du « pur » groove hip-hop n’est pas moins présent chez lui que chez Shadow et Krush, même si ces derniers le revendiquent plus explicitement. Je me dis en tout cas que Throbbing Pouch pourra peut-être, même s’il a maintenant plus d’un quart de siècle, attirer la curiosité de fans de rap vers des rivages moins real mais pas moins fat – ni moins « lourds ».
PS : toujours de Vibert, je recommande méga chaudement les incroyables EP encore un peu trip-hop mais qui tirent surtout beaucoup vers la jungle, sortis sous le nom de Plug aussi en 1995, et qui sont peut-être encore plus trépidants et spliffés que Throbbing Pouch, mais carrément moins écoutables entre amis.