À la manière d’un rêve récurrent, à la fois précis dans les motifs qu’il arbore et flou dans ses contours, le premier album de Mouth Music joue un rôle particulier dans ma vie psychique musicale. Je suis tombé dessus dans les bacs de soldes d’un disquaire de Padoue il y a bientôt deux ans, et je ne saurais dire pourquoi le disque a pris une telle place dans ma vie. Peut-être y joue-t-il un rôle symbolique particulier, illustration saisissante de la « fortuitude » qui s’immisce parfois dans notre consommation culturelle effrénée ? C’est assurément l’un de ces disques qui viennent, de temps en temps, défier nos goûts à mesure qu’ils se sédimentent et remettre en doute les quelques certitudes qu’on commencerait à avoir vis-à-vis de notre identité culturelle. Je pense néanmoins que ma fascination pour cet album tient surtout au caractère idiosyncratique de la musique enregistrée par le groupe : rencontre surprenante mais qui se fait finalement assez naturellement entre un répertoire traditionnel écossais, le puirt à beul (littéralement « musique de bouche », « mouth music » en anglais) et une production sophistiquée et franchement futuriste. L’ensemble du disque, en juxtaposant démonstration technologique maîtrisée et célébration du folklore gaélique évoque les point and click steampunk et mythologiques qui ont marqué le milieu des années 1990 : qui a déjà passé des heures à tenter de résoudre les énigmes du jeu Myst aura sans doute de brèves réminiscences de l’archipel technologico-antique des studios Cyan Worlds en entendant les percussions midi de « Bratach Bana » ou de « Cone Mire Rium? ».
Le disque a d’ailleurs tout d’un rêve pour une génération de diggers et d’esthètes biberonnés aux compilations Music From Memory : il naît de la rencontre, autour d’un jeune producteur virtuose, de musiciens nord-américains qui, renouant avec leurs racines, s’installent en Écosse. Quand Talitha McKenzie emménage à Édimbourg, elle parle déjà gaélique, langue qu’elle a apprise en autodidacte durant son adolescence new-yorkaise ; Martyn Bennett apprend la cornemuse quand, avec sa mère, ils quittent le Canada pour s’installer dans les Highlands. On imagine assez facilement l’environnement intello folkloriste dans lequel ces musiciens ont dû grandir, et qui leur a sans doute permis de nourrir un amour égal pour les enregistrements ethnomusicologiques Folkways et les expérimentations folk électroniques de John Martyn.
Le producteur virtuose s’appelle Martin Swan et il est né à Sheffield, ville non pas écossaise mais anglaise, surtout connue chez nous comme le berceau du label Warp (dont je fantasme une secrète influence sur la musique de Swan). Il commence sa carrière en produisant des programmes en gaélique pour la BBC dont il compose et enregistre lui-même la musique. Cela explique peut-être l’aspect un peu brillant de l’album, qui rappelle les disques d’illustration sonore de l’époque. Mais surtout, cette production précise et singulière canalise avec élégance toutes ces énergies folkloriques tumultueuses, et son caractère idiosyncratique évoque davantage un producteur “auteur” de la trempe d’un Haruomi Hosono que des hommes de l’ombre de maisons telles que Bruton Music et KPM, ou des nababs de studios comme Stock Aitken Waterman, alors au sommet de leur gloire.
Le rôle joué par le producteur dans le projet est d’autant plus flagrant que tous les morceaux sont de pures réinventions en studio de chants traditionnels. Un peu comme lorsque John Coltrane revisite des chansons populaires sur My Favorite Things – et aussi, il faut bien le dire, lorsque Manau commet « Mais qui est la belette ? » –, ces interprétations technologiques et décomplexées offrent une expérience transcendante, peut-être parce qu’elles entrent en résonance avec la part primitive ou enfantine de nous-même, ou que sais-je encore. La beauté plastique de Mouth Music tient beaucoup à ces curieux effets de contraste : contraste entre d’un côté la dureté métallique des samples et des éléments digitaux, et de l’autre la douceur des cordes et de la voix, comme sur « Bratach Bana » ; contraste entre les sonorités nasillardes de la cornemuse et la douceur des nappes synthétiques ; et surtout, contraste entre des intentions musicales subtiles et des choix d’arrangements franchement bourrins. « Chi Min Na Morbheanna » en est un bon exemple : de magnifiques motifs de synthés, qui évoquent les morceaux de trance Goa les mieux produits de l’époque, laissent rapidement place à des violons de cinéma et des tambours conquérants ; on reste sur le qui-vive, prêt à voir Mel Gibson surgir à tout moment, le visage peinturluré, haranguant une troupe d’irréductibles Écossais en pleine montée de taz.
Pour en finir avec mes théories psychanalytiques fumeuses, je suis persuadé que ces interprétations contemporaines de chants séculaires agissent comme de puissants révélateurs de leur nature profonde. Elles interviennent de façon parasitaire dans une longue tradition de transmission orale, et cette petite rupture anthropologique rend saillant ce que des générations de chorales communales avaient fini par ensevelir sous des arrangements peu inspirés et des interprétations hésitantes : le caractère viscéral, chamanique et sans doute guerrier de ces morceaux. L’exemple le plus parlant est l’improbable banger technoïde « Seinn O! », reprise d’un chant traditionnel très connu en Écosse : débarrassé de ses habits poussiéreux d’air de fêtes de fin d’année, il retrouve toute sa splendeur. Finalement, la production acid house du morceau n’est pas seulement une coquetterie de producteur : elle met en lumière les vertus excitantes, entraînantes et enivrantes du puirt à beul.




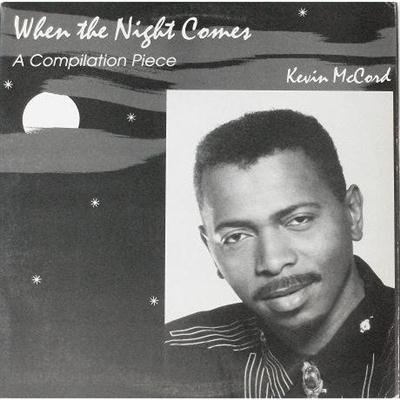
2 commentaires
Fabuleux. Merci.
Fabuleux. Merci.