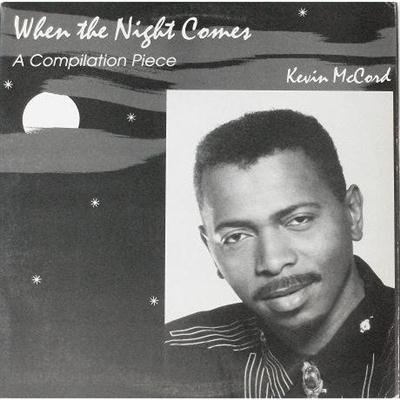Guillaume Échelard nous a déjà parlé du rap de Baton Rouge à deux reprises dans Musique Journal, en se concentrant sur le fameux style jigg et la jigga dance qui lui est intrinsèquement associée. On sait néanmoins que la scène hip-hop de la deuxième ville de Louisiane est loin de se limiter à ce phénomène : on connaît bien sûr la légende locale Boosie Badazz, et plus récemment Kevin Gates. En revanche, on cite moins un artiste qui a émergé au même moment que Boosie, pas moins doué que lui, mais qui n’a malheureusement jamais vraiment percé : Young Bleed. Né Glenn R. Clifton Jr., ce rappeur au flow virtuose quoique peu démonstratif a sorti pas mal de projets depuis vingt-cinq ans, mais c’est de son premier album, All I Have in This World, Are… My Balls and My Word, dont je voudrais parler aujourd’hui. Un disque qui avait fini disque d’or, sans doute en partie parce qu’il était sorti chez No Limit, le mastodonte de New Orleans fondé par Master P, à l’époque distribué par un autre mastodonte, le label californien Priority, dont le réseau couvrait l’ensemble du territoire états-unien. Mais My Balls and My Word n’a par la suite pas laissé une empreinte durable dans l’histoire du rap, sinon chez quelques cramés de son sudiste qui le considèrent aujourd’hui comme un classique ignoré, ou du moins comme un album plus qu’excellent, et donc très injustement sous-estimé.
Si Beats By The Pound, l’équipe de beatmakers de No Limit, a produit quelques instrus sur le LP, la majeure partie des prods sont signées Happy Perez, dont je n’avais jamais entendu parler jusqu’ici mais au sujet duquel je lis qu’il a récemment réalisé des titres pour Ariana Grande, Post Malone ou Miguel. Des « placements » très pop et très digitaux, qui ne sonnent pas du tout comme ce qu’on entend ici, derrière les couplets : ses beats pour le rappeur de Baton Rouge s’entremêlent avec souplesse aux cadences variables, inflexions subtiles et syllabes allongées qui font tout le sel du flow de Bleed – son playalistic drawl, comme le dit ce gars sur Reddit. C’est à peu près comme les prods de Mannie Fresh pour Cash Money dont je parlais au début de l’année dernière : on dirait de prime abord qu’elles sonnent un peu génériques, qu’elles manqueraient presque de caractère, qu’elles ne se déploient pas tout à fait assez, mais on finit par s’apercevoir qu’elles ne sont pas là pour se la ramener, mais plutôt pour servir les MC avec une infinie précision. Et lorsqu’on les écoute avec attention, on se rend compte qu’elles fourmillent de détails exquis dans le mixage et l’orchestration : même si on n’y entend pas de vrais instruments, il y a quelques solos de synthés (plus précisément de guitares synthétiques et des pianos synthétiques), des refrains chantés (notamment par Mo B. Dick et O’Dell, deux membres de Beats By The Pound), et une gestion des silences et des espaces qui fait ressembler l’ensemble à une œuvre live, ou du moins très vivante, très animée – ça chaloupe, ça s’enfonce, il y a ce feeling marécageux, qui peut parfois sonner limite jamaïcain dans son équilibre, et qui, même si c’est cliché de le dire, évoque l’atmosphère moite et pesante du bayou. Les percussions jouent parfois à changer de patterns au milieu d’un couplet, à faire bouger leur texture d’une mesure à l’autre, la voix de Bleed s’y déplace avec une musicalité très naturelle, c’est une vraie expérience audio au casque, pleine de nuances.
Et donc là dessus, Young Bleed impose son style en toute sobriété : une écriture pas forcément « ciselée » au sens littéraire ou poétique du terme, mais en tout cas un vrai don pour faire résonner et remuer les syllabes entre elles, allié à un sens de l’image et de la formule incontestable. Ce long article de Consequence explique que sa mère lui faisait lire de la poésie quand il était petit et on peut la remercier, car son fils a visiblement pris goût à ses lectures et ça rejaillit à peu près à chaque couplet.
Deux choses caractérisent son style. D’abord son élocution souvent proche du parler « normal » : on dirait qu’il raconte un truc à un pote à lui, et même lorsqu’il se lance dans des trucs « techniques » (comme sur « The Day They Make Me Boss », où il rappe en double time), il semble aimer retomber assez vite dans ce débit terre-à-terre. Je sais bien que ce n’est pas le seul rappeur à faire ça, mais en l’occurrence ça me frappe particulièrement chez lui car il a cette attitude qui semble nous dire que là il est en train de rapper, mais qu’il pourrait s’arrêter et juste être un mec des rues de Baton Rouge qui parle à un autre mec des rues de Baton Rouge, ce serait exactement pareil. Il y a un truc très accessible et prosaïque malgré la dimension « playa » des lyrics. Une dialectique typique de ce genre de gangsta rap réaliste, où la vie n’est jamais vraiment autre chose que de la survie, où la mort plane partout et où les relations entre les individus demeurent fatalement minées par l’argent, l’honneur et l’injustice sociale. Et on se dit que l’approche hyper « profil bas » de Young Bleed au micro témoigne de son humilité, mais aussi voire surtout de son dépit et son impuissance face à la situation qui est la sienne à l’époque – et qui n’a d’ailleurs pas l’air d’avoir beaucoup bougé quand on lit le portrait de Consequence.
L’autre truc que Bleed fait beaucoup, c’est d’inclure pas mal d’onomatopées et d’instrumentaliser les mots afin de produire de purs effets rythmiques : là aussi j’ai conscience que c’est une façon de faire très répandue dans la musique afro-américaine, mais comme Young Bleed s’en empare avec la sobriété qui fait sa signature, ça donne un rendu spécial. Et sur le troisième couplet de « Da Last Outlaw », un des derniers tracks, ça vire presque cartoon ambiance western (basée sur un sample du film Young Guns sorti en 1988, avec Emilio Estevez, son frère Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Jack Palance et Terence Stamp, ça c’est du casting !).
I’m tryin’ to knock yo’ ass up out the saloon
Cock, kaboom!
In a raccoon hat like Davy Crockett
Fuckin’ wit’ that opium, getting high as a rocket
And, um, rocket gonna blast, for playin’ with the trigger
Nigga, rocket put a cap in a nigga (boo-ya!)
Je pourrais analyser chaque morceau et louer la maestria de Bleed sur chacun de ses couplets, mais ce serait trop long alors je me contenterai de dire que, chose plutôt rare dans le rap, c’est un album qui se révèle particulièrement bon sur la fin : de « Lil Poppa Got A Brand New Bag » à « We Don’t Stop », c’est très impressionnant.
Tristesse et dignité, vantardise et vacuité, détachement et tragédie : cette dualité existentielle s’entend tout au long de My Balls and My Word et elle n’y est pas seulement incarnée pas Young Bleed, puisque sont invités d’un côté les Néo-Orléanais Master P, Mystikal, Fiend et Silkk Da Shocker (qui plus précisément se sont invités, le disque étant sorti chez No Limit) et de l’autre les collègues du groupe l’ayant lancé à Baton Rouge un peu plus tôt, et dont le nom aurait été validé par Freeze Corleone : Concentration Camp. Leur premier album, sorti lui aussi en 1998, s’intitulait dans le même esprit Da Halocaust, mais « étonnamment » il ne parlait pas du tout du génocide juif ni même d’antisémitisme, et j’ai envie de dire tant mieux, mais aussi : pourquoi ? Toujours est-il que C-Loc, Lee Tyme, Lucky Knuckles, Max Minelli et J-Von (qui forment tous deux un tandem du nom de Laylow, mais qui n’a pas rempli deux Bercy en quatre heures) se succèdent au micro et assurent bien. J’en profite au passage pour signaler que les connoisseurs savent qu’en 2000, alors que Bleed se concentrait sur sa carrière solo, Concentration Camp accueillera un nouveau membre, le jeune Lil Boosie, alors connu sous le seul nom de Boosie, qui publiera à son tour un album produit par Happy Perez, avant de rejoindre le label Trill Entertainment de UGK. Je ne vais pas refaire l’histoire, mais bref, Bleed n’a pas eu le même destin que son camarade et peut-être qu’il se dit qu’il est arrivé trop tôt. Mais qui sait, peut-être pas non plus, si ça se trouve il s’en tape ? J’ai le sentiment que ce genre de questionnement sur les carrières des artistes intéressent plus les fans que les intéressés eux-mêmes, et quand on y pense est-ce que c’est vraiment si génial d’être une star du rap ? Perso, je ne serais pas très épanoui si j’avais la vie de Kanye ou de Drake, ni même celle d’André 3000 ou de Juicy J. Bon, Tyler ou A$AP Rocky, à la limite, ils ont l’air de kiffer, ça j’avoue. Mais c’est aussi qu’ils ont su plus ou moins s’extraire de la compétition, en développant une identité et un « produit » qui dépassent le cadre du marché rap. C’est aussi ce que fait Kendrick, je crois, sauf que lui doit se sentir investi d’une responsabilité dont les deux hédonistes susmentionnés me paraissent dispensés.
Bon enfin, je m’égare, désolé ; je vous laisse écouter My Balls and My Word : ce qu’on peut dire avec certitude, c’est que Young Bleed peut être hyper fier de ce disque, car il est quasiment inusable, fabriqué avec un soin relax mais certain, et qu’il s’en dégage cette touffeur caractéristique, une sorte de violence sourde que seul apaise son flow proto-mumble rap, lorsqu’il fraye au travers des rythmiques tourbées de Happy Perez.