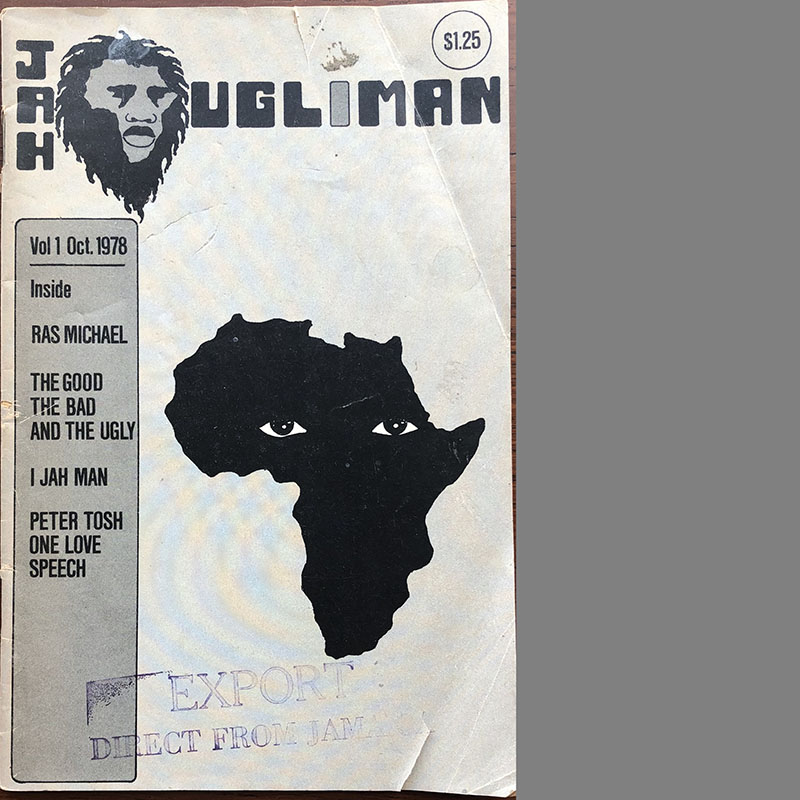Qu’est-ce qui se passe ? À quel moment sommes-nous ? Quel moment de la vie, quel moment de la fête ? Quel moment de l’histoire de la musique ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Des ado bien énervé·es font du stoner à 4 heures du mat dans une rave ? Une unité d’assaut acid-queer en action ? Et puis il y a quoi, après le club ?
La drum’n’bass, mais pas celle que tu crois – juste une section rythmique tellurique, sur laquelle pleuvrait une bruine mordante. La texture d’une voix pitchée, nimbée de fuzz, fusionne avec celle de cymbales ; traversant cet amas multidirectionnalisé, la basse, dure, recentre et enfonce. C’est comme un jeu de poule-renard-vipère, tout le monde court dans tous les sens et, au fur et à mesure, l’excitation fait perdre de vue les règles du jeu.
Il est 13 heures et je ne me sens toujours pas très réveillé, comme dans ces journées de lycée où on devait se lever beaucoup trop tôt pour jouer au jeu d’être assis pendant des heures, écouter d’une oreille le savoir dispensé par les services de la République, laisser son esprit vaquer à bien d’autres choses, ces rêveries granuleuses pour échapper à l’ennui. Regarder par la fenêtre. Être élémentaire et sans pare-feux, déborder d’une force vitale dévorante et difficile, si ce n’est impossible, à contenir. Il y a quelque chose de cela dans la musique de Donna Candy ; l’idée d’un rêve réalisé. Des années 2000 passées au dissolvant, qui en font flotter les couleurs, puis se réagencer d’autres manières. Former un groupe d’ado toujours rêvé, jamais fait. Je ne peux qu’être en empathie profonde avec ça, impressionné que d’autres l’aient réalisé.
Le premier ressenti en découvrant ce groupe – l’amie Morgane (Maraudeur, Tôle Froide), m’en avait parlé alors que je cherchais des groupes à programmer pour un Non-Anniversaire de GZ (lieu des musiques à côté de la plaque de l’aire urbaine lyonnaise), une soirée sobrement intitulée FARANDOLE AMBIENT PUNK NEO POST GRND ZERO 2021 – fut celui d’une fin de la nostalgie, surprenamment résolue et reprojetée, recontextualisée à l’orée d’un futur brûlant. Ce n’est plus le temps du son clair et des paroles explicites, mais celui de la texture et du son suggestif. Donna Candy n’a plus vraiment le temps de la didactique, et il s’agit de ressentir fort et différemment, maintenant.
Blooming sort aujourd’hui, édité par un quatuor de labels – à savoir : bison, Kraak, Isola Records, Swallowing Helmets – qui, dans leurs créneaux respectifs, ont su peut-être sentir que ce groupe répondait d’une façon très personnelle aux problématiques d’encroutages contre-culturels. Et de croûte terrestre, parlons d’activité volcanique.
Dans cette éruption, j’ai entendu du Boris, du Dopethrone ; quelqu’un a dit Melt Banana – oui, si on veut, mais alors temporellement bien distordu. On pourrait aussi parler de l’intrant Standard In-Fi, ou de l’intrant no wave, de Duma, de Guttersnipe, et donc d’AIDS Wolf, également, pour boucler la boucle lovecraftienne Skin Graft-isante. Il y a du Nu Metal, celui que tes potes mal à l’aise dans leur pompes auraient pu écouter devant le collège, à l’occasion d’un blocage, par exemple pendant le mouvement contre le Contrat Premier Embauche. Et puis rien de tout ça, en même temps. À vrai dire, cela m’intéresse moins de généalogiser – le désastre en cours dissout toute généalogie, surtout dans nos mondes de saltimbanques – que d’essayer de comprendre quels imaginaires sont suscités par ce geste, ce qu’on peut y déceler d’inédit.
Des formes familières donc, mais un peu inconnues ou oubliées, issue d’un trio extraterrestre. Une musique lourde et chaotique, mutante, en expansion ; une musique instantanée et à venir, portée par une voix impossible, synthétique et incarnée. Le féetaud ravagé d’un monde digitalo-mycélien dont les vocalises ne devraient pas irradier une telle violence (et pourtant), directement convertie en énergie viscérale, forestière et suante d’un cours de sport pas vraiment agréable.
Ce qui est étonnant, c’est que le disque conserve le potentiel d’anéantissement radieux des concerts (je vous implore d’aller les voir d’ailleurs, c’est une expérience irrésistible et décisive), entièrement, et qu’un enregistrement vraiment fin l’augmente, même. Le mixage, réalisé par la « mixmother » de tout un réseau, Anotine Nouel (avec l’aide de JS Donny, bassiste du groupe) dans son studio Sound Love, y est pour beaucoup. La spectralité – les fantômes qui surgissent mais aussi les caractéristiques sonores – prend ici une autre ampleur, c’est vraiment du beau boulot. « Blooming », tube interstellaire bien emo champignon, ouvre les hostilités en douceur, comme un être recroquevillé qui s’étirerait. Les matières s’y fondent, comme les émotions, portées par une ligne de basse simple et parfaite d’ergonomie. Dans la foulée, « She danced that night with the mare and she kissed the yellow teeth » porte l’intensité un cran plus haut, explose les référentiels tout en continuant la dérangeante narration entamée juste avant. Néo-heavy-metal, doom spatialisé, sludge, noise ou xénostoner ? On s’en fout : c’est une hybridité sans fond, nous amenant vers des saccades et des jeux d’obstination isomérisés.
Un bal en rase campagne plutonienne, des êtres gigantesques s’élancent et se rétractent, le groupe emblématique du bahut invité pour la fête de fin d’année : tout ça en même temps.
Et ça se poursuit sur « Beezz » cette torche incandescente à la lenteur viciée, ouvrant des abysses toujours plus profondes. On guette le moment propice. Des riffs, des breaks, un basculement : jouer avec la masse, le mouvement, la gravité. La distorsion non pas simplement pour épaissir mais altérer la fabrique des choses. La réactualisation du principe de l’alternance du son clair-distordu, mais en dehors de la forme couplet-refrain-couplet – des structures un peu plus post-rock, post-post-hardcore si on veut, « slint-esque », en tout cas. Un jeu entre la retenue et le lâcher prise reflétant assez bien l’oscillation entre rigueur nécessaire et vagabondage ; il y a là des pistes pour tenter de repousser les contours étouffants de conditions de vie resserrées, les déjouer par des façons d’être liquides.
L’autre face du disque est toute aussi lourde. Je pense à« H4T », festival d’élasticité météoritique avec son intro toute décomposée, rythmiquement et mélodiquement (bien sympa mais qui fout les foies, quand même), dont les assauts résonnent comme les cratères métalliques et massifs creusées par des gouttes d’eau faisant déborder un vase quantique, amenant le cerveau à rouler sur une pente douce et urticante. C’est ensuite le dyptique « Dizzy Breaks » qui vient clôturer le disque dans une apothéose extatique et menaçante : comme un lent rebondissement, une décomposition du mouvement. Un compost diamantaire renversé sur l’autoroute. Sacré. Je ne sais pas ce que c’est, mais ça l’est, exactement. Je vibre quand iels vibrent, de tout mon être. Cellulairement, même. Comme lors de ce concert vaudais où, saisi, je me changeais encore une fois en trépied-humain faisant voguer ma caméra au gré des ondulations sismiques se propageant depuis le groupe, positionné au milieu des auditeurs.
La voix alien, celle qui pousse l’aliénation en dehors de ses retranchements et dont la hauteur fluide atomise toute prétention identificatoire, harangue et se joue d’elle-même. Il y a quelque chose ici d’éminent contemporain, qui vient pourfendre les taxons pour les reléguer à la place de fétiches d’un autre temps – qu’ils auraient dû rejoindre il y a bien longtemps. Il n’y a plus de rock, plus d’électronique, plus d’avant idyllique, juste un maintenant vorace de possibilités. En ça, cette musique a quelque chose de politique, parce qu’elle cherche à déjouer les attentes et non à endormir. Une charge qui, quand tu la prends sur la tête, t’envoie en l’air plutôt qu’elle ne t’enfonce dans le sol. Donna Candy incarne, musicalement et en termes de représentation, une nouvelle radicalité incorporée et vécue sans forcément chercher à se signaler. A voir ce qui peut se passer quand la poussière retombe.
La stratégie de l’étrange pour percer à travers ce qui a déjà été fait. L’intuition vérifiée qu’à à peu près n’importe quelle vitesse, ce disque sera tout aussi magique, que cette lenteur révélatrice parsemée d’accélération et de décélération malaxantes, ressentie et non-objective ne s’évaporera pas. Que ce sera toujours une éclosion. C’est ça, la puissance de cette matière sonore à la fois visqueuse et sèche : entière, quelque soit sa vitesse de lecture. À un moment incertain où les choix restent ouverts, où l’on peut soit doom scroller, soit corps perdre dans une infinité de tentatives de s’extraire et de rediriger le désastre, la musique de Donna Candy frappe par sa poursuite d’une ligne de fuite bizarre, où l’abrasif permet de perdre quelque certitudes, où dans des rythmes bousculés des éclosions se profilent toujours. Nous ne savons plus, et c’est super : nous pouvons tout réinventer.


![Musique Journal - A Reminiscent Drive ou le field recording de la vie intérieure [Jay Alansky, épisode 3]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2023/04/musique-journal-cover-one-1024x1024.jpeg)