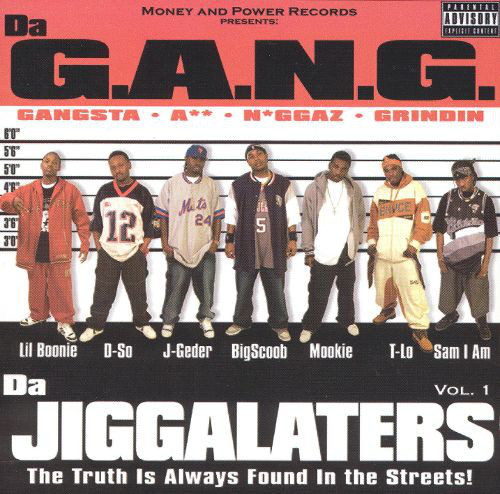L’accordéon souffre d’une mauvaise réputation à cause des stéréotypes roms ou franchouillards auxquels l’associe l’opinion publique, mais je vous garantis qu’entre les mains de Kodé di Dona vous entendrez complètement autre chose que l’idée cliché qu’on a tendance à se faire de cet encombrant instrument. De son vrai nom Grégorio Vaz, Kodé di Dona est l’un des pionniers du funana traditionnel, une forme musicale cap-verdienne que l’on connaît aujourd’hui surtout dans ses versions électrique et électronique, lesquelles mettent toujours l’accordéon au premier plan. Kodé di Dona se contentait quant à lui de jouer en acoustique, accompagné de sa seule voix et d’une percussion, le ferrinho, qui consiste ici en une barre de fer frottée à l’aide d’un couteau de cuisine – c’est l’un des fils Vaz qui en joue, José « Zizitou ». Mort en 2010, Kodé était devenu une légende sur son archipel, où son portrait illustre toujours le billet de 1000 escudos.
L’histoire du Cap-Vert est marquée par l’esclavage d’une façon bien particulière puisque les îles qui composent le pays étaient initialement désertes, et n’ont été peuplées que par les colons portugais et les populations africaines qu’ils y faisaient transiter ou travailler. Comme le raconte le collecteur des enregistrements et auteur des notes de pochette, Jean-Yves Loude, les conditions de vie y étaient si âpres que certains esclaves fuyaient les exploitations de canne à sucre pour se réfugier dans l’intérieur des terres, où ils vivaient en vagabonds, en fugitifs. C’est de cette figure que s’inspire Kodé Di Dona, lui qui a à son époque également combattu pour la liberté de son peuple face au joug portugais. Né en 1940, il a vécu la famine de 1947, puis a échappé à la fin des années 1950 à la déportation vers l’île de Sao Tomé. Il commence à cette époque à jouer de l’accordéon diatonique. L’indépendance de « Cabo » n’a été prononcée qu’en 1975, et depuis la tradition du funana ne s’y pratique plus dans la clandestinité qui lui imposait la colonisation.
Kodé chante la perte, la misère, la blessure, mais il peut aussi parler de cul ou d’amitié. Il a la voix d’un homme qui boit des alcools forts, il en a le ton aussi : il n’a pas du tout envie d’enrober son élocution, d’adoucir son timbre, c’est vraiment d’une « rusticité extrême », comme l’écrivait Francis Dordor dans Les Inrocks à la sortie du disque en 1995. Derrière sa voix, il y a donc son accordéon, dont le jeu reste pour moi un mystère : on ne sait pas vraiment s’il choisit quoi faire entre marquer le rythme, faire des harmonies ou déployer une mélodie. Mais ça n’a là non plus rien de très luxuriant, il n’y a aucun feuilletage sonore, aucune joliesse, ne serait-ce qu’un instant : c’est au contraire l’une des choses les plus brutales et les plus cahotantes que j’ai entendues de ma vie. Oubliez la mélancolie qui envape les cœurs et mouille les yeux, ici c’est une tristesse qui ne regrette même plus ses vieux rêves, et qui ne fait plus rien d’autre qu’être assenée par Kodé di Dona, presque sans affects saisissables. C’est de la douleur obtuse, intraitable. Mais en même temps, c’est une musique tellement contre-intuitive pour nous – en tout cas pour moi – qu’on distingue mal son début et sa fin : chaque chanson semble extraite d’un flux continu de désespoir légèrement différent du précédent, et ça donne à entendre comme un grand nuancier de couleurs terreuses.
Ce rapport potentiellement extensible à un temps sans reflets nous donne paradoxalement un peu de lumière : on ne sait pas trop où on va, on ne devine jamais bien la résolution, ça en devient libérateur. Et puis au fil des titres, on trouve des ressemblances, dans les cadences ou dans les riffs, avec le blues, le rock des débuts, même si ce sont probablement juste des correspondances externes, et non de véritables filiations. C’est de toute façon incarné d’une manière tellement éloignée de l’incarnation occidentale qu’on ne peut pas vraiment s’y attacher consciemment, activement : il faut juste répéter l’écoute, qui n’est pas du tout lassante malgré le côté apparemment minimaliste et répétitif du disque. Et vous verrez qu’au bout de quelques jours, ces enregistrements vous habiteront, non comme des présences que vous avez toujours connues, mais au contraire parce que vous laisserez passer en vous-même, avec un plaisir un peu sec, une âme profondément étrangère et inconfortante.