Il est disparu en 1990 des suites d’une vie à la marge. Une vie mouvementée, que l’on imagine remplie d’excès, parfois traversée d’une grande solitude mais qui l’a mené au sommet de la musique populaire uruguayenne. Un succès d’estime, qui ne lui évitera ni la pauvreté, ni le rejet de ses pairs, ni la mendicité. C’est une constante, chez ce genre de personnage : une intégrité sourde aux sirènes du gain, un goût pour le pas de côté, un caractère inégal doublé d’une pyromanie visant son propre destin.
Eduardo Mateo est né en 1940 à Montevideo, capitale de ce pays d’Amérique du Sud dont on ne connaît pratiquement rien, vu d’ici. Il prend une première claque musicale à la fin des années 50 en tombant sur le guitariste brésilien João Gilberto. Mateo embrasse la bossa-nova, monte un groupe, O Bando de Orfeo, prend une seconde claque avec l’arrivée des Beatles, monte un autre groupe, de reprises celui-ci, Los Malditos, puis encore un autre, The Nights. Pendant tout ce temps, il se perfectionne comme guitariste et chanteur, brule les scènes beat auxquelles il participe et se forge une belle réputation dans l’underground montévidéen.
La prochaine étape est la bonne : avec, entre autres, Rubén Rada à la composition, Mateo monte en 1967 El Kinto, groupe sur le point de changer la musique populaire de leur pays. Ensemble, ils agrègent dans des ritournelles pop le rock des Beatles, les canons de la musique traditionnelle uruguayenne, le jazz, la bossa-nova, les circonvolutions indiennes d’Harrison et les rythmes du candombe – musique percussive traditionnelle, originaire d’Afrique de l’Ouest et expression de la communauté noire de Montevideo –, le tout en espagnol. Naissait le beat candombe, ou candombe-beat, sorte d’équivalent du tropicalisme brésilien alors porté par Os Mutantes. Une fusion psychédélique, utopique, naïve même, nourrie par des quantités astronomiques de substances, d’un mélange heureux entre l’Occident et l’ailleurs. Le groupe ne survivra même pas trois années, mais aura le temps de faire de Mateo, Rada et tous les autres des légendes vivantes. En inventant un genre musical à la croisée des chemins, fier de ses origines, chanté en langue natale et regardant vers l’Ouest anglophone, le candombe-beat bouleverse le paysage musical populaire.
Ils laisseront un album testamentaire, Circa 68, magma halluciné de bossa-nova chantée en espagnol, de fuzz-rock tropical, d’afro-beat sud-américain, guidé par les voix de Rada et Mateo, leurs guitares et leurs percussions bien trempées dans l’acide.
Juste après cette expérience, Mateo se rend en Argentine et y enregistre de force son tout premier album solo. L’histoire raconte que c’est Diane Denoir, chanteuse argentine alors en session d’enregistrement pour son propre album et pour qui Mateo avait écrit plusieurs chansons, qui le convainc de venir en studio. Il ne se présente qu’à l’occasion fois, attendu devant son hôtel par l’équipe du label d’alors, Discos De La Planta, pour l’empêcher d’errer en buvant de tout son soûl dans la ville. Il est rarement en état de jouer quelque chose et quand il le fait, il faut l’empêcher de supprimer les prises qu’il rejette aussitôt. Carlos Píriz et Eduardo Rozas, les ingénieurs du son sur ce projet, laissent donc tourner les micros pendant des heures et recoupent ces longues sessions en treize titres qui formeront Mateo Solo Bien Se Lame. Ce qui, au passage, signifie plus ou moins « Mateo se lèche tout seul ».
Le disque sort en 1972 et fait figure d’ovni : une collection brute de chansons guitare-percussion-voix. Et c’est tout. Loin de l’exubérance d’El Kinto, ou des productions au cordeau des méga-tubes rock de l’époque.
À fleur de peau, Mateo chante, joue, parle. Il chuchote, il susurre, égraine des arpèges cristallins sur ce que l’on imagine être des ritournelles amoureuses. Mélancoliques, ces chansons atteignent des sommets rarement entrevus où il se livre, se dépose entièrement sur sa guitare. La folk, musique d’une sincérité intrinsèque, touche ici au magnifique. Oubliez l’esthétique lo-fi faussement fragile, où l’altération volontaire du son amplifie les émotions par un truchement. On entend tout, ressent tout, sur cet album. Les ratés, les cordes mal pincées et les accords qui déraillent, mais aussi la volonté de mettre, dans un éclair de lucidité, peut être pour la seule et unique fois de sa vie, ses chansons sur disque. Les accents bossa-nova de « Jacinta », l’aérien « Esa Cosa » ou le carrément larmoyant « Quién Te Viera » me renverseront à chaque fois.





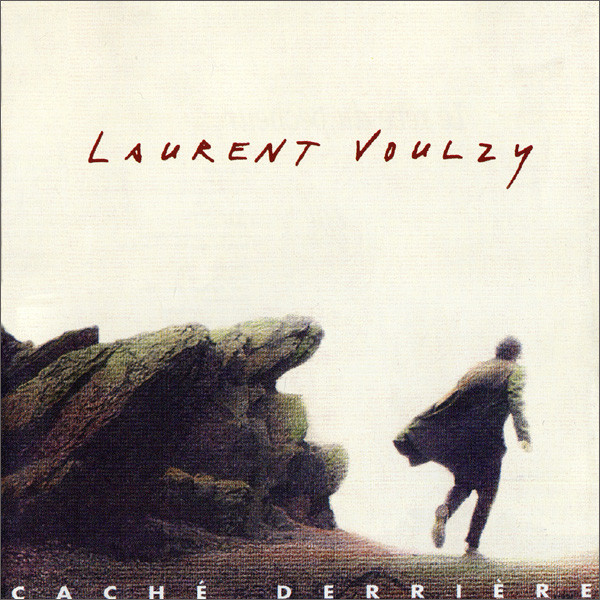
Un commentaire
Très belle découverte, merci Thibaut.
Hervé