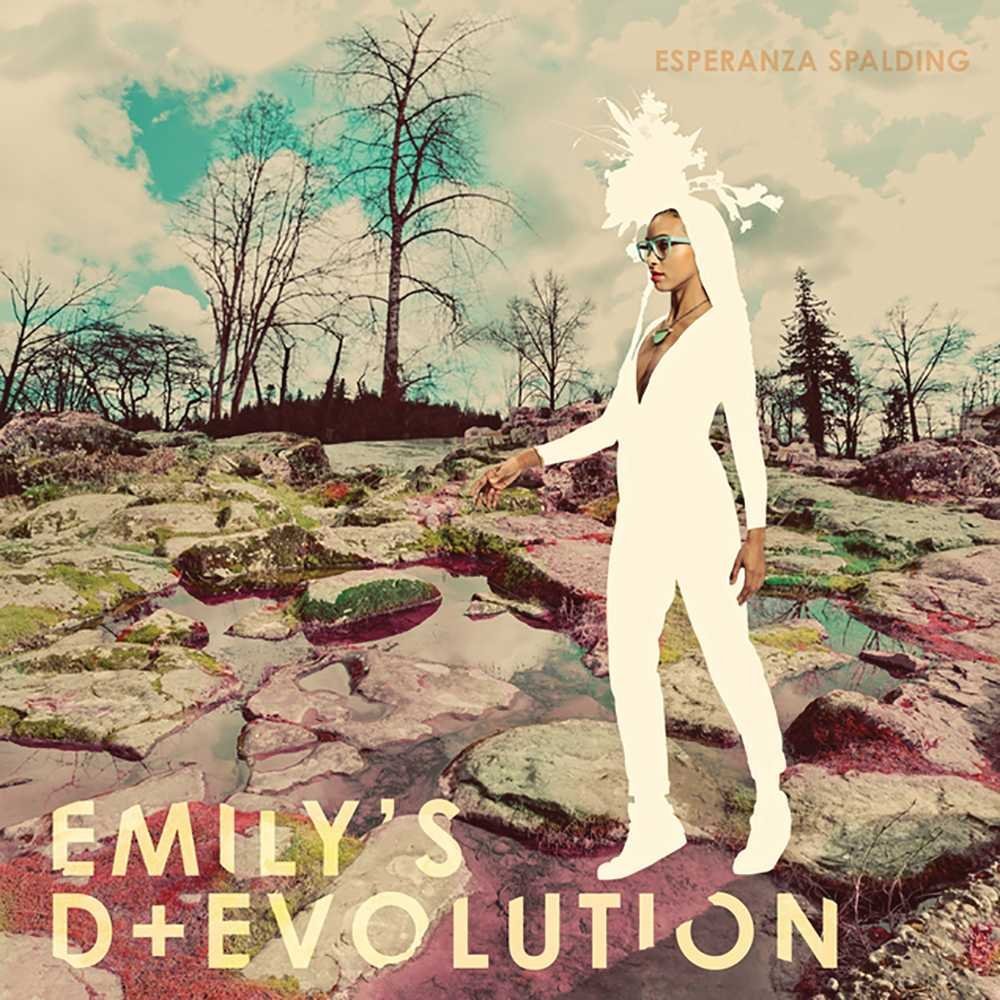Un jour j’irai demander à un.e vrai.e expert.e du R&B de me parler de tous ces artistes talentueux passés sous la vague de la grande validation du genre au début des années 2000, et qu’on devrait pourtant tous écouter avec la même admiration que Destiny’s Child, Aaaliyah, Brandy ou les Neptunes et Timbaland. C’est en tombant d’ailleurs sur l’émission « Slow Jam » de Générations 88.2, animée par l’un de ces experts, un certain Lorent (toujours en activité d’ailleurs), que j’avais alors découvert Mint Condition. Le groupe avait démarré au milieu des années 80 sous la houlette de Jam & Lewis, qui les avait signés sur leur label Perspective où ils pratiquaient un très bon R&B, parfois new jackisant, typique de cet époque. Mais s’ils étaient aidés de producteurs chevronnés, ces six jeunes hommes originaires du Midwest (Minneapolis, St. Paul, Chicago) formaient un vrai groupe de musiciens, mené par le chanteur Stokey Williams, et ça s’entend particulièrement bien sur ce quatrième album. Un disque certes plutôt conventionnel, comparés aux innovations majeures que vivait le secteur à l’époque, mais néanmoins hyper riche et extrêmement jouissif. On sent beaucoup de liberté malgré les contraintes formelles, et une volonté d’aller dans un délire « ça joue sévère, là ! » pour mieux traverser les nuances du spectre soul/R&B. Sur quasiment chaque plage, on devine une vraie joie et une vraie exigence à dépasser le cadre strictement commercial de leur catégorie, en se lâchant sur les arrangements très live mais jamais crispants. Ça va chercher jusque vers l’accordéon (« Spanish Eyes ») ou la guitare électrique (« Leave Me Alone »), dans un esprit zicos adulte, jazzy mais sans se la raconter. Cette fantaisie ne se dépare jamais d’une espèce d’honnêteté artistique, le groupe ne tente pas des choses qu’il n’aime pas ou ne sait pas faire, ce qui explique cet équilibre entre l’attendu et l’inattendu et qui fait de Life’s Aquarium un objet hautement pleasurable à écouter : les slow jams sont nombreuses et tellement chiadées qu’elles prennent cet accent prog-jazzy que j’aime tant et qui signe la qualité des studios américains de l’époque, ce son super pro qui brille avec sobriété (à la console on a le vétéran Prince Charles Alexander, et à la prod elle-même c’est le groupe qui gère) et ces petites incartades hors parcours qui ont l’air de caprices mais qui finalement deviennent indispensables au bon déroulement des opérations.
Tout n’est pas dingue en soi sur cet album et si vous n’êtes pas trop fan de R&B masculin tradi à la base, vous zapperez sans doute deux ou trois titres. Mais le disque reste quand même très consistant dans l’ensemble, dominé par des rythmiques parfois si aériennes qu’elles sonneraient presque dub, et marqué par des moments de bravoure tels que que ce morceau rock dont je parlais plus haut, ainsi que les deux singles « If You Love Me » (dont les arrangements de cordes sont signés Clare Fisher, une figure de son secteur qui a bossé avec Dizzy Gillespie, Herbie Hancock ou Prince) et « Is It Pain or Pleasure », mais surtout deux titres jumeaux qui, eux, n’ont étrangement pas été édités en singles, « Be Like That Sometimes » et « Who Can You Trust ». Deux tracks complètement dingues, qui s’inspirent sans vergogne du style Timbaland et de ses snares mitraillette, en y ajoutant une vibe moins futur et plus humaniste, pleine d’élans de voix et de fragments scat un peu caricaturaux, mais si savoureux. En fait, ce sont deux cas de plagiats qui améliorent, ou du moins qui enrichissent l’original plagié : la direction d’acteurs est plus ambitieuse que chez Timbo, puisqu’il y a plusieurs voix, et puis je ne sais pas comment bien le dire, mais je trouve les mélodies plus belles, plus subtiles, les nuances et l’énergie sont mieux dosées, même si ça ne veut pas dire que je dénigre ou minore le génie des cent chefs-d’œuvre de Timothy Mosley. Et je me demande en tout cas s’il y a eu dans ces années-là d’autres cas de productions « sous-Timbaland » qui muent en « sur-Timbaland », de la même manière que dans d’autres genres, les pompages des Beach Boys ou des Daft Punk par, respectivement, les High Llamas et Braxe et Falke, deviennent parfois limite plus kiffants que leurs modèles.
En tout cas vous me direz des nouvelles de ce disque de compromis vertueux, qui sonne tantôt comme de la nu-soul sans le halo spirituel et politique, tantôt comme du R&B « baby maker » de daron à col roulé, mais à col roulé très cher, et tantôt, donc, comme du Timbaland légèrement modifié et qu’on aurait évidemment aimé entendre développé sur la longueur d’un album, mais hélas non. Bon weekend !