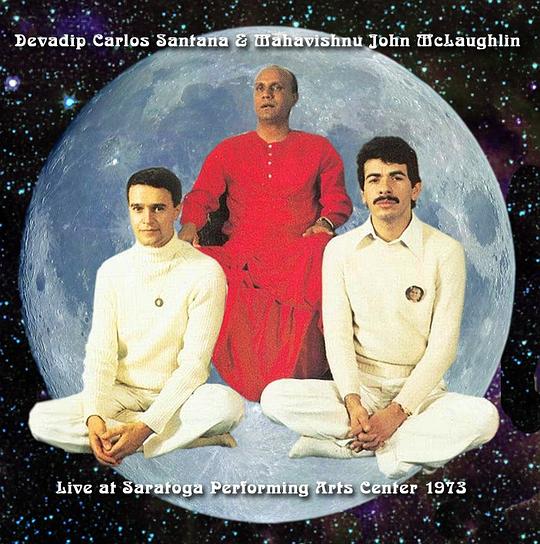Celle que l’on relègue bien trop souvent au rang des chanteuses pour enfants un peu nunuches est en réalité une figure incontournable dans l’histoire de la chanson française. Depuis ses débuts dans les cabarets rive gauche, ce sont ses propres textes qu’elle chante devant un public adulte, ce qui fait d’elle une des premières auteures-compositrices-interprètes françaises, inspirée par Nicole Louvier et suivie de peu par Barbara.
Les « fabulettes », ces chansons pour enfant qui connaîtraient un grand succès dans les écoles comme dans les foyers, elle ne les a jamais chantées sur scène. Les soixante ans de carrière qu’elle a fêtés en 2018 correspondent à six décennies de composition et de représentation au cours desquelles elle n’a cessé d’ « écrire pour ne pas mourir », comme le veut le titre d’une de ses chansons les plus connues. Ainsi est-elle devenue l’auteure d’un grand chansonnier, classique dans sa facture, mais audacieux dans son contenu.
À l’heure où son répertoire adulte semble susciter un regain d’intérêt auprès d’un public dépassant largement les férus de chanson française, nous vous proposons de nous pencher sur le détail de ses paroles afin de bien comprendre ce qui se joue émotionnellement, poétiquement et politiquement, dans ce chant.
En 1966, Anne Sylvestre est la première femme à entrer dans la collection « Poésie et Chansons » des Éditions Seghers. En 2016, Bob Dylan reçoit le Prix Nobel de littérature. Perso, je l’aurais plutôt filé à Sylvestre… mais à quel titre ? Celui de poète, elle n’en veut pas plus que Barbara. Au micro de Romain de Becdelièvre, elle déclare : « Je ne me compte pas parmi la société des poètes, et puis La Table des Princes, je ne connais pas. Je suis une roturière ». La poésie dont elle se démarque ainsi est celle qui lui semble gratuite ou hermétique, et surtout celle d’une aristocratie littéraire dont elle n’a que faire. On sait pourtant que la poésie peut être autre chose qu’une affaire de fioritures sibyllines, et que son histoire l’ancre dans le chant. Quand Sylvestre oppose au poème, « trop ouvert », la chanson qui se boucle et fait retour sur elle-même, comment ne pas penser d’une part à toutes ces chansons mal ficelées qui s’étiolent, et d’autre part à tous ces poèmes qui tirent justement leur dynamique d’un effet de boucle ou de ritournelle ? La différence se situe peut-être davantage entre deux façons de travailler la musique de la langue : « Le propre du chansonnier [la personne qui écrit des chansons], c’est que la parole chez lui soit à peu près inséparable de l’air. Un poëte lyrique a du nombre, de l’harmonie, de la mélodie; mais le chant proprement dit, l’air, il faut que cela dans la chanson accompagne, inspire, comme d’un seul et même souffle, la parole et ne fasse qu’un avec elle ». Sylvestre, chansonnière s’il en est, rappelle souvent que ses paroles lui viennent avec la mélodie, et bien qu’elles se prêtent sans problème à l’explication de texte, on ne les entend bien que sous leur forme sonore. Mais l’essentiel est peut-être, au fond, de distinguer les bons vers, qu’ils composent un poème ou une chanson, de « tout le reste », qui « est littérature ».
Les bons vers, cette « roturière » sait incontestablement les écrire — pour leur faire dire l’histoire des gens. Pas celle des « petites gens », encore moins celle des « petites dames », tournure que j’ai bannie de mon vocabulaire depuis que j’ai entendu « Violette » (2013), mais celle des gens tout court pour qui et surtout avec qui elle trouve les mots, tel un « écrivain public » . Il en résulte une œuvre monumentale (plus de 500 titres) à la fois d’une grande cohérence musicale et d’une incroyable variété qui résonne au quotidien dans la vie de ses connaisseurs.
Il me semble en effet qu’il y a, vraiment, une chanson d’Anne Sylvestre pour chaque situation. À l’abattoir, Joseph Ponthus chante « Carcasse » (1981) sous le poids de celles qu’il doit charrier. Une amie se dit qu’elle pourrait faire sa Clémence et se prendre des vacances (voir « Clémence est en vacances », 1977). Dans un e-mail où je fais part d’un léger doute, j’ajoute en lien « Les Gens qui doutent » (1977). Chaque fois que je passe devant l’ignoble statue que la municipalité nous a récemment collée sur les quais de Saône, cette énième divinité du vin cheveux aux vents, 95-80-95, jambes écartées façon double-page centrale, je pense à ces vers d’ « Une sorcière comme les autres » : « Je vous prie, ne m’inventez pas / Vous l’avez tant fait déjà », deux vers qui résument ma colère et facilitent non seulement son expression, mais aussi son partage, car je sens bien qu’ils résonnent, quand j’en parle, chez les autres, que des liens se nouent là, avec force, qu’ils se tendent et qu’il en naîtra la juste répartie.
Anne Sylvestre est aussi l’auteure d’un livre qui, lui, est de toutes les situations, de l’anniversaire à l’hospitalisation : Coquelicot et autres mots que j’aime (Points, 2018), série de courts textes dans lesquels elle déclare son amour à ses mots préférés. Ma botte secrète de libraire quand mes recommandations semblaient trop sombres, trop gauchistes, trop farfelues, trop élitistes, et surtout quand il fallait trouver quelque chose pour une personne malade ou endeuillée, défi bien connu du métier. Coquelicot : le seul feel good book que j’étais ravie de vendre, justement parce qu’il n’a rien à voir avec ce que recouvre habituellement ce genre, tout en étant véritablement abordable et réconfortant. Après deux ou trois moues sceptiques, le visage du client s’illuminait soudain au doux nom d’Anne Sylvestre, même si celui-ci n’évoquait qu’un souvenir lointain, souvent celui des Fabulettes, ces disques pour enfants qui ont quelque peu éclipsé le reste de son œuvre.
Il faut bien avouer, en effet, que les albums d’Anne Sylvestre sont méconnus du grand public. Elle compte bien sûr de nombreux aficionados, mais son public n’est pas celui d’un Brel ou d’une Barbara. On la pense encore souvent « chanteuse pour enfants », point barre. On refuse parfois de la compter parmi les grands noms de la chanson française, sous prétexte que de toute façon, on n’a jamais rien entendu d’elle, si ce n’est quelques ritournelles. Mais le succès des Fabulettes ne peut expliquer à lui seul ce malentendu tenace. Si Anne Sylvestre est toujours restée juste en deçà des feux de la rampe, c’est qu’elle s’est souvent retrouvée en décalage.
Le journaliste Raoul Bellaïche l’explique très bien : « Voilà une jeune femme qui débarque dans la chanson en pleine vague « typico-italienne » (Dalida et Marino Marini triomphent), qui amorce une carrière respectée dans l’équipe la plus prestigieuse du moment (l’ « écurie » Canetti-Philips) et qui, malgré un début de reconnaissance publique (un succès : « Mon mari est parti », l’Olympia, Bobino), subit brutalement, comme beaucoup de ses « semblables » (Anne, dixit), le contrecoup de la révolution yéyé… ». Elle rencontre alors de telles difficultés qu’elle manque de renoncer, bien qu’elle n’ait cessé d’écrire. En 1973, c’est un marionnettiste qui lui permet de remonter sur scène — une histoire aux allures de conte de fées sur laquelle nous reviendrons. « Depuis cette « résurrection », Anne n’a plus connu de traversée du désert, même si la fidélité du public ne lui fait pas oublier l’ignorance flagrante dont continue de faire preuve à son égard une partie de la profession… ». Quand la guitare électrique débarque sur la rive gauche avec Higelin ou Lavilliers, elle reste sur sa lignée. Sur le fond comme sur la forme, avec sa poésie narrative et sa guitare sèche, elle détonne sans être underground.
Ses chansons seront donc peu diffusées sur les ondes. Sylvestre raconte souvent comment, chez un brocanteur, elle est tombée sur un exemplaire de son premier 45t estampillé RTF, sur le macaron duquel était inscrit « À éviter ». Cette anecdote-là, elle n’en rit pas : la blessure semble encore ouverte. La diffusion de sa chanson antimilitariste « Mon mari est parti » (1963) alors que la France est en pleine guerre d’Algérie fait figure d’exception paradoxale. En 1985, elle chante triomphalement « Trop tard pour être une star », morceau de bravoure façon grand cabaret où l’on rit de l’entendre jouer les meneuses de revue et faire un splendide pied de nez à l’industrie musicale : « Trop tard pour être une star ! J’avais peut-être le physique, / Oui, mais le cœur n’y était pas ». Dans un entretien de 1999, elle explique avoir pris le maquis dans les années 1970 et n’en être jamais vraiment revenue : « Cette période de maquis a duré jusqu’à quand ?», lui demande Raoul Bellaïche ; et Sylvestre de répondre « Ben, je me demande si elle ne dure pas encore un peu… ! ». Sans avoir été officiellement interdite de radiodiffusion, ce qui lui aurait finalement fait une certaine publicité, Sylvestre a bel et bien été boudée des médias pour ses propos trop subversifs : « Il y a une façon d’interdire les gens qui est de ne pas les passer, c’est tout, comme ça le public ne sait pas que ça existe ». Une censure qui gagne à ne pas dire son nom.
Pourtant, peu de chanteurs peuvent se vanter d’une carrière aussi longue et productive, et Sylvestre compte de vrais fans : des inconditionnels de la chanson française ; les anciens des « fabulettes » qui se font chaque jour une joie de ne pas être passés à côté de ses disques pour adulte ; ou bien encore quelques individus paradoxaux qui ont le sentiment de constituer une société d’admirateurs secrets d’ordinaire occupés à organiser des soirées noise dans des lieux auto-gérés. Un phénomène notable caractérise ce fan-club hétéroclite : au-delà de quelques titres qui semblent faire consensus parmi nous tous (puisque j’en suis), tels que « Une sorcière comme les autres » (1975) ou « Lazare et Cécile » (1965), la liste de nos chansons préférées diffère tant d’un fan à l’autre qu’il serait difficile d’établir un véritable Top 10 représentatif. La discographie de Sylvestre est si foisonnante que chaque auditeur peut dialoguer avec elle à sa façon. Et pour chaque chanson, nous n’en retenons pas toujours les mêmes vers ni les mêmes idées. C’est dire qu’elle a la richesse de tout grand œuvre. Mais à quoi sa force tient-elle ? Pourquoi suis-je au bord des larmes chaque fois que j’écoute telle chanson ? Quel est cet élan qui m’emporte chaque fois que j’entends telle autre ? Tenter de répondre à ces questions sur le mode de l’explication de texte plutôt que sur celui de l’épanchement introspectif, c’est donner plus de visibilité au travail d’Anne Sylvestre, en cerner les ressorts et les enjeux pour dire ce que son lyrisme a de si fabuleux, pour voir comment son travail d’auteure s’inscrit dans la tradition de la fable tout en donnant une place aux femmes dans la chanson française.
***
Que l’on aime ou non Sylvestre, sa voix, son style, au moins deux choses frappent dès la première écoute et semblent indéniables : la qualité des paroles et des arrangements. Pour cette auteure-compositrice, la musique et les mots sont deux langages indissociables dans le temps de l’écriture, le texte ne venant qu’avec la mélodie, selon la dynamique des rimes. Elle produit donc, dans un premier temps, un écrit où la parole versifiée ne fait qu’une avec la mélodie. C’est alors qu’intervient l’arrangeur : François Rauber, pendant très longtemps, parfois Alain Goraguer, et plus récemment, la tout aussi talentueuse Nathalie Miravette. De François Rauber, on sait qu’il s’était formé autant dans les conservatoires que dans les cabarets, que sa passion pour le classique et la musique de chambre ne l’empêchait pas de travailler la musique descriptive, avec quelques sorties sur le label d’illustration sonore Auvidis, et surtout, qu’il était très sensible aux textes des chanteurs pour lesquels il travaillait. « Moi, la musique, je m’en fiche, il n’y a que les paroles qui m’intéressent ! », aurait-il lancé à Sylvestre un beau jour. Ses talents d’illustrateur sonore se ressentent particulièrement dans la subtile dramatisation de « Lazare et Cécile » (1965). C’est à lui que l’on doit aussi les envolées éthérées de « T’en souviens-tu, la Seine ? » (1965), la parfaite espièglerie des flûtes dans le refrain de « Clémence en vacances » (1977), le ton étrangement désinvolte de « Je te cherchais déjà » (1965) et plus d’un contrepoint bienvenu. On reconnaîtra par ailleurs la patte de Goraguer dans le jeu aguicheur et complice du xylophone qui ponctue « Agressivement vôtre ». Cette façon dont l’arrangement peut venir souligner quelques mots jusqu’à, parfois, entamer un dialogue avec la voix, Miravette sait aussi parfaitement en jouer, comme lorsque la clarinette tempère la dramatisation du chant et du piano dans « Violette ». Le contrepoint peut d’ailleurs aller jusqu’à l’ironie, comme dans le côté gentiment fleuri d’une chanson comme « Les Punaises » (1962).
Néanmoins, bien qu’ils gagnent à être découverts sous leur forme chantée, les textes de Sylvestre se suffisent à eux-mêmes. J’en veux pour première preuve le conte promis en introduction, celui de la parolière et du marionnettiste. En 1973, alors que le public français n’en a que pour les Yéyés, celui qu’Anne Sylvestre appelle « un Sicilien fou », le marionnettiste Salvatore Picciotto, va la convaincre de remonter sur scène et lui en donner les moyens :
« Il a loué le théâtre des Capucines pour y programmer de la chanson et m’a convaincue de présenter un récital. Je n’avais rien à perdre et ne pouvais d’ailleurs pas me permettre de perdre un sou. Mais il m’a rassurée : « Ça ne vous coûtera pas un centime, et si on gagne de l’argent, on partagera ». On n’a même pas signé de contrat, et il s’est décarcassé comme un diable. Le lendemain de la première, il m’a avoué qu’il ne m’avait jamais entendue chanter, il avait juste lu mes textes… »
C’est donc à la seule lecture des textes de Sylvestre que Picciotto a misé sur son talent, tirant à merveille sur les ficelles de la scène musicale parisienne : le public comme la presse ont été au rendez-vous, « et on a même gagné des sous ! », s’étonne encore la chanteuse en 1999. Sans pour autant rejoindre les rangs des grandes célébrités, Sylvestre ne tombera plus jamais en disgrâce et fondera sa propre maison de disques dans la foulée. L’auteure-compositrice-interprète devient donc également productrice, découvrant le plaisir de rester propriétaire de ses propres albums, de contrôler tout le processus depuis l’enregistrement jusqu’à la conception graphique des pochettes, et de chanter absolument ce qu’elle veut. C’est même de sa propre main qu’est né cet élégant logo qui fait en partie le charme des disques Sylvestre. Remise sur les rails par un petit coup de pouce, elle mènera donc sa carrière dans l’indépendance, de main de maître. Je ne sais si elle se dit heureuse, mais elle fit beaucoup de disques malgré ses enfants. De son côté, le marionnettiste à la sensibilité poétique s’est vu pousser quelques dents de loup… et si l’on s’imaginerait presque une marraine la fée devenue parrain, on se contentera de dire qu’il semble s’en être allé vivre au royaume des hommes d’affaires et des grands magnats.
S’il est une morale à cette histoire, c’est que le pouvoir de l’écriture est loin d’être négligeable : les paroles de Sylvestre ont un tel impact sur leurs lecteurs ou leurs auditeurs qu’elles ne sont pas sans répercussions. Cette efficace, elles les tirent sans doute d’un lyrisme propre à leur chansonnière. Le lyrisme d’Anne Sylvestre a en effet ceci de particulier qu’il est moins un lyrisme de la première personne, du « je » omniprésent qui s’épanche, que celui d’un chant pluriel. Dans des chansons d’une nostalgie ouvertement personnelle, comme « T’en souviens-tu, la Seine ? » (1965) ou « La Rochelle par la mer » (1965), elle s’éclipse en partie derrière des archétypes (l’artiste bohème, la bande d’amis…). Depuis ses débuts, elle raconte les aventures, les mésaventures ou tout simplement le quotidien de personnages éponymes : « Eléonore » (1962), « Jérémie » (1963), « Lazare et Cécile » (1965), « Thérèse » (1977), « Xavier » (1981), « Berthe » (2003), « Violette » (2013), pour ne citer que quelques exemples.
S’il s’agit là de portraits assez détaillés pour que ces personnages aient une vraie consistance, ces chansons sont aussi des fables, c’est-à-dire de courts récits allégoriques illustrant une morale souvent claire, sinon explicite, comme dans les vers qui concluent l’histoire de « Lazare et Cécile », figures des amours rebelles et marginales :
Toi Cécile, toi Lazare
Apprenez à votre enfant
Que jamais on ne sépare
Ceux qui s’aiment simplement.
La fabuleuse Anne Sylvestre transforme les faits en fables sans affabuler pour autant : « Non, non, je n’invente pas, / Mais je raconte tout droit » est le refrain de « Douce Maison » (1979), chanson sur le viol qui commence comme un conte (« C’était une maison douce, / Une maison de bon aloi, / Juste ce qu’il faut de mousse / Répartie aux bons endroits ») et qui, par la symbolique du saccage, dit la réalité de la souffrance et de la stigmatisation :
La maison, depuis ce crime,
N’a plus d’âme ni de nom,
Mais elle n’est pas victime,
C’est de sa faute, dit-on.
Il paraît qu’elle a fait preuve
D’un peu de coquetterie
Avec sa toiture neuve
Et son jardin bien fleuri.
L’air de rien, d’une voix si tempérée qu’elle semble incarner la mesure même, Sylvestre énonce ce que toute une société se refuse à voir, et elle l’énonce si clairement qu’elle n’a pas même besoin de le dénoncer. Sa colère n’affleure qu’in extremis, dans le dernier couplet, quand elle formule ce qui semblait déjà évident : « Il faut que cela s’arrête ». Ainsi révèle-t-elle les mécanismes de la violence patriarcale tout en reprenant les codes du conte et de l’allégorie, peut-être pour ce qu’ils ont de convenable et de partageable, comme un en-commun qui lui permettrait d’aborder ces sujets trop peu communément abordés à l’époque et encore aujourd’hui.
Parallèlement à la série des Fabulettes, ses albums pour adultes pourraient donc s’intituler Fables, Nouvelles Fables, Fabliaux… D’autant que parmi les premiers, peu d’entre eux portent un titre, à moins qu’il ne faille considérer la chanteuse comme à son tour éponyme (son nom est parfois la seule indication figurant sur le devant de la pochette), et donc comme un personnage parmi d’autres au sein de sa propre œuvre. Le même mot, « chansonnier », désigne d’ailleurs aussi bien le parolier que l’ensemble de ses textes, comme si les deux finissaient par se confondre dans une existence poétique autonome. En chantant ses fables, Sylvestre accomplit ce qui relève à mes yeux du tour de force : d’une part, donner une qualité lyrique à la troisième personne du récit allégorique, ses émotions transparaissant toujours dans sa voix bien qu’elle ne dise pas « je », et d’autre part s’effacer (en tant qu’individu, Anne la femme avec ses petites histoires à elle) quand elle s’exprime à la première personne, si bien qu’elle laisse toujours, d’une façon ou d’une autre, de la place pour les autres.
Que l’on pense à « J’ai le cœur à l’ombre » (1965), où la confidence se transforme en aphorisme :
Si ma bouche hésite,
Si je ne dis rien,
C’est qu’à dire vite
On ne dit pas bien.
Mais surtout à « Non tu n’as pas de nom » (1973), chanson dont le titre est d’autant plus poignant quand on sait l’importance que Sylvestre accorde aux prénoms. Ici, tandis que la lutte pour le droit à l’avortement bat son plein, Sylvestre chante à la première personne l’adresse d’une femme enceinte à ce qui n’est « pas un être », à ce qui ne peut relever que de l’innommable quand l’enfant n’est pas désiré. La grossesse, elle ne la nomme pas non plus : c’est « ça », cette réalité difficile et complexe éprouvée tant dans l’esprit que dans la chair. Alors que le lyrisme des poètes romantiques se voulait universel, c’est un universel plus particulièrement féminin qui s’exprime à travers le « je » de Sylvestre, pour défendre ses droits face à ceux qui font les lois :
Non, non, tu n’as pas de nom…
Savent-ils que ça transforme
L’esprit autant que la forme,
Qu’on te porte dans la tête,
Que jamais ça ne s’arrête.
Tu ne seras pas mon centre,
Que savent-ils de mon ventre ?
Pensent-ils qu’on en dispose,
Quand je suis tant d’autres choses ?
Puisque ce qui se cache derrière le « tu » n’a pas vraiment d’existence, ce chant s’adresse finalement davantage, bien qu’indirectement, aux patriarches visés dans les questions rhétoriques (« Savent-ils… », « Que savent-ils… »), ou aux hommes en général.
L’adresse sera directe, deux ans plus tard, dans « Une sorcière comme les autres » (1975) : « S’il vous plaît, faites vous léger, / Moi, je ne peux plus bouger ». Malgré la récurrence de tournures comme « S’il vous plaît » ou « Je vous prie », cette chanson de plus de sept minutes n’est pas une supplication. C’est bien plutôt une voix d’une grande force qui s’élève progressivement, mais sans grandiloquence, pour dire l’écrasement, l’épuisement, tout ce qui l’explique et surtout, ce qui permettrait de l’éviter. La chanson-fleuve devient finalement chanson-fresque, une véritable leçon d’histoire et de féminisme qui tient la distance de par sa justesse et son élégance, mais aussi parce que malgré sa longueur, elle ne dit pas tout : elle repose sur des ellipses, sur toute une imagerie littéraire permettant plusieurs niveaux de lecture, et sur un laconisme démoniaque.
L’élan d’ « Une Sorcière » est en effet celui d’une force subversive qui sourd au détour de certains vers pour opérer des retournements essentiels : précédé de « Ce n’est que moi », « C’est elle ou moi » n’est plus une histoire de jalousie et de choix, mais l’expression d’un en-commun, d’une ressemblance entre toutes les femmes ; suivie de « ou de hasard », l’expression « fille de rêve » n’a plus rien de figé ; « Il vous faut / Être comme le ruisseau / Comme l’eau claire de l’étang / Qui reflète et qui attend » n’est plus une injonction adressée à ces dames pour qu’elles se conforment à un idéal féminin tout aquatique, mais un appel à l’écoute, à la reconnaissance et à l’empathie adressé aux hommes. Cet effet de miroir qui pourrait être une première conciliation, elle le reprend un peu plus loin en maniant avec brio le chiasme, figure de l’inversion par excellence :
S’il vous plaît, soyez comme je vous ai
Vous ai rêvé depuis longtemps,
Libre et fort comme le vent,
Libre aussi, regardez je suis ainsi,
Apprenez-moi, n’ayez pas peur
Pour moi, je vous sais par cœur.
Toute la strophe repose en effet sur l’alternance « vous, moi » // « moi, vous », le premier chiasme faisant de la liberté le point de rencontre entre les genres, le second se combinant au magnifique effet d’écho entre « pas peur » et « par cœur », sorte de rime riche avec variation interne qui montre la ressemblance dans la différence, la possibilité d’une résonance harmonieuse, comme entre deux accords différents… À condition que l’on veuille bien apprendre l’autre au lieu de toujours vouloir lui apprendre ceci ou cela : cet « Apprenez-moi », où le « moi » est le complément d’objet direct du verbe et non le complément indirect auquel on pourrait s’attendre (apprenez-moi…quelque chose), coupe merveilleusement court à un rapport de domination très généralement intégré, où la femme est toujours disciple.
Si je cite ici les vers les plus riches pour le plaisir du commentaire, notons qu’ « Une sorcière » comprend aussi de longs passages parfaitement clairs et concrets :
Vous m’avez aimée servante,
M’avez voulue ignorante.
Forte, vous me combattiez,
Faible, vous me méprisiez.
Vous m’avez aimée putain
Et couverte de satin.
Vous m’avez faite statue
Et toujours je me suis tue.
Avec ses anaphores, ses distiques bien rimés et ses parallélismes entre des unités syntaxiques concises et simples, Sylvestre enfonce un peu plus le clou à chaque vers. Mais elle sait aussi rassurer son auditeur une fois passé le raz-de-marée des reproches nécessaires :
La mer à son tour divague
De violence inemployée
Me voilà comme une vague…
Vous ne serez pas noyé.
Les coupables sont épargnés car Sylvestre ne se contente pas plus de la vengeance que de l’indignation stérile. Avec « Une sorcière », elle espérait expliquer aux hommes « comment ça marche, ce qu’il se passe », c’est-à-dire établir un dialogue avec un public masculin auquel on ne l’associe pas forcément, mais qui est pourtant, lui aussi, le sien.
Il semblerait que la sorcellerie ait parfois opéré : « Une fille m’a écrit une fois : « Tu comprends, va expliquer tout ça à ton mec, ben non, tu n’y arrives pas. Alors tu le prends, tu l’assieds, tu lui mets Une sorcière et là il comprend ! » ». Efficace, la Sylvestre. Avec des paroles accessibles mais pas simplistes, tantôt explicites, tantôt tout en suggestion, qui font la part belle aux émotions sans se complaire dans l’épanchement, car malgré sa durée, « Une sorcière » est un magnifique exercice de concision. On pourrait la rapprocher de « Liberté-Femme, Ballade des Dames du Temps Présent » (1972), de la non moins talentueuse mais peut-être encore plus méconnue Hélène Martin, ne serait-ce qu’en raison de leur durée, de leur sujet et de l’hommage que Martin rend à sa consœur en la comptant parmi les Dames qui marqueront leur temps. Néanmoins, ces deux morceaux de bravoure ne sont pas du même registre : la ballade jazzy de Martin s’apparente à un discours dont le préambule un peu long est suivi d’une série d’hommages particulièrement pertinents dans le contexte de la lutte contre l’invisibilisation des femmes, mais aussi très datés. Dans l’ensemble, et bien que je vous invite à découvrir les talents de Martin, « Liberté-Femme » n’a ni la dimension atemporelle, ni la charge émotionnelle qui font d’ « Une Sorcière » un chef-d’œuvre de la chanson.
C’est à dessein que j’emploie le terme de « charge », car il me semble que le lyrisme de Sylvestre peut justement faire l’effet d’une décharge, avoir l’impact d’un explosif, ou bien encore être « à charge », sans pour autant verser dans le réquisitoire ad hominem. En 1981, suite à la médiatisation d’un infanticide, elle récrit l’histoire de Rose, seize ans, fille-mère victime du manque d’éducation sexuelle. Chassée par son père, rejetée par son ami, condamnée à la solitude comme à la misère, elle finit par tuer l’enfant dont elle n’a pu avorter. Sylvestre se fait l’avocat de la défense, alexandrins à l’appui :
Vous allez la juger du haut de votre tête,
Monsieur le Président et Messieurs de la Cour ;
N’oubliez pas, surtout, qu’avec nous tous vous êtes
Coupables de silence et de manque d’amour.
À l’écoute de ces chansons « chargées », le partage des émotions s’accompagne d’un élan, d’un mouvement qui ravivent le sens étymologique du verbe émouvoir (déplacer, ébranler) et rappellent qu’en latin, un seul mot, motus, désignait aussi bien les mouvements de l’âme que ceux de la foule en colère.
Il y a là une forme d’engagement, mais les chansons d’Anne Sylvestre ne ressemblent pas aux chansons « engagées » de l’époque, celles d’un Léo Ferré ou d’une Colette Magny. On n’y trouve ni la grandiloquence ni les cris du cœur associés au genre, et Sylvestre ne se revendique d’aucun mouvement politique. Elle annonce la couleur dès 1968, avec sa « Chanson dégagée » :
Y en a qui voudraient que je porte
Une oriflamme ou un couteau,
Que je crie et que je m’emporte,
Mais faudrait qu’ils se lèvent tôt.
Dans la « Nuit rêvée » que France Culture l’a invitée à programmer en 2013, elle révèle la finesse de sa stratégie : « Ne pas pousser de cri mais énoncer les choses, comme ça, a minima, parce que le texte est resserré, je trouve que c’est une façon de crier ».
C’est ce que nous avions commencé d’entrevoir dans notre analyse de « Douce Maison ». « Non tu n’as pas de nom » est, quant à elle, une chanson sur le choix d’avorter plutôt que pour l’avortement. Sylvestre parodie d’ailleurs la platitude discursive du chant partisan façon tract dans « La Vache engagée », dernière piste de l’album qui s’ouvre sur « Une Sorcière comme les autres » et qui paraît au cours de l’année 1975, déclarée « année internationale des femmes » par l’ONU. En se campant en porte-parole des défenseurs des droits des vaches, Sylvestre parvient à interroger sérieusement le rapport entre condition animale et condition féminine tout en faisant rire des beaux discours et des fausses solutions. Son ironie est d’une efficacité, d’une intelligence et d’une audace réjouissantes :
On va réunir un congrès
Sur la condition des vaches.
Le président sera le boucher,
C’est intéressant, qu’on le sache !
Les vaches n’ont plus de souci,
Au laitier, au boucher, merci !
Elle serait tout aussi audacieusement et exceptionnellement invitée à chanter sa chanson face à Françoise Giroud, première secrétaire d’État chargée de la Condition féminine, en direct sur Antenne 2 :
« Lorsque cette année de la femme a touché à sa fin, […] Bernard Pivot a fait une émission le 30 décembre 1975 qui s’appelait « Encore un jour et l’année de la femme, ouf, c’est fini ! » ; son invitée était Françoise Giroud. Et comme Pivot est assez malicieux il m’a invitée à venir chanter La vache engagée, c’était une émission en direct. Donc voilà, je chante ma Vache engagée devant Madame Giroud qui le prend mal et qui, à la fin de la chanson, fait une réflexion désagréable à mon endroit. Alors je suis partie, j’ai quitté le studio en direct, j’ai dit à mon contrebassiste : « Tu viens ? On se tire ! ». Et on est partis comme ça. Eh bien oui je suis partie, je me suis fait peut-être du tort là aussi. Pivot, ça l’a beaucoup fait rire, mais il ne s’est pas rendu compte qu’il m’envoyait carrément au front. La dame n’avait pas beaucoup d’humour… »
Il faut croire que Giroud n’avait pas plus de perspicacité que d’humour, car au fil de leur échange, face aux arguments que Sylvestre expose contre l’existence d’une « année de la femme », elle l’accuse, sourire mielleux aux lèvres, de tenir des propos misogynes.
L’engagement d’Anne Sylvestre se joue au-delà des programmes et des logiques partisanes ou militantes, dans un rapport d’amour et d’honnêteté envers les autres, qu’elle ne prend jamais pour des imbéciles. Son « désengagement » l’engage, finalement, à réfléchir, à penser ce qu’elle dit : « Les gens qui doutent, c’est aussi une chanson engagée. Finalement, elles le sont toutes. De toute façon, pour moi, si ça ne veut rien dire, ça ne m’intéresse pas. À partir du moment où l’on pense, on est engagé, il me semble… ». En racontant des histoires où la pensée se marie à l’émotion et la parole à la musique, elle parvient à ouvrir, chez l’auditeur, une faille où se fiche un levier, comme pour faire bouger un peu les choses là-dedans, à l’intérieur.
Il me semble que c’est ce mouvement de bascule qui explique le pouvoir « subversif » que Sylvestre voit dans la chanson sans pour autant se leurrer, car elle sait bien qu’une chanson ne peut changer le monde. Il s’agit plutôt d’un effort de longue haleine, d’un travail de sape au compte-gouttes pour faire la guerre aux idées reçues, à ce « on dit » qui revient si souvent dans ses textes, mais aussi d’un travail de concertation pour construire d’autres rapports. Sa collègue France Léa se dit « renversée » toujours au même tournant dans « Une Sorcière », avant d’affirmer que ses chansons ont pu faire naître un sentiment de « sororité ». Bel exemple de la façon dont l’intime est subversif et politique.
Cette intimité, répétons-le, n’est pas celle d’une personnalité qui déballerait sa vie privée, mais celle d’un « je » poétique ou celle de personnages qui, s’ils peuvent nous sembler plus vrais que nature, sont bel et bien fictifs. C’est que Sylvestre excelle au jeu de la dynamique des contraires, du détour et du décalage. Sa belle « Carcasse » (1981) rejoue la dialectique du corps et de l’esprit en faisant du pronom « on » l’équivalent de « mon corps et moi ». À la fin des années 1980, son récital piano-voix avec Philippe Davenet s’intitule Détour de chant. En matière de décalage, sa « Java d’autre chose » est terriblement marquante : elle y évoque les pires histoires de famille sur les envolées guillerettes d’un accordéon plein d’entrain. Autant de contrastes et de sinuosités qui font, eux aussi, la dynamique de son chant.
Je me réjouis par ailleurs de l’entendre faire le grand écart entre des tournures tantôt précieuses ou désuètes et des expressions familières, voire de véritables grossièretés. Quand son « Petit bonhomme » (1977) se recase après s’être fait plaquer par sa femme et par sa maîtresse, il y a quelque chose de particulièrement jouissif dans l’avertissement « Mais ça ne va pas durer / Quand il l’appellera Bobonne, / Elle va se tirer », d’autant que l’écart de registre est précédé d’un léger rire délicieusement mesquin, puis souligné par la voix qui marque bien chaque syllabe de « se tirer » sur trois temps. Et tandis que le petit bonhomme (non non, il ne mérite pas de nom) traite son épouse de « conne », Sylvestre affirme sur le même album, à propos des « gens qui doutent », « J’aime leur petite chanson, / Même s’ils passent pour des cons », avant d’ajouter :
J’aime les gens qui doutent
Mais voudrais qu’on leur foute
La paix de temps en temps […]
Qu’on leur dise que l’âme
Fait de plus belles flammes
Que tous ces tristes culs.
Aujourd’hui, « triste cul » peut rejoindre haut la main le rang des insultes non discriminatoires, aux côtés de « sac à merde » et autres « raclure de bidet ». À l’époque — pourtant déjà la fin des années 1970 — il n’était pas convenable qu’une femme dise des gros mots. Alors que Gainsbourg pouvait se lâcher, on déconseillait à Sylvestre d’en faire autant sur les écrans. Après les difficultés rencontrées dans l’émission de Pivot, elle devrait en effet batailler pour chanter « Les gens qui doutent » sur un plateau télé.
Écarts de registres ou de tons, contrastes ironiques, pensées dialectiques… D’écart en écart et d’un contraire à l’autre, les textes de Sylvestre sont comme mis sous tension. La longue ouverture a cappella de « Sur un fil » (1981) met bien en évidence cet art de négocier l’équilibre : Sylvestre entre en scène sur la corde raide, sans filet, tandis que nous retenons notre souffle jusqu’à ce qu’elle ait fini sa traversée. Et tout là-bas, en hauteur, c’est aussi dans la distanciation qu’elle trouve son équilibre, qu’il s’agisse de réinventer son quotidien ou de récrire l’actualité.
La distance est d’abord maintenue, me semble-t-il, par le classicisme d’une écriture en vers rimés qui se teinte même parfois d’un archaïsme à ne pas « confondre avec un quelconque passéisme », comme le précise à juste titre Laurent Luneau. Elle évoque par exemple la figure de la « maumariée » (la mal mariée) dans la chanson du même nom d’abord interprétée par Reggiani en 1968. Dans « Lazare et Cécile », elle reprend une imagerie médiévale tout en évoquant un monde étrangement familier, celui des parias de tout temps. On notera aussi cette façon qu’elle a de prononcer les « e » muets à la fin des rimes féminines (des mots comme « inconnue » ou « statue » deviennent « inconnu-eu », « statu-eu »…) ainsi que les « h » muets placés en début de mot, une particularité qui lui permet d’éviter le hiatus (succession de voyelles que la poésie classique considère comme une dissonance) : « Je veux contre toi toujours me heurter » dans « Tiens-toi droit » (1963), « Et sur la branche d’un hêtre trouver Lazare pendant » dans « Lazare et Cécile » (1965), « Fille de rêve ou de hasard » dans « Une sorcière comme les autres » (1975)… Si cette diction peut avoir quelque chose de désuet, voire de conservateur, je ne peux m’empêcher d’y entendre l’équivalent phonétique de ce que Sylvestre accomplit sur le plan politique : faire entendre ce que l’histoire (d’une langue ou d’une société) a réduit au silence.
***
Que l’on ne rate pas, donc, l’occasion de s’émerveiller d’une écriture à la fois limpide et sinueuse, qui sait emprunter quelques détours, faire quelques pas de côté pour aller là où il faut, là où elle se doit d’aller. Car il y a bien, chez Sylvestre, une sorte d’exigence constante qui relève de l’éthique. Elle témoigne, elle rend compte de réalités précises, et cela n’enlève rien à la beauté de son chant, dès lors doublement juste : c’est cette justesse mélodique et verbale qui lui permet de rendre justice. Loin de tout dogmatisme, son féminisme s’affirme dans son énonciation même, dans le fait de chanter les histoires qu’elle chante au moment où elle les chante, comme elle les chante. Son engagement n’est pas celui d’une lutte pour une cause, mais celui d’une présence et d’une adresse. Elle est là. Et elle vous parle, avec autant d’art que d’intelligence, sans même avoir besoin de s’en prendre aux codes de l’écriture musicale ou poétique pour être subversive.
Le détail de sa longue carrière aux allures de ligne droite révèle un parcours tout en boucles, en contrastes et en tangentes, avec ses répétitions nécessaires, ses montagnes russes du rire aux larmes, du doux souvenir à l’amère colère, et ses ellipses qui en disent long. Si je reviens régulièrement vers ses chansons, c’est qu’elles ont toujours quelque chose de profondément galvanisant, comme si elles échappaient à la gravité tout en abordant les sujets les plus graves. « Moi, je ne peux plus bouger », notre sorcière répète-t-elle… et pourtant quel élan, quel mouvement. S’il est une distinction qu’Anne Sylvestre mérite encore plus qu’une couronne de lauriers, c’est peut-être un Grand Prix de sorcellerie.