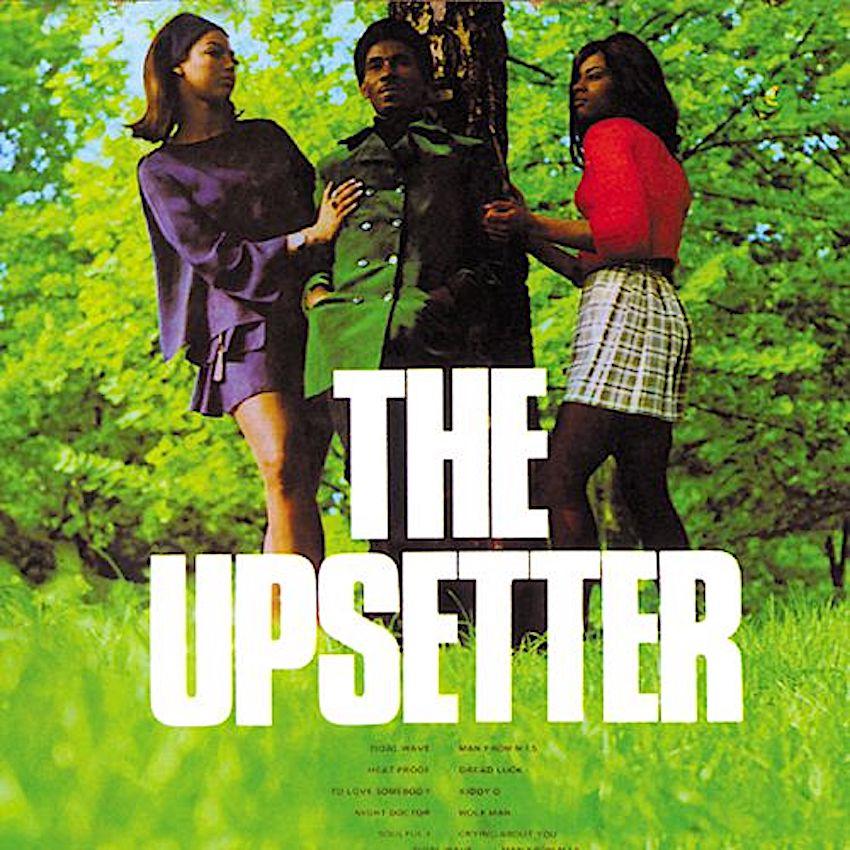Son écoute a beau avoir poussé le guitariste Davy Graham à populariser l’un des accordages alternatifs les plus connus du monde (le DADGAD) dans les années 1960 – où il creuse particulièrement les basses et transforme le son de l’instrument –, le oud n’a, jusqu’à aujourd’hui, pas vraiment bénéficié d’explorations aussi excitantes (dans l’optique occidentalo-centrée d’une musique mondialisée) en retour. Cantonné à une communication en vase clos où se saluent sans cesse la guitare, le rock (Mehdi Haddab, DuOud) et le jazz-musique du monde (Dhafer Youssef), le oud a vécu peu de frictions convaincantes ; il est d’ailleurs notable que les rares oudistes-explorateurs ayant frayé avec les musiques électroniques l’ont fait surtout par le biais de collaborations, où le oud reste souvent oud à côté d’autres instruments considérés comme moins « traditionnels ». L’œuvre de Kamila Joubran, rare oudiste femme de sa génération, et Werner Hasler, avec leur Wa passé presque inaperçu en 2020, en représente le mariage le plus convaincant à ce jour. Joubran y « déjoue » largement l’instrument tout en laissant son cœur et son aura inchangés.
En vacance des maqâms et de l’univers complexe (voire ésotérique) d’une musique arabe parfois difficilement pénétrable par son versant théorique, l’artiste libanaise Youmna Saba se place dans cette continuité exploratrice, notamment via l’utilisation d’un dispositif technique réalisé en collaboration avec un spécialiste de lutherie augmentée (Nicolas Canot), « extension digitale » lui permettant d’aborder le oud d’une façon inédite et détournée. Le répertoire sonore de l’instrument s’ouvre ainsi, intègre des sons habituellement considérés comme parasites (frottements, vibratos, attaques à la main droite ou gauche qui accompagnent le jeu) mais permet aussi la synthèse électronique. Son dernier album, Wishah (« voile »), sorti en octobre sur le vénérable et mythique label anglais Touch, illustre parfaitement les possibilités nouvelles de ce oud hybridé : l’ouverture « Akaleel », par exemple, joue sur des appogiatures typiques, avec allers-retours rapides au doigt, et finit par les amplifier et les métamorphoser jusqu’à les épaissir en une masse sonore écrasante. Il y a dans l’œuvre de Saba un souci du son en tant que matière qui traverse tout, s’enracine partout : dans l’utilisation de la langue arabe et de ses phonèmes particuliers, ou dans cette « réserve des non-dits », recherche menée au sein de la collection instrumentale inerte et muette du Quai Branly.
L’air de rien, Saba s’attaque au logiciel historique du oud en tant qu’instrument : d’habitude difficile à faire émerger au sein d’un ensemble, difficile à sonoriser – un récent travail du oudiste et chercheur Aderraouf Ouertani en parle en détail et avec amour –, Youmna Saba en utilise ce qui est souvent perçu comme une série de défauts pour le transformer en instrument électro-acoustique, en jouant notamment sur des dispositifs de larsen maîtrisé, comme lorsqu’elle a placé le oud face à 6 voix et travaillé sur leurs résonances dans l’instrument. À le faire sonner ainsi (et rejoindre parfois un son de contrebasse comme sur « Al Khayal »), elle s’affranchit de la vision essentialiste s’étant largement diffusée ces cinquante dernières années en Europe ; un oud justement dénué de bruits, suspendu dans une logique de pureté proche de la musique baroque, où chaque note résonne et doit rencontrer le silence du public.
Un cloisonnement persiste en effet entre cette vision d’un oud « de récital » emprunt de solennité, à la Mounir Bachir (et d’autres moins connus, comme le montre le très beau coffret, à la sortie malheureusement rendue invisible par le Covid-19 / plombée par un titre passe-partout, « un voyage avec le oud arabe », réalisé par l’association AMAR) et une autre manière d’apprécier et de pratiquer l’instrument, celle entre autres incarnée par l’Égyptien Cheikh Imam – auquel France culture consacrait en 1984 un documentaire fabuleux, dont le format, 1 h 22, et le montage perturbent avec bonheur le calibrage des oreilles de podcasts. Un oud de chansonnier qui, dans les cabarets et les soirées, se fait entendre au forceps avec un son parfois sale, apparemment moins noble et en vérité discrètement technique ; comme Brassens à la guitare, et comme lui souvent uniquement ramené au texte et au contexte, à savoir pour Cheikh Imam le fait d’être né dans une famille pauvre, aveugle, d’avoir été en prison, et d’être associé à la gauche arabe de l’époque.
Youmna Saba ne met pas en avant un parcours politique ou traumatique, mais elle conserve de cette dernière école ce superflu essentiel et notamment ce rapport au chant et cette voix constamment placée au-dessus d’un espace sonore saturé, timbre magnifique qui émerge en ligne claire de ces amas. Là où Kamilya Joubran déconstruirait, Youmna garde la mélodie. Si elle évite l’accompagnement canonique joignant mélodiquement les lignes du chant et du oud, joue parfois des presque-clusters en guise d’accords (« Ahad »), il y a ici beaucoup d’écriture rapprochant ces explorations bruitistes de véritables chansons – dans la continuité du très beau « 40-1 » de son précédent album.
Épaulée par Fadi Tabbal, homme de studio et clé de voûte d’un son beyrouthin de classe internationale depuis plusieurs années, Youmna Saba confirme ici tout le bien qu’on pensait d’Arba’een (2017), et parvient à créer un équilibre subtil où le référentiel culturel, musical et poétique arabo-levantin n’est ni surjoué dans sa complexité ou sa politisation, ni kitschisé (format habibi-yallah) pour être vendu à l’export. Le tour de force est aussi séduisant que modestement amené, mais bien réel au sein d’une génération où les musiques sont souvent cloisonnées, avec une appétence limitée pour les musiques arabes (virant parfois au véritable repoussoir pour certains artistes) de la part du monde alternatif et de l’improvisation libano-égyptien – rappelons par ailleurs que Beyrouth accueille un festival d’improvisation mondialement réputé, Irtijal. Une échappée aussi très féminine, qui rejoint une liste de plus en plus longue d’artistes percutantes dans la région, génération en plein essor, dans lesquelles il faut compter aussi Nancy Mounir, autrice du magnifique Nozhet el Nofous il y a quelques mois, Mayssa Jallad ou Aya Metwalli.