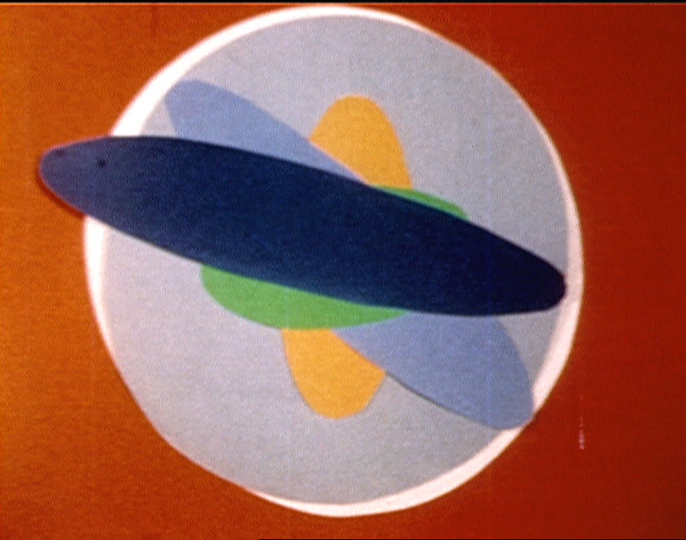Rien ne va, mais l’ébahissement perpétuel n’est pas une solution, pas plus que l’accablement et la résignation. Certes, je n’ai pas la tête à écrire, mais danser à faire fondre les semelles, ça je veux bien ; et pas avec le cœur lourd et nécrosé s’il vous plaît, mais la fureur rusée de celleux qui ne peuvent plus, ne veulent plus, faire machine arrière. Le footwork et la jungle m’ont toujours permis de signifier un trop plein par le corps ; c’est à chaque fois, une purification dans la révolte. Aujourd’hui cependant, c’est la sédition d’avec un moi un peu trop complaisant qu’il me faut gesticuler, une transfiguration. Je crois que même le hardcore continuum ne peut rien pour moi, cette fois-ci. Ce qu’il me faut, c’est imprimer, dans un processus initiatique, la façon dont toujours la France opprime, s’approprie, tue, éradique, jette et oublie, toujours avec l’aval des masses laborieuses de collaborateur·ices enjoué·es, mais n’efface pourtant jamais réellement (c’est là la faille de sa cécité orgueilleuse). Tout ça, et puis me changer un peu les idées, parce que l’ambiance grande sorgue, c’est plus possible !
Et c’est ainsi, sans surprise malgré les années sans écoute, que le mbalax se rappelle à moi, avec trois albums sortis durant la dernière décennie du XXe siècle, réédités un peu à l’arrache (le son est souvent un peu rincé, ça sent la numérisation de cassette sauvage) par le label sud-africain Global Press Music : Papa de Thione Seck (1991), Kara de Fatou Guewel (1993) et Soirée Sénégalaise – Ya Ma Saf de Salam Diallo (2000).
Emblème sénégalaise ultra-populaire depuis les années 1980, le mbalax est une musique qui emporte tout sur son passage. Sa force motrice est démentielle : dans chacune de ses cavalcades, il prend les pleins pouvoirs, ne laisse pas de prisonnier et appelle à la subversion corporelle. Par la danse et les déluges percussifs, le mbalax possède autant qu’il libère : les accélérations et les bifurcations y sont franchement spectaculaires, jouant souvent sur la rupture. On pourrait presque le dire dictatorial dans sa dramaturgie, mais contrairement à ce que l’on vit aujourd’hui, une dictature prolétaire joyeuse et assurée, paradoxalement sans État. Du chant aux tambours (le sabar, dont le légendaire Doudou N’diaye Rose fut un pratiquant à ce jour indépassé ; le tama, fameux tambour qui parle, joué avec une baguette courbe et placé sous l’aisselle ; la batterie aussi) en passant par la kora ou le xalam, les guitares et les synthés, le rythme prédomine. Soutenu, touffu, répétitif et pourtant imprévisible, il est une science absolument maîtrisée. On se joue de la métrique, alterne entre les canevas autoroutiers et les riffs explosifs ; l’interprétation de la pulsation varie, tout semble s’emballer mais non – les claquements de mains surgissants sont souvent les signes de cette stricte exhalation ; et dans les placements et les façons dont tout s’imbrique, j’entends souvent, si ce n’est tout le temps, quelque chose du footwork mais bien plus organique.
Comme autant de déstabilisation dans cette géopolitique du corps et de l’écoute : avec malice, casser la démarche.
« Bonsoir les ami·es, bonjour les vacances, c’est la soirée sénégalaise ! » : ce vers clamé par Salam Diallo au début de « Yama Saf » illustre la flamboyance frontale et sans détour de cette musique, qui s’incarne dans les instrus, mais aussi le lexique et les manières de le manier. Les chanteur·euses incisent et tranchent mais tirent aussi avec virtuosité sur leur voix. Fatou Guewell et Thione Seck sont très fort·es pour ce tiraillement doux sans être en reste sur les débits. Allez donc zoner du côté de « Sama Lebou Bi » – morceau parfait, qui mérite la mention incroyable pour les parties de tama et de BASSE SLAPPÉE. De son côté, Salam Diallo est carrément l’ambassadeur extravagant de la phrase onomatopéique frénétique – au Sénégal, comme souvent dans les endroits où l’on parle des langues à ton, le tambour palabre et signifie : sur « Diarama (Dialgaty) », il donne la leçon, entre interjections cérémonielles (« guitare solo, guitare basse !! ») et tambourinage verbal qui vient doubler les vraies percus (il est aussi percussionniste), ce qui me rappelle pas mal les impros dansées de gwo ka, soit dit en passant. Les idiomes se mélangent aussi : wolof et français ça je pourrais le parier, vu que ce sont les langues interethniques du Sénégal, une foule d’autres j’imagine et même de l’anglais façon poète de l’amour sur « Gadaye », slow acéré comme une arête de capitaine.
Le mbalax découle d’une tradition religieuse très ancrée en Sénégambie, les rites sacrés du Ndut. Très divers et élastique, absolument pas figé stylistiquement, il est avant tout un endroit de la célébration, festive ou non, et ces trois albums synthétisent ça chacun à leur façon. Soirée Sénégalaise en est une incarnation littérale : c’est la teuf comme un rituel, ramassée sur la fonction sans jamais oublier la narration, depuis « Ndar » – le riff de synthé tout malingre est magique, et les chœurs à l’arrière qui sonnent presque comme un sample, c’est ça ma house ! – jusqu’aux magnifiques louanges moralisatrices de « Yaru » à la fin, bien chill out. Kara est tout aussi festif, mais plus dance je dirais, moins conservateur : la section rythmique est toujours tight comme jamais et trop intelligente, c’est funky à 9,6 sur l’échelle Bernard Edwards, « Aduna » et « Petit Laa » déverrouillent direct la table VIP ! Et puis pas besoin de le dire, mais madame Guewell en impose carrément, quoi.
Par sa versatilité pourtant cohérente, sa double nature sacrée et profane, le mbalax est donc par essence une expérimentation. Et c’est pour moi Papa, l’album de Thione Seck (chanteur du Star Band de Dakar, puis de l’Orchestra Baobab, puis de Raam Daan, et papa de Wally Seck, on est pas sur de l’illustre inconnu chopé derrière les fagots, hein) dont j’ai assez peu parlé jusqu’ici qui l’incarne le mieux. Même si j’adore ces trois œuvres, ce dernier est mon préféré par son côté très pop, hybride sans tomber dans les travers de ce que cette notion peut recouvrir (cf. David Byrne parfois, désolé mais il faut le dire). J’adore « Khalel », son riff de basse et sa rythmique un peu bachata, son refrain limite raï, je pense tout le temps à « Obsésion » d’Aventura en l’écoutant, ce qui est étrange mais pas fortuit quand on sait que l’Orchestra Baobab était LE groupe de salsa afro-cubaine dakarois. Il y a souvent un feeling un peu chanson, de très belles parties de guitare, rêches et complexes, et toujours celles, bondissantes, de percussions – jusqu’à parfois prendre toute la place, ce qui est toujours surprenant et que j’aime beaucoup. Et puis, je me répète, mais la voix de monsieur Seck est magnifique. Il arrive à faire émerger un territoire du soleil un peu inédit et insolite, ouest-africain mais aussi hispanique voire baléarique et donc maghrébin, carrément cool (comme dans cool jazz, sauf que c’est Grande-Côte, là, pas celle de Californie ; allez d’ailleurs checkez ça, toujours sur Global Press, c’est pas du mbalax mais ça déboîte) qui s’entend très bien sur les trois derniers morceaux, « Papa », « Bakar » (avec une ligne de synthé façon modem, un peu hors tonalité, limite subliminale qui me fait complètement cabler) et « Niane Gui » (qui a cette petite pompe reggae que j’adore). Je suis totalement conquis par ce blend rafraîchissant, comme disent les cigarettiers électroniques, c’est imparable pour redonner confiance et se dire que de toute façon les chemises noires peuvent bien nous casser la gueule, briser nos os et prendre nos vies, elles n’éteindront jamais ce qui brûle fort, juste au-dessus du plexus solaire, quand la voix d’un·e griot·te se fait entendre. Voilà.
Pour conclure, en étant le plus prosélyte possible : allez voter demain, et pour le NFP, SVP. Et puis faites vous même un plaisir après, les franciliens de l’Est : Ustad Noor Bakhsh, grosse pointure du benju électrique et que j’ai complètement oublié de citer dans mon article de la semaine dernière (la hooooonte, c’est carrément LA star baloutche quoi, il a même fait une boiler room !), joue en trio aux Instants Chavirés ! Des bises, et le combat continue.

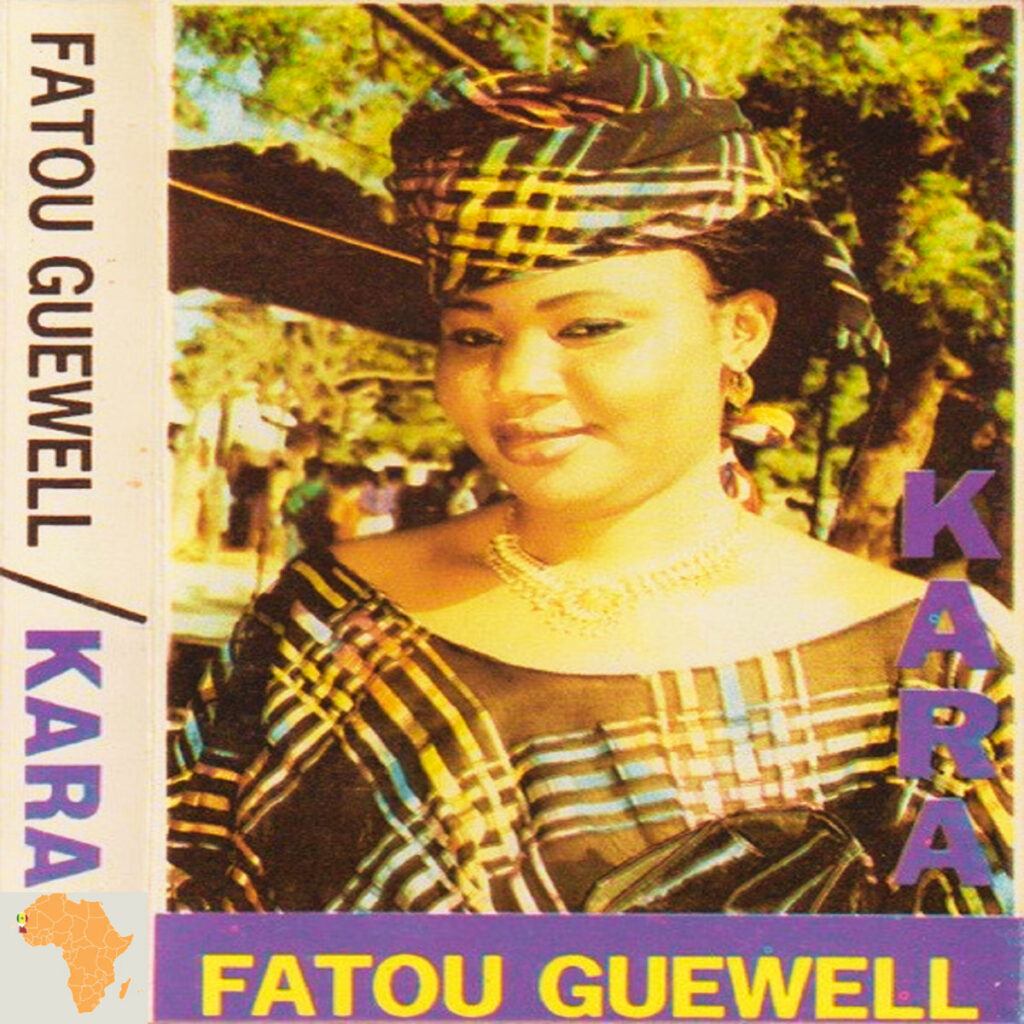
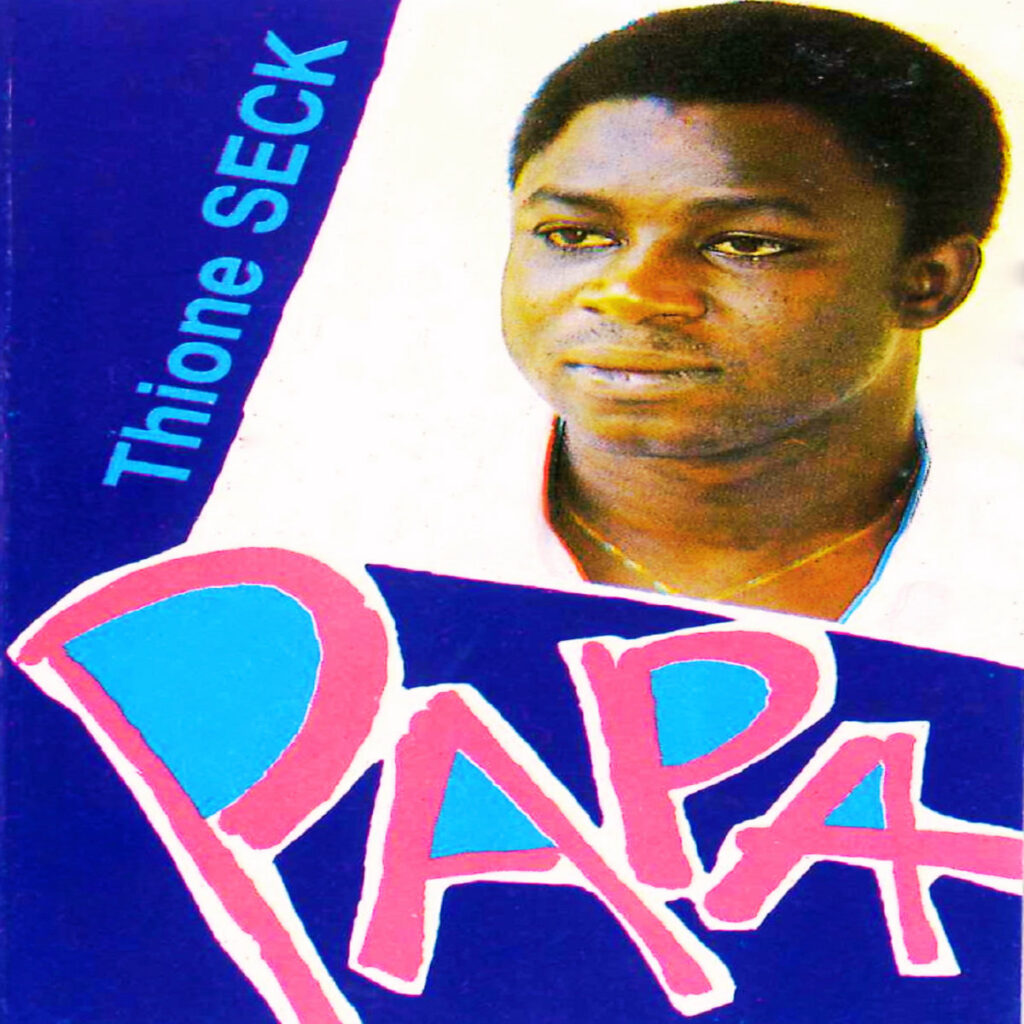

![Musique Journal - Quelques chansons génoises pas forcément légères, mais toujours savoureuses [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2021/03/musique-journal-61lokam3wel.-ac-sl1200--1024x1024.jpg)