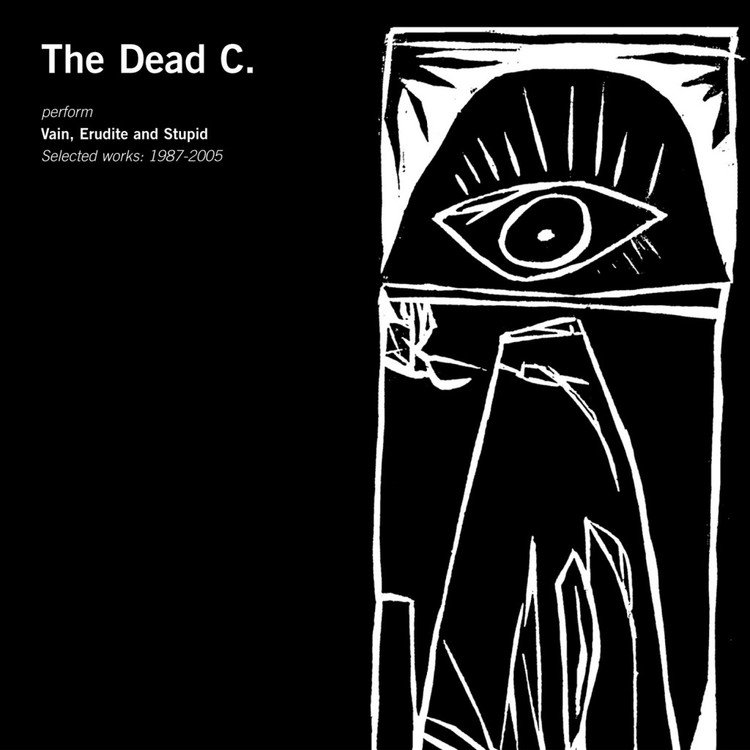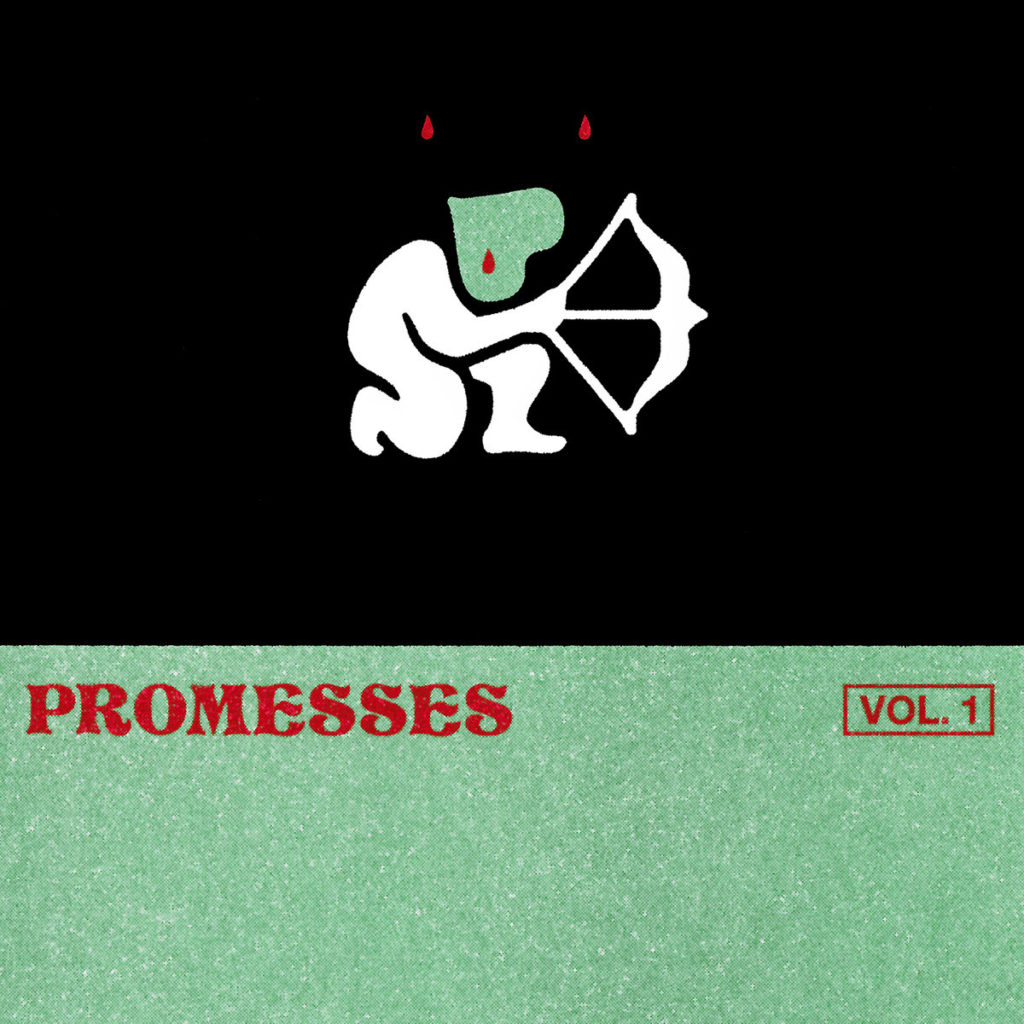On ne le dit pas assez, mais il faut être assez en forme pour écouter de la pop, pour pouvoir l’aimer et l’expérimenter à plein régime. Par en forme, j’entends à la fois psychologiquement et physiquement. D’abord parce qu’on peut dire que ça a tendance à aller ensemble chez la plupart des gens, et surtout parce que la marchandise musicale, en tant que mixte de suggestions d’émotions et de suggestions de mouvements, fabrique une zone intermédiaire de la sensibilité, une espèce d’interface qui fait échanger le corps et les facultés plus cérébrales, le jugement, l’acceptation ou le refus, l’analyse, le goût, etc (je sais que je ne suis pas en train de découvrir un truc, bien sûr que la distinction platonicienne puis cartésienne du corps et de l’âme/esprit s’est fait bouger depuis longtemps par des tas de philosophes, mais bref passons).
Je me permets d’évoquer ce constat car ces derniers temps je me sens moins en mesure de recevoir la pop, parce que cette zone intermédiaire de ma propre sensibilité se trouve dans une situation pas top. Je regarde ce que j’ai écouté en décembre ou en janvier et le souvenir de ces expériences résonne mal, pour le coup, dans mon corps. Je dirais que c’est une forme inattendue de dégoût, les marchandises me paraissent comment dire, trop mûres, elles en font trop, je les estime prévisibles, j’ai perdu leur nouveauté, et je ne les vois presque plus que comme des entités qui insisteraient lourdement pour me séduire – et ce, par leur simple existence de vignettes YouTube, sans même être activées par un clic sur play. Je me remémore péniblement leur effet ; mais en creusant ma réflexion je m’aperçois que ce ne sont en fait pas elles qui m’écœurent et qui se sont épuisées, mais que c’est au contraire plutôt moi qui ait saturé de leurs couleurs et de leurs cadences – it’s not you : it’s me.
Au-delà de cet espèce de ras-le-bol déprimé face à la surcharge du sentiment (surcharge même en puissance, dès que le sentiment devient data disponible à chaque instant et préférablement cliquable dès que possible), que je n’ai pas envie d’explorer davantage puisque cette exploration risquerait peut-être elle-même d’aggraver ma déprime, il y a sans doute une leçon à tirer, en dézoomant comme on dit, et en revenant sur l’usage que j’ai eu de la pop et que d’autres gens, vous ou d’autres, ont pratiqué jusqu’ici. C’est qu’on cherche et qu’on trouve dans les chansons pop un langage que le reste de notre vie, celle passée sans les chansons, ne sait pas articuler. Le « plaisir » qu’on tire de la pop est surtout le désir (réalisé, semble-t-il) de s’y sentir mieux que dans la vie, mais surtout de s’y sentir hyper autre et autrement, de se trouver un cœur de substitution plus puissant et plus libre que celui de l’humain un peu nul qu’on sait qu’on est plus ou moins. De se projeter dans l’expression d’un sentiment qui nous permet d’esthétiser un quotidien où l’on ne s’épanouit pas toujours comme on en rêverait, et en fait d’appréhender, à travers l’effet d’un tube ou juste d’un bon morceau, une espèce de réalité augmentée du sentiment.
C’est peut-être pour ça que la pop est addictive, qu’elle est consommée si massivement, parce qu’elle console en profondeur et qu’elle façonne un monde alternatif composé d’affects plus désirables que les siens propres. Je parlais des Loose Ends l’autre jour, je pourrais citer d’autres exemples mais celui-là me paraît déjà efficace : quand j’entends « Hold tight to your dreams », je ne sais pas si je dois prendre ça comme un conseil avisé (crois en tes rêves, bats-toi jusqu’à ce qu’ils se réalisent) ou comme son contraire (accroche-toi à ton idéal irréalisable et tu resteras prisonnier d’un fantasme de vie), et cette ambivalence (cette dialectique ?) ne peut être perçue qu’en même temps qu’on perçoit l’affect troublé de la chanson, un genre de béatitude douce-amère qui nous attire et nous hypnotise, en transcendant de très haut la simple recommandation de développement personnel. Éprouver cette suspension émotionnelle si affolante serait impossible sans cette chanson, rien d’autre ne fabrique ça tout seul, comme ça, juste « en nous ». Éprouver tous ces affects augmentés et proposés ainsi, mis à notre portée, par l’immense corpus pop, est à la fois le miracle et la malédiction de la marchandise sonore contemporaine.
Pour moi qui ne suis donc pas, en ce moment, disposé psycho-physiquement à recevoir ce type d’enrichissement du sensible, la voie vers une musique qui pourrait ne serait-ce que m’accompagner, m’entourer sans m’étouffer, n’est pas évidente à tracer. Je parlais d’Opening Night en début de semaine, un disque qui brille presque par son retrait, voire son absence stylisée, mais qui comme je le disais suggère tout de même un sédiment de posture esthétisante en dépit de sa tendance à délaisser les codes de la pose esthétisante – le refus de la projection devenant lui-même une projection.
Là depuis quelques jours j’écoute un tout autre genre de musique, où c’est l’ignorance de la possibilité d’esthétiser qui me fait du bien. Une ignorance de pas mal d’autres choses d’ailleurs, notamment le souci de solliciter mon attention, ce qui est pas mal. Ce sont des morceaux qui ne me demandent rien de spécial et qui ont surtout le don de me procurer l’impression que je les écoute quasi par hasard, comme si je passais parmi eux le temps d’un trajet : je parle d’une compilation de The Dead C.
Bien sûr ce que font les trois fameux Néo-Zélandais (Loïc avait déjà longuement parlé d’eux et de leurs travaux solo en 2022) se situe très loin de la pop, même en l’envisageant large, et ça peut donc expliquer leurs propriétés « détox ». Mais ce n’est pas non plus de la « grande » musique, et pour moi ce n’est même pas de l’expérimental au sens confrontationnel et subversif que ça peut avoir. En revanche oui ça sonne lo-fi, ça mélange jeu sur le jeu et écoute de l’écoute, mais tout ça dans une ambiance jamais franchement cérébrale – là encore je trouve que c’est le corps qui acte et qui reçoit principalement.
La géométrie confuse du son, type enregistrement de terrain, l’énergie stop–start des riffs et de la batterie, la voix qui surnage, et surtout l’effet très incertain de lui-même, fait de l’écoute de ce disque une expérience de mise à jour et de mise en doute des réflexes, une mise à jour et en doute dont on ne prend pas conscience tout de suite, c’est ça qui est cool (et d’une certaine façon c’est ça qui est encore articulé de façon résiduelle à la dynamique pop). On ne sait pas trop ce qui se passe et ce qui passe tout court, et ça permet de réévaluer ses attentes, de les redéfinir en toute tranquillité. Peut-être que le travail de Dead C. n’est pas conçu pour fonctionner ainsi, mais pour l’instant ça va être comme ça que je vais m’en « servir ».
Je vis Vain, Erudite and Stupid (pour le coup j’avoue que je m’identifie un petit peu à ce titre) comme je passerai à côté de quelque chose lors d’un trajet, disais-je, et si je devais comparer ce quelque chose à un vrai lieu je dirais une grange abandonnée, un préau de ferme en bordel, un entrepôt de machines agricoles semi-désaffecté. Ce ne sont pas des ruines au sens romantique : plutôt des zones dont on ne sait pas encore si elles sont terminées ou non, mais qu’on a en tout cas cessé de juger utiles. Et ça m’a fait penser à un super texte de l’écrivain-reporter Joseph Mitchell, écrit au milieu du XXe siècle, où il explore les étages d’un bâtiment partiellement abandonné à New York, avec le propriétaire des lieux qui est un vieil Italien tenancier d’un resto de poissons situé au rez-de-chaussée (et qui était jadis un hôtel assez chic, d’après ce qu’il sait). Le type lui raconte qu’il n’a jamais visité les trois étages supérieurs depuis toutes les années qu’il possède l’endroit, que c’est une sorte de mystère qu’il entretient avec lui-même, et Mitchell et lui décident d’y aller ensemble pour savoir de quoi il en retourne. C’est toute une galère pour monter voir – il y a un monte-charge antique et périlleux, c’est surtout pour ça que personne ne s’y est jamais aventuré – et une fois arrivé là-haut, le restaurateur et le journaliste trouvent le premier étage avec des chambres vides pour la plupart, le sol jonché de cadavres de bouteilles, d’énormément de poussière, de vieux papiers, de je sais plus trop quoi d’autre mais finalement rien de très mystérieux ni même de très mémorable aux yeux de l’Italien, qui se met à rouspéter et décrète vite qu’il trouve ça nul, minable comme découverte, que tout ça pour ça, et qui redescend en se jurant de ne jamais remonter. S’il était resté, je me dis qu’il y aurait peut-être entendu la musique de The Dead C. – en tout cas c’est elle qui résonne dans ma tête quand je pense à cet hôtel livré à l’obscurité et au temps immobile, et curieusement ça me remet un petit peu en état de recevoir du sentiment sonore.