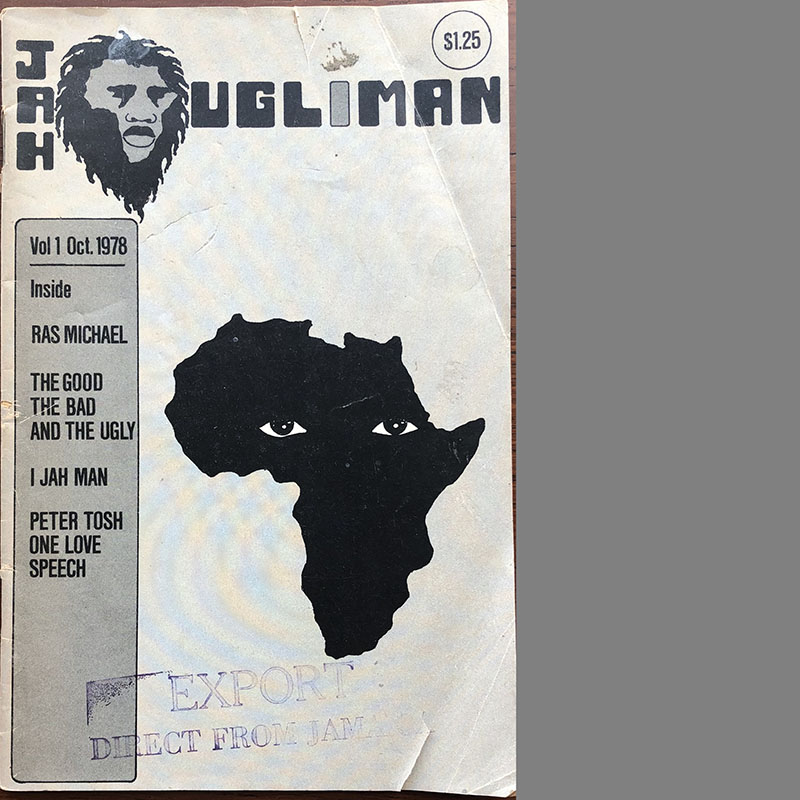Une baie. Le ciel est couvert et le vent souffle, fort. Vite, un thème tout aussi orageux se mêle au son de celui-ci. Des barbelés, immobiles, strient les cieux ; les herbes jaunies ondulent rapidement. La caméra glisse par à-coups, puis rupture – Horus, pyramides, ruines hellènes. Des grillons, puis une voix s’élève : « une mémoire inconnue fuit, obstinément, vers des époques de plus en plus lointaines ». Un fourneau métallurgique comme une gueule immense, une momie, une sculpture, la mer.
Avez-vous vu Méditerranée, film extraordinaire réalisé en deux ans par Jean-Daniel Pollet et un acolyte de poids en devenir, Volker Schlöndorff, à partir d’images captées sur le pourtour de la mer susnomée ? Si la réponse est non, pas d’inquiétude, vous n’êtes pas seul·e : bien connu des cinéphiles, succinctement encensé par Godard qui le citera dans plusieurs de ses œuvres, ce film reste pourtant aussi confidentiel qu’ancré dans l’histoire de la Nouvelle Vague. Perso, c’est lors d’une séance au cinéma La Clef, alors encore en sursis mais assidûment fréquenté, il y a quelques années de cela, que j’ai pris connaissance à la fois de l’existence de Méditerranée et de ses réalisateurs (enfin au moins de l’un, Volker est quand même moins confidentiel). Dans cette ambiance mondaine et sympathique, entouré de congénères vraisemblablement plus informés que moi sur la chose cinématographique et sa grande histoire, un miracle va une fois encore se jouer.
Vous vous doutez évidemment que si j’en parle ici-même, c’est que la force de cette œuvre doit en partie au moins résider dans sa dimension sonore. Méditerranée, comme tout bon film qui se respecte (encore un avis définitif), est un équilibre audiovisuel parfait. Les couleurs, saturées et brûlantes, sont gorgées de toute la force vitale du monde – ce jardin sicilien, qui illustre, peut-être avec autant de force que Le Guépard de Visconti, la sensualité onirique d’un « Sud » fantasmagorique – ; le montage, par Jackie Rayant (son premier), percute par son audace et fait émerger une dramaturgie elliptique, mystérieuse ; la musique appose sur la totalité le sceau d’un modernisme (le terme est évidemment compliqué mais on va dire que je le dé-corrèle de son apparat philosophico-artistique) méditerranéen romantique et inquiétant, hautement mélancolique – cet ostinato implacable et romantique, dans tout les sens du terme –, et se lie parfaitement avec le texte simple, flou, lointain, littéralement extraordinaire de Philippe Sollers.
Une table d’opération en aluminium brossé attend puis porte sans heurt et placidement une fille endormie, un taureau est exécuté lors d’une corrida : ce sont des images qui glacent et réchauffe, sans qu’il soit forcément possible de saisir le pourquoi de cela. Cette chaleur inquiétante, c’est ce qui me fascine principalement, dans ce film.
L’idée même d’une segmentation entre fiction et documentaire vole en éclat. Les images sont captées en Grèce, en Espagne, dans le Maghreb sûrement, en Italie, en Égypte, dans des musées, à l’intérieur de bâtiments d’aujourd’hui. La mer, des côtes, des femmes, des hommes, le ciel : peut-être se trompe-t-on. La manière dont la caméra se meut, étrangement incarnée, dont la partition s’articule, dont des mouvements-fragments se répondent et se coupent, tout cela participe à la construction d’une narration autre, plus proche du rêve (répétitions et décalages : en fait, le film ne compte pas tant de séquences différentes ; surtout, je ne sais pas s’il existe, DANS TOUT LE CINEMA, de séquence plus onirique que ce plan récurrent d’entrée par le haut dans un jardin luxuriant) ou de la phénoménographie, de la description du monde en train de se faire (cette fille, magnifique, qui rie, se joue d’une fleur, remet sa robe alors que l’orchestration, romantique AF, nous inonde). Des associations se font : une grève et ses débris, les pyramides. Ce que l’on voit, ce que l’on entend, c’est un exotisme s’extirpant de lui-même (on est au début des 1960, soyons indulgent·es) pour proposer un univers complexe, vidant les clichés de leur substance même ; la musique participe beaucoup à cela.
Nous sommes là, avec Jean Rouch, Andreï Tarkovski et Francis Ponge – « j’ai vu Méditerranée. C’est dans mes rêves dorénavant. Je n’arrive pas à travailler aujourd’hui parce que j’ai ce film en tête. Ceux qui n’aiment pas ce film, s’il en est, sont mes ennemis », écrit ce dernier –, sans savoir où, sans savoir quand, exactement, mais nous y sommes.
La musique est signée Antoine Duhamel, fils de Georges et accessoirement solide professionnel de la BO, qui a entre autre bossé avec Truffaut et Godard (Pierrot le Fou mais aussi Week-End, que j’adore), Astruc, Tavernier ou Leconte. Un monsieur passé au cons’ de Paris période légendaire, avec Olivier Messiaen et René Leibowitz en prof, d’où les inflexions presque dodécaphoniques, le goût poussé pour le drame, les émotions fortes et les rapports harmoniques pas vraiment estampillés Top 50.
La force de cette bande originale, c’est aussi la façon dont le silence, ou au moins l’absence de musique, se trouve mobilisée pour augmenter la tension entre réel et fiction : les field recordings, artificiels ou non, souvent fantasques dans leur lien aux images – les séquences dans la demeure (7min50 puis 9min30), uniquement habillé de sons d’oiseaux, d’insectes, de clapotis cartoonesque et que sais-je encore, ou cette embarquée avec un pêcheur. Il y a un trouble toujours, même lorsque des segments sensiblement plus extradiégétiques sont utilisés (le moment du bal accompagné par le chanson de rebetiko, vers 12min45). Les sons les plus vrais, si cela a un sens, sont aussi les plus durs, comme la corrida, insoutenable lorsque mise à nu (24min).
Je vais arrêter ici ma petite analyse, pour ne pas raconter le film en entier. Je me rend compte que je n’ai quasiment pas parlé de Jean-Daniel Pollet, ce qui est un tort parce que cet homme fut un chouette et intéressant cinéaste, dont je ne connais pas assez bien la filmographie. On a presque fini, juste un petit rappel pour ceux qui sont debout avant la sonnerie : dans le corps de l’article, je vous ai mis une version condensée du score de Duhamel sortie sur disque. C’est court et plus simple pour se faire une idée si on est pressé, mais vraiment je ne transigerai pas, pour écouter la BO, il faut regarder le film. Déjà pour la culture G svp, mais surtout parce que tout parle de concert ici – comme dans la vraie vie.