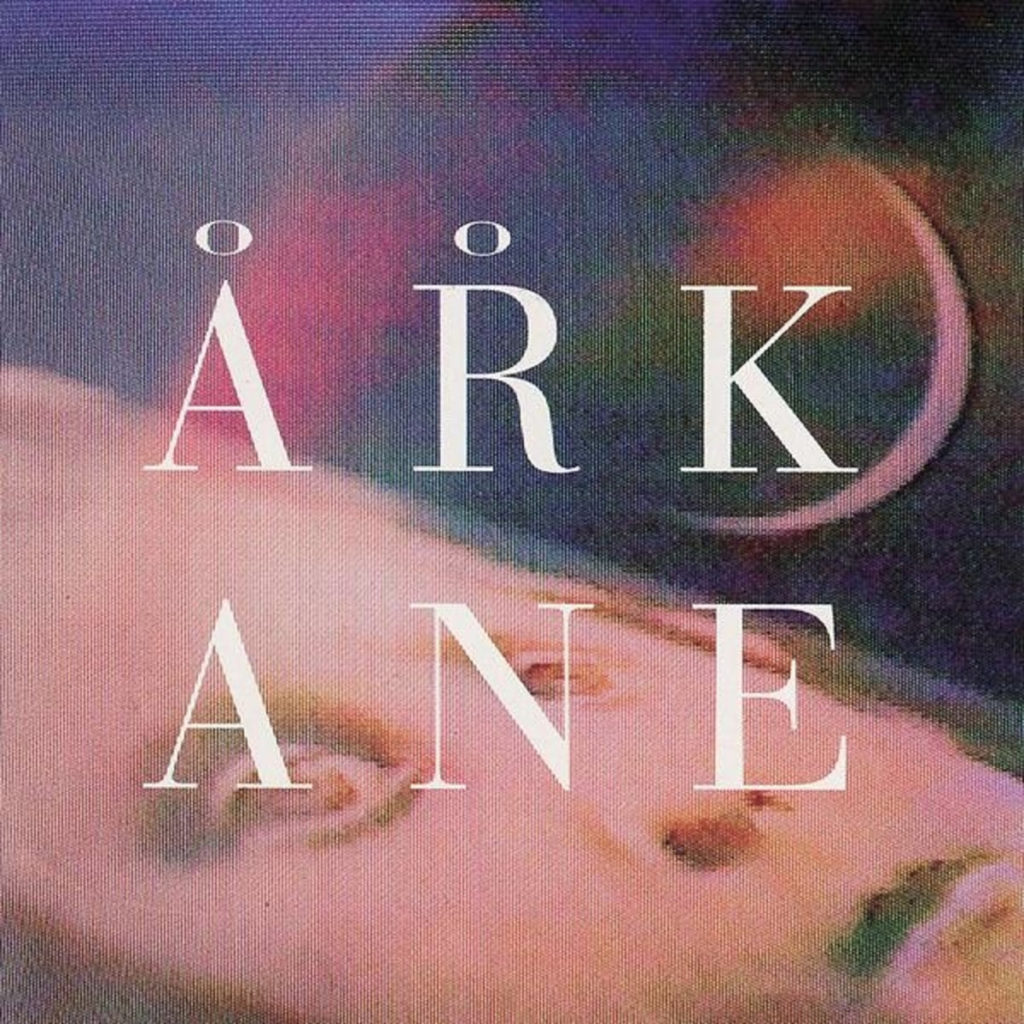Cela fait maintenant un moment que j’avais en tête d’écrire un papier sur les musiques électroniques et l’anthropocène, mais pour une raison que je ne parviens toujours pas à m’expliquer, je me suis pendant longtemps contenté de compiler des liens dans de multiples fichiers Word jamais ré-ouverts depuis. Le hasard du calendrier aura voulu que je rédige ce premier article après avoir fui les incendies de la mi-juillet dans le Sud-Ouest de la France et m’être retrouvé au beau milieu des inondations sur la petite côte sénégalaise, naviguant dans une sorte d’apocalypse climatique un peu trop ballardienne, quelque part entre Sécheresse et Le Monde englouti. Comme quoi, en musique comme dans la vie, tout n’est souvent qu’une question de déclic.
Il y a une dizaine d’années, j’ai commencé à développer une drôle d’obsession pour tous les projets discographiques qui jouaient avec l’idée de nature artificielle. Dans mon souvenir, ça avait plus ou moins démarré avec l’écoute de R+7 d’0PN. Certaines pistes m’avaient interpellé parce qu’elles semblaient opérer une sorte de simulation numérique de l’environnement naturel (je pense à « Zebra » par exemple, qui m’évoque toujours une image de « savane digitale », sans que je sache précisément ce que j’entends par là). J’avais aussi bien accroché avec Pixel Wave Embrace de Yamaneko, un album de grime instrumental assez méditatif, qui déployait en creux un léger fantasme de tropicalité, du grime un peu Center Parcs, calibré pour la piscine à vagues d’un parc aquatique sous cloche. Et puis il y avait cette esthétique « post-nature » qui me plaisait beaucoup et qu’on pouvait trouver dans les vidéos de Nic Hamilton, un artiste australien qui s’était fait connaître en réalisant des vidéos pour Actress au début des années 2010 et dont le travail est en partie marqué par l’enchevêtrement de paysages naturels et numériques.
Par la suite, je me rappelle m’être procuré Osmose d’Ariel Kalma à la boutique Materia Prima de Porto, une œuvre qui mélange field recording en forêt tropicale et compositions minimalistes new age, et avoir été frappé par un commentaire, posté sur la page Bandcamp de l’album, selon lequel ce disque de 1978 n’aurait pas dépareillé en 2014 sur un label comme Software (Recording Co.), le label défunt depuis 2018 de Daniel Lopatin : ce qui me ramenait à nouveau à « Zebra ». J’avais alors le sentiment d’une sorte de convergence, dans des scènes musicales pourtant distinctes, comme si cette idée de « nature digitale » pouvait constituer un objet narratif pour les musiques électroniques at large, à mesure que le discours sur l’anthropocène commençait à faire son bonhomme de chemin hors des cénacles de géologues et de climatologues.
Très présentes dans la littérature, le cinéma et la télévision, les écofictions portent le message écologique en nous invitant à imaginer la fin du monde. Ce concept trouve de multiples résonances dans le champ musical aujourd’hui, où de nombreux albums, labels et mouvements s’emploient à mettre en scène l’image ou la notion de nature, à tenter de la déconstruire et de se jouer de ses représentations.
2015 est une année charnière pour la prise en compte des enjeux liés au réchauffement climatique, avec la tenue de la COP21 et l’adoption de l’Accord de Paris, qui a notamment vu se populariser le concept d’anthropocène. Dans un article publié sur The Quietus, le journaliste Rory Gibb dressait un panorama du « son écologique » symptomatique de ce changement culturel, illustrant son papier avec la pochette du 45 tours Moth / Lake d’Elysia Crampton. Quelques années plus tôt, Dominikus Müller s’intéressait pour la revue d’art Frieze à la résurgence des motifs naturels à l’ère numérique, à travers un article intitulé « Ambient Natures », dans lequel il observait que l’expérience de la nature était devenue indissociable d’une esthétique de l’atmosphère, où « la nature apparaît comme un écosystème enveloppant, une texture globale qui est diffuse, inclusive et entrelacée au point que les éléments individuels deviennent indiscernables, où l’individu devient le paysage ».
Sorti en 2015 sur Knives, le label de Jamie Teasdale/Kuedo et de Joe Shakespeare, Ecologies, du Lituanien Jacques Gaspard Biberkopf, est un EP qui adresse la notion d’anthropocène du point de vue des musiques électroniques post-club. Musicalement, Ecologies trace son sillon quelque part entre le grime spatial de Logos (Cold Mission), la trance algorithmique de TCF et les collages brutalistes de Mesh (Piteous Gate), qu’il anticipe de quelques mois à peine. Conceptuellement, c’est un album qui résonne pas mal voire beaucoup avec les premières sorties d’Elysia Crampton post-E+E (Moth / Lake et surtout American Drift), dans sa manière, relativement inédite pour un disque de musiques électroniques, de redéfinir les contours de notre relation avec le monde.
À l’image de sa pochette, signée Joe Hamilton, qui figure une juxtaposition de paysages naturels qu’on pourrait presque qualifier de « classiques », Ecologies déploie, tout au long de ses 6 pistes et 21 minutes, différents écosystèmes possibles, tantôt naturels tantôt virtuels, quand ce ne sont pas les deux en même temps. Je me dois de revenir ici brièvement sur le travail de Joe Hamilton, qui a été une source d’inspiration majeure pour l’EP de Biberkopf. Comme Nic, avec lequel il n’entretient aucun lien de parenté, Joe Hamilton est un artiste visuel australien assez pionnier, qui s’intéresse à la notion d’environnement naturel dans un monde de plus en plus technologique et connecté et dont l’esthétique a eu une influence considérable sur l’art numérique de la décennie passée.
Il est notamment responsable d’Hyper Geography, un projet transmedia (n’ayons pas peur des mots) qui a d’abord démarré comme un tumblr en 2011, accompagné d’une vidéo, avant d’être édité en livre en 2014. Empruntant aux théories de la vitesse de Virilio et d’hyperréalité de Baudrillard, Hyper Geography présente une collection d’images, glanées sur Tumblr, composant une sorte de méta-paysage numérique dépourvu de tout ancrage géographique, où la technologie a fusionné avec la nature pour l’investir d’un sens nouveau, formant un patchwork digital un peu vertigineux, qui donne à voir et à ressentir un monde sans bord ni centre, figé dans un présent perpétuel.
Ce principe de collage et de juxtaposition se trouve justement au cœur de l’approche compositionnelle de J.G. Biberkopf : les rares éléments rythmiques sont avant tout percussifs et principalement le fait d’appareils technologiques, d’outillages et de machineries diverses (maillets, pistons, foreuses, turbines, etc.), sur lesquels viennent se superposer différentes enveloppes (field recording d’éléments naturels, drones menaçants, synthés hallucinés, voix robotiques et déshumanisées), comme par sédimentation. Tout semble hautement trafiqué et manipulé, il n’y a plus aucune trace de la nature sur Ecologies, ou plutôt, la nature qui subsiste a ici le goût métallique du plutonium.
Ainsi « Air. Coltan. Carbon. Lithium », la piste d’ouverture, n’est pas sans évoquer l’écologie du smartphone et l’extraction du coltan dans les mines de la RDC, utilisé pour la fabrication de micro-condensateurs nécessaires aux composants électroniques des terminaux mobiles. « Spirit » offre une perspective quasi-animiste à l’auditeur, en faisant revivre le fantôme de 2Pac (la fameuse ligne « Somebody wake me up, I’m dreamin’ » empruntée à « Still I Rise », qui rappelle l’utilisation des adlibs de Lil Jon sur American Drift) quand « Waters » nous plonge dans un cauchemar hypnotique aux résonances encore une fois ballardiennes.
« Black Soil » avance encore un peu plus loin dans l’horreur et figure une terre contaminée, l’anthropocène prenant ici les traits du Colonel Kurtz, clap de fin de ce voyage initiatique au cœur des ténèbres artificielles. Flirtant avec le dubstep, « Age of Aquarius » signale un brusque changement de rythme dans la narration ; « Weakness », qui puise dans les sonorités IDM nineties, offre une conclusion tout en résurgences cybernétiques, en prenant cependant le soin de laisser l’essentiel en suspens.
Je me souviens d’une prise de position du DJ londonien Bok Bok, boss du label Night Slugs, qui déplorait une scène de sexe (audio) entre une femme et un piston hydraulique à la fin du track « Waters », dans une série de tweets hyper moralisateurs qui m’avaient passablement agacés à l’époque, comme si l’ambiguïté maintenue tout au long de l’EP en atténuait d’une quelconque façon la portée critique et qu’une exigence de transparence était nécessairement attendue de la part des artistes quant à l’intentionnalité de leur démarche. Sans chercher à réouvrir un débat vieux de sept ans, j’aime à penser que c’est précisément ce renversement des perceptions, où la nature n’est plus qu’un artefact soumis aux impératifs de la technologie, qui fait d’Ecologies un objet musical encore aussi singulier et pertinent aujourd’hui.
Le philosophe britannique Timothy Morton désigne par dark ecology ou « écologie sombre » cette nouvelle esthétique écologique qui récuse la notion de nature, comme un ailleurs mythique et fantasmé, et prend acte de la coexistence monstrueuse avec les non-humains. Il déploie également le concept de « maillage » (ou mesh) pour rendre compte de l’enchevêtrement dans lequel nous nous situons, un environnement sans arrière-plan où tout est interconnecté. Ces deux notions deviennent tout de suite nettement plus tangibles lorsqu’on écoute les écofictions musicales déployées par J.G. Biberkopf, tant elles semblent guider sa démarche – pour ne pas dire au cœur de son projet artistique. Il est cependant intéressant de souligner que le concept même de nature englobante, très ethnocentré, ou le field recording – son incarnation sonore par excellence – trônent en pièces maîtresses dans la plupart de ces productions contemporaines dites « écologiques », avatars d’une modernité paradoxalement à la source de cette pensée. Si l’album de Biberkopf reste dans la lignée de cette écologie (post-)moderne, la pratique d’Elysia Crampton (dont Étienne Menu parlait il y a maintenant 3 ans), par exemple, semble remettre en cause un peu plus radicalement cette même notion, en s’ancrant totalement dans un néo-indigénisme magique amenant à un basculement ontologique.
Pour conclure, revenons une dernière fois à J.G. Ballard. Ecologies m’évoque beaucoup La Forêt de Cristal, un roman tout en réfractions dans lequel un phénomène de cristallisation de la forêt est responsable d’une déperdition de lumière dans les villages avoisinants. Les paysages sonores dépeints par Biberkopf sont d’un noir cinématographique, et il y a quelque chose d’un peu hollywoodien aussi là-dedans. Je me dis surtout, avec le recul, que cet EP aurait fourni une bien meilleure bande-son à Annihilation que l’OST somme toute assez pompeuse composée par Geoff Barrow et Ben Salisbury.
![Musique Journal - Écofictions (1/3) : J.G. Biberkopf écrit l’OST ballardienne du cauchemar contemporain [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2022/09/musique-journal-a0161545081-10-1024x1024.jpg)

![Musique Journal - Écofictions (2/3) : la tropicalité liminale et synthétique d’Andrew Pekler [archives journal]](https://musique-journal.fr/wp-content/uploads/2023/03/musique-journal-a3716245694-10-1024x1024.jpeg)